Ox : « j’attends qu’un lieu et une image se rencontrent »
|
Ox : « j’attends qu’un lieu et une image se rencontrent » |
Jouer avec les lieux, leur insuffler une dose de poésie épurée et d’humour : les détournements d’affiches d’Ox sont autant de parenthèses dans la ville ou ses alentours. Rencontre avec l’artiste né en 1963, ex-membre des Frères Ripoulin.
Quels ont été vos débuts ? J’ai étudié aux Arts Déco. Là, j’ai rencontré des gens avec qui j’ai commencé à faire des fanzines, de la sérigraphie. Puis nous avons fait la connaissance de Jean Faucheur, qui pratiquait déjà des collages et avait envie de partager sa technique avec d’autres. Avec lui, nous avons alors monté un collectif de sept artistes, les Frères Ripoulin, en 1984. Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’affiche ? Quelles étaient à l’époque vos sources d’inspiration ?
Pourquoi avez-vous alors arrêté le travail en extérieur pour quelques années ? Les affiches, au départ, étaient vraiment une action de groupe, et à la dissolution je n’ai pas eu envie de continuer tout seul. On s’est trouvé chacun un peu isolés, et on a pu prendre le temps de réfléchir à ce qu’on faisait. Ensuite, quand je suis retourné en extérieur, j’avais envie de me servir de cette réflexion. Au fur et à mesure que je faisais des collages, je me rendais compte que l’environnement était important, que la saison était importante. J’ai travaillé sur l’interaction entre l’oeuvre et l’extérieur. Comment s’est opéré ce retour à la création dans la rue ? J’en avais un peu assez de travailler tout le temps en atelier. Je suis retombé sur Jean Faucheur, qui avait recommencé à travailler avec des gens plus jeunes comme Thom Thom. Cela m’a permis de rencontrer une nouvelle génération. J’ai eu l’envie de retrouver cette action très directe, très rapide, et pendant des années je n’ai plus fait que ça… Comment choisissez-vous les lieux de vos interventions ?
Vous vous êtes aussi beaucoup intéressé aux no man’s land urbanistiques que sont certaines zones de banlieues… Oui, je m’intéresse beaucoup à la couche suburbaine, parce qu’il y règne un grand désordre architectural. Paris est très ordonné, très rigoureux. En banlieue, la multiplicité des emplacements fait qu’il y a des points de vue très particuliers. Ce sont des endroits où je n’avais pas tendance à aller, où l’on n’a pas l’habitude de marcher – près des bretelles d’autoroute, par exemple. Il y a aussi beaucoup plus de choix, de recul pour les prises de vue. Détourner des espaces publicitaires, c’est offrir une forme de respiration dans la ville ?
Diriez-vous qu’il y a une dimension ludique dans votre travail ? Bien sûr, cela vient de l’esprit de l’époque où j’ai commencé, un peu post-punk, déconnant, potache. Certains visuels que je trouve, je les rapprocherais d’Hara-kiri, surtout les fiches bricolages qui n’étaient pas loin de certaines formes d’art contemporain aujourd’hui. Faire sourire me fait plaisir, cela fait partie de mon travail. Pourquoi ce goût de la forme géométrique, presque abstraite ? Cela provient de mon travail en atelier. A mes débuts, je faisais des graphismes assez saturés et compliqués. Et puis j’ai réduit de plus en plus le nombre de signes. J’ai par exemple utilisé des images commerciales dont j’ai enlevé tous les signes reconnaissables. Ne reste plus qu’une trame assez abstraite, un réseau assez minimal. J’aime travailler avec le moins de choses possible. Speedy Graphito, Ludo et Rero, sont des artistes avec lequels vous avez collaboré lors de l’exposition à la New Square Gallery en 2013 (cf. l’interview d’Emmanuel Provost). L’art urbain est un mouvement dans lequel vous vous reconnaissez ? En fait, nous nous connaissions tous les quatre et nous avions envie de travailler ensemble, mais c’est vraiment une exposition qui ne fait pas référence à notre travail dans la rue. Nous avons réfléchi à l’intérieur du format de la peinture. Les expositions qui se revendiquent street art me gênent un peu. Même si je profite de l’engouement actuel, qui sera sans doute provisoire. Pourquoi ? Il y a tellement de tendances et d’écoles qu’à mon avis, ça ne peut pas définir un style. Même si je ne rejette pas le terme de street art, quand j’ai commencé, cela ne s’appelait pas ainsi. Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas dans le street art, par moments je considère même que c’est une pollution visuelle au même titre que la publicité, quand c’est mal placé par exemple… Je trouve que parfois ça s’impose un peu trop. Propos recueillis par Sophie Pujas Pour en (sa)voir plus : postertime.blogspot.fr [Visuels : en haut : OX, contact entre une chips et une patatoïde carrée, 100×80 cm, 2013 (Courtesy New Sqaure Gallery // les suivants : Courtesy Ox] |
Articles liés

Critique – La Grande Dépression au Théâtre de La Tempête
Sept ans après avoir signé “La Grande dépression”, Raphaël Gautier voit son texte mis en scène avec talent par Aymeline Alix, une farce déjantée qui se refuse au cynisme, et encourage la créativité ! En 1933, Adolf Hitler est...

Ce week-end à Paris… du 14 au 16 mars
Art, spectacle vivant, cinéma, musique, ce week-end sera placé sous le signe de la culture ! Pour vous accompagner au mieux, l’équipe Artistik Rezo a sélectionné des événements à ne pas manquer ces prochains jours ! Vendredi 14 mars...

“Reliquat” : le nouveau solo show de l’artiste Bault au Cabinet d’amateur
Du 20 au 30 mars, Le cabinet d’amateur accueille l’artiste Bault pour sa nouvelle exposition intitulée “Reliquat”. RELIQUAT Résidus de papiers assemblés en collages hasardeux. Reliquat de bois et statuaire peinte. Boîtes entomologiques. Bault dévoile des nouvelles recherches expérimentales...



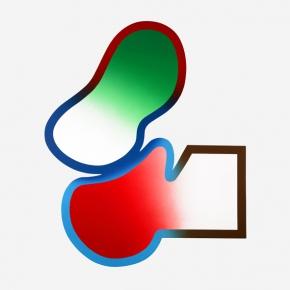
 Nous venions juste après la Figuration libre, et nous étions fans de Di Rosa, de Bazooka, etc. On venait de la télé, de la bande dessinée, de la pub dans une certaine mesure. De l’histoire de l’art, aussi, mais c’était surtout la culture populaire qui nous intéressait. Comme dans le rock à l’époque, il y avait une dynamique du « Do it yourself », du « Allez-y ». La première à nous exposer a été Agnès b.. Elle s’intéressait au mouvement graffiti, qu’on commençait à découvrir en France. C’était un peu les mêmes choses qu’on présentait dans la rue et les galeries. On utilisait les panneaux d’affichage mais on ne tenait pas compte du contexte. On peut d’ailleurs regretter maintenant que certaines photos soient cadrées trop serrées, on perd un peu la situation de l’époque. Puis nous avons dissous le groupe. Au niveau commercial, cela a été un échec total. Et chacun voulait partir dans une direction différente.
Nous venions juste après la Figuration libre, et nous étions fans de Di Rosa, de Bazooka, etc. On venait de la télé, de la bande dessinée, de la pub dans une certaine mesure. De l’histoire de l’art, aussi, mais c’était surtout la culture populaire qui nous intéressait. Comme dans le rock à l’époque, il y avait une dynamique du « Do it yourself », du « Allez-y ». La première à nous exposer a été Agnès b.. Elle s’intéressait au mouvement graffiti, qu’on commençait à découvrir en France. C’était un peu les mêmes choses qu’on présentait dans la rue et les galeries. On utilisait les panneaux d’affichage mais on ne tenait pas compte du contexte. On peut d’ailleurs regretter maintenant que certaines photos soient cadrées trop serrées, on perd un peu la situation de l’époque. Puis nous avons dissous le groupe. Au niveau commercial, cela a été un échec total. Et chacun voulait partir dans une direction différente. Je fais beaucoup de repérages. Je me promène, je prends des photos, je cherche des lieux intéressants. Je collecte des images. Avant, ces images venaient des magazines, et aujourd’hui plutôt d’Internet. La plupart du temps, j’attends qu’un lieu et une image se rencontrent. Parfois, je sais qu’un lieu est intéressant, mais cela peut prendre des années avant qu’une image ne vienne s’y imbriquer – parfois le panneau a été détruit entre-temps ! Maintenant, je choisis beaucoup le lieu en fonction de la photographie que je vais obtenir, alors qu’avant, je privilégiais des endroits stratégiques avec beaucoup de visibilité. Il y a une grande déforestation publicitaire ces dernières années – j’ai de plus en plus de mal à en trouver dans Paris, par exemple.
Je fais beaucoup de repérages. Je me promène, je prends des photos, je cherche des lieux intéressants. Je collecte des images. Avant, ces images venaient des magazines, et aujourd’hui plutôt d’Internet. La plupart du temps, j’attends qu’un lieu et une image se rencontrent. Parfois, je sais qu’un lieu est intéressant, mais cela peut prendre des années avant qu’une image ne vienne s’y imbriquer – parfois le panneau a été détruit entre-temps ! Maintenant, je choisis beaucoup le lieu en fonction de la photographie que je vais obtenir, alors qu’avant, je privilégiais des endroits stratégiques avec beaucoup de visibilité. Il y a une grande déforestation publicitaire ces dernières années – j’ai de plus en plus de mal à en trouver dans Paris, par exemple. Je n’ai pas de démarche anti-pub, au départ. J’y voyais avant tout un espace qui servait mon travail. Même si comme tout le monde j’ai une réflexion sur le sujet, cela ne transparaît pas nécessairement, l’important n’est pas là. J’aime jouer avec. Je n’ai pas spécialement envie qu’ils disparaissent, même si à une certaine époque, dans le Paris des années quatre-vingt, c’était incroyable, il y en avait partout. Mais ce qui est bien de temps en temps, c’est de dessaturer l’image, parce que nous sommes très bombardés d’images et de messages. Donc en ce sens, oui, cela peut être une forme de respiration visuelle. J’aime aussi le côté éphémère et ponctuel. Cela ne s’impose pas dans l’espace urbain, puisque c’est généralement détruit au bout de quelques jours.
Je n’ai pas de démarche anti-pub, au départ. J’y voyais avant tout un espace qui servait mon travail. Même si comme tout le monde j’ai une réflexion sur le sujet, cela ne transparaît pas nécessairement, l’important n’est pas là. J’aime jouer avec. Je n’ai pas spécialement envie qu’ils disparaissent, même si à une certaine époque, dans le Paris des années quatre-vingt, c’était incroyable, il y en avait partout. Mais ce qui est bien de temps en temps, c’est de dessaturer l’image, parce que nous sommes très bombardés d’images et de messages. Donc en ce sens, oui, cela peut être une forme de respiration visuelle. J’aime aussi le côté éphémère et ponctuel. Cela ne s’impose pas dans l’espace urbain, puisque c’est généralement détruit au bout de quelques jours.















