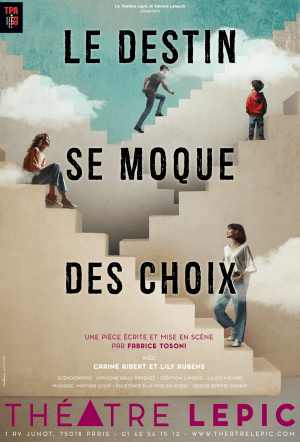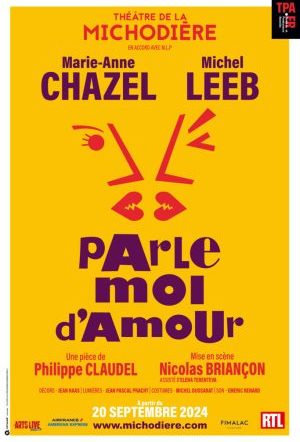Julie Deliquet et Vania au Français : “On a essayé d’inventer une méthode commune.”
|
Vania D’après Oncle Vania de Tchekhov |
Comment avez-vous découvert le travail collectif d’écriture de plateau et quels aspects de cette méthode vous ont séduite ? Je ne parvenais pas à faire le deuil du travail collectif qu’on effectue dans les écoles de théâtre. Après quelques années, alors qu’il y avait un nombre de talents autour de moi, j’ai pensé qu’il fallait nous réunir pour retrouver l’émulation des écoles et pour redéfinir la place de chacun. Concernant l’écriture de plateau et l’écriture collective à proprement parler, on a d’abord commencé par des auteurs, avec deux textes. Ce travail était avant tout un travail de répétition. De l’improvisation, on allait vers le texte. Au bout de deux spectacles qu’on avait travaillés, il y a presque une langue qui est née entre nous, que l’on n’avait jamais montrée au public et que nous avions envie de partager. Mais, à vrai dire, quand j’ai fondé In Vitro, je ne voulais pas à proprement parler faire de la création collective, mais plutôt bousculer la répétition collectivement, redéfinir la place de chacun et travailler avec l’auteur que je considérais comme un membre du collectif. De plus, le travail d’écriture de plateau est très compliqué. Très joyeux mais très dur aussi, très violent ; c’était une autre phase de notre travail. Comment avez-vous été amenée à travailler à la Comédie-Française ? Quand Éric Ruf est venu voir la dernière création collective qu’on a faite, il m’a exprimé une deuxième fois son souhait que je travaille au sein de la Comédie-Française. À ce moment-là, je sentais que j’avais besoin de me requestionner en tant qu’artiste. J’avais besoin d’un retour à l’auteur. S’il y avait un endroit où je pouvais faire mes armes et vivre quelque chose d’autre, c’était à la Comédie-Française. Pour insuffler les sept prochaines années, j’avais presque besoin d’un temps zéro, pour me re-confronter au texte. C’était une manière pour moi de faire le bilan. Là où un an avant ça ne paraissait pas s’inscrire dans ma démarche, c’est soudain presque devenu un besoin. J’en avais très envie. Comment s’est déroulée la rencontre avec ces nouveaux comédiens et comment avez-vous affirmé votre manière de travailler ? C’était nouveau pour eux comme pour moi. Eux n’avaient pas l’habitude de ma méthode mais moi je n’avais pas l’habitude de travailler avec des acteurs qui ne connaissent pas ma méthode. Donc on va dire qu’en termes de nouveauté, on était à cinquante-cinquante. J’ai choisi mes acteurs. Cela avait été une des conditions de choisir mes textes, mes acteurs, la salle. Je les ai rencontrés, auditionnés. Il fallait qu’ils soient très proches du personnage mais aussi qu’au-delà du projet de Vania ils aient envie d’improvisation, d’écriture de plateau. Une fois l’équipe constituée, avec ma méthode, il a fallu qu’on trouve notre méthode. Je suis arrivée avec toute mon équipe technique d’In Vitro. Plutôt que d’arriver en force, on a essayé d’inventer une méthode commune. Ça a été assez génial mais cela a aussi demandé beaucoup de travail. Qu’avez-vous redécouvert à leur contact ? Déjà, ils sont très joueurs et ils ont une force de travail, même si, au départ, ils n’étaient pas habitués à nos codes. Et puis ils vont vite, ils s’adaptent vite. Il y avait quelque chose de très agréable à goûter et à redécouvrir au bout de sept ans ; cette nouveauté, le fait de devoir se reconquérir. Et ils pensent spectacle aussi là où nous on est écriture de plateau. Le spectacle paraît tellement loin quand on a tout à créer qu’on y pense tardivement. Eux, ils y pensent, ils font des premières tous les deux mois, ce qui est incroyable. Le cerveau pense vite à là où il faut aller. Après, moi, je les déstabilisais en leur disant que je ne leur donnerais pas le texte définitif avant le jour de la première, ce qui les rendait fous. Je ne voulais rien fixer tandis qu’eux voulaient fixer. Cette rencontre-là m’a beaucoup appris. Cela m’a fait bouger et me rendre compte aussi que penser spectacle, avoir les choses un peu plus rapidement, c’était peut-être pas grave, au contraire. Y a-t-il toujours une part d’improvisation dans ce spectacle ? Il y a quatre-vingt-dix pour cent de texte et une part ouverte à l’improvisation. Mais comme dans les répétitions, finalement, on est plutôt parti du texte pour aller vers l’improvisation que l’inverse, ce que l’on fait dans In Vitro. C’est ce que je voulais dans un premier temps et c’est pour ça que je dis que j’ai changé mes méthodes avec eux. Ce qu’il reste d’improvisation, c’est ce qui s’est imposé et ce qu’ils ont eu la liberté de faire. Ça bouge d’un soir à l’autre. Cela reste ouvert plutôt sur la forme, les déplacements. Après, il y a beaucoup de choses qui reviennent chaque soir parce qu’ils ont choisi de le refaire et que cela me va. C’est là où moi je suis la garante du spectacle en assistant à chaque représentation et en restant vigilante à ce que cette forme-là ne s’arrête pas d’exister. Dans quel but avez-vous utilisé la vidéo pendant les répétitions ? Je leur ai demandé de tourner des petits films de dix minutes où ils pouvaient passer de leur vraie vie à leur figure, de leur réel à l’improvisation, à l’écriture de Tchekhov. Je leur ai demandé cela aussi pour leur faire comprendre que je ne travaillais pas avec l’idée d’un metteur en scène tout-puissant. On allait ouvrir la répétition avec la projection des films qu’ils avaient tournés et l’idée de création collective allait donc être présente puisque c’étaient eux qui allaient ouvrir le bal des répétitions. Et pendant un mois, ils se sont appelés entre eux pour leur tournage. Cela me plaisait que le projet leur appartienne et je le sens encore aujourd’hui lors des représentations, il y a quelque chose de l’équipe qui est très soudé. Vous avez utilisé également des objets ? Et après, en termes d’objets, j’ai amené beaucoup de choses de réelles. Sous la Comédie-Française, c’est une sorte d’énorme Emmaüs. On a fait des gros repas. On se mettait dans des situations de partage collectif pour parler de cette communauté-là. Donc il y avait beaucoup d’objets, beaucoup de musiques, beaucoup de choses qu’on a enlevées par la suite. Il ne reste que ce qui joue mais au départ il y avait le plus de choses possible pour essayer de faire naître la vie autour de cette table. Donc vous avez été amenée à faire des sélections ? Le plateau surtout a fait des sélections. C’est un peu cruel dans ce genre de méthodes. Parce qu’il suffit que quelque chose soit un peu trop brillant, que ça marche un peu trop, alors on sent que cela dépend d’une mise en scène et que c’est trop fort pour la forme que je défends. Il y a des choses qu’on a aimées mais qu’on a supprimées trois jours avant la première et parfois des petites choses qui se sont imposées ou qui sont même arrivées le jour de la générale. De même pour les morceaux de musique improvisés, jusqu’à la première. On ne les a jamais travaillés, ça a toujours été différemment, et à présent, le morceau de musique qu’ils font en spectacle, ils ne l’ont fait qu’en spectacle. Le texte aussi a continué à bouger deux jours avant la première. C’est vrai que c’est étonnant de voir que c’est le plateau qui décide plus qu’une sorte de best of de ce qui a le mieux marché. Et comment le choix du plateau s’est-il porté sur le film Vampyr ? Je me suis demandé ce que pouvaient faire aujourd’hui des gens qui s’ennuient à la campagne. J’ai trouvé l’idée d’un ciné-club amusante. J’ai donc décidé de leur ramener des vieux films. Le premier était Nosferatu, pour que chacun ressente le démon, pour s’enfoncer dans cette nuit qui suivait. Ensuite, j’avais pensé à Un Chien andalou de Buñuel car je voulais des choses plus surréalistes. Puis j’ai amené Vampyr de Dreyer et c’est le film avec lequel ils se sont le plus amusés. C’était un outil de répétition qui, finalement, est allé jusqu’au spectacle. Et ça reste une séquence où ils improvisent. Il m’a semblé intéressant aussi que la fiction et le théâtre arrivent par le cinéma, moi qui suis venue à la mise en scène par le cinéma. Et de dire que les spectateurs allaient assister peut-être à la partie la plus théâtrale alors qu’avant ils regardent vraiment un film. Cela m’amusait beaucoup ! Vous avez monté Lagarce, Brecht. Pourquoi aujourd’hui Tchekhov ? C’était assez évident. Je pense qu’à l’époque où j’ai monté Lagarce, j’aurais peut-être pu choisir Tchekhov. Mais je n’étais pas prête. Je sentais que si je m’attelais à cet auteur, il fallait que je m’y attelle réellement, d’où aussi ce projet à la Comédie-Française. S’il y avait une pièce que je pouvais vraiment monter telle quelle, qui me fascinait depuis des années, c’était Oncle Vania. Cette pièce m’accompagne depuis Derniers remords avant l’oubli. Cela maturait. Qu’est-ce que vous aimez en particulier dans cette pièce ? Je crois que j’aime tout. J’aime les figures, le huis-clos, cette vente de la maison, le fait qu’il y ait une génération confrontée à une autre, des gens de quarante-cinq ans qui se sentent déjà vieux face au professeur qui lui se dit vieux mais qui est le seul à jouir de la vie… En fait, ce sont des problématiques que j’avais déjà travaillées quand j’avais fait le triptyque. Et puis c’est une des pièces les plus courtes de Tchekhov. Cela se joue sur un été et on pouvait parler, alors que cela se passe tout autour d’une table, de la fin d’un monde que questionne toujours Tchekhov. Et je la trouvais fascinante de simplicité. Il y a une vraie simplicité chez Oncle Vania, par rapport à d’autres pièces comme Les Trois sœurs, Ivanov, et donc aussi un rapport à l’humanité comme chez Lagarce. Vania était une poursuite de presque tout ce que j’avais cherché jusque-là, de ce travail-là. C’était vraiment comme une évidence. Quels sont, selon vous, les écueils qu’un travail sur Tchekhov doit éviter ? Je n’ai pas la prétention de le savoir car je pense que c’est une histoire de points de vue. Mais j’ai toujours dit à mes acteurs qu’on peut travailler l’ennui sans s’ennuyer et sans ennuyer le spectateur. C’est mon leitmotiv. Je voulais pousser la réussite le plus longtemps possible pour que la chute soit plus violente, tuer l’ennui le plus longtemps possible afin que, si l’on arrête un tout petit peu, on se rende compte du vide, plutôt que de jouer des gens qui se languissent et qui se plaignent toute la journée. C’est mon dada de traiter la vie le plus longtemps possible pour arriver à une forme de violence plutôt que de mélancolie. Les gens qui tuent le temps, quelque part, ce sont des gens qui n’ont rien à faire ensemble. C’est terrible, donc c’est violent quand ils s’en rendent compte. Mais je n’aime pas les personnages qui se rendent compte de ce qui leur arrive. Plus ils sont en action, plus ils chantent et font la fête, moins ils se rendent compte que, s’ils s’arrêtent, ils vont juste pleurer dans leur chambre. Et chez Tchekhov, je trouvais qu’il y avait une force de vie. Je trouvais ça très drôle aussi. Alors ça peut l’être ou ne pas du tout l’être. Mais dans cette dimension de l’hyper-vivant, même si c’est désespéré, le rire arrive. C’est quelque chose que j’ai eu envie de traiter tout de suite. Je peux très bien aimer du Tchekhov joué différemment mais je ne serais pas capable de le monter différemment. Vous êtes plus dans une démarche de révélation que de chercher à transformer ou à imposer ? Oui voilà, tout à fait. Et je suis assez instinctive dans le travail. Je m’ennuie très vite aussi. Et il y a une telle force de sentiments dans cette pièce que je trouvais vraiment dommage d’être dépendant des mots. Les mots devaient selon moi arriver comme une évidence, comme si on le faisait en improvisation. Donc je leur disais que c’était à eux en fait de diriger le texte et non au texte de les diriger et que, s’ils l’avaient dit en improvisation, ils l’auraient fait de la même manière, en moins bien. Voilà. Comment avez-vous choisi et remanié la traduction ? Elle est des années 1980 donc elle est très orale, elle est moins brute, elle est moins poétique que d’autres traductions, je pense à Markowicz. J’ai contacté Tonia Sermonne pour savoir si je pouvais travailler à partir de celle-ci tout en élaguant certaines choses, comme le rapport à la Russie ou le rapport à des choses trop datées comme “est-ce que la calèche est prête ?”, et pour en faire une forme, non pas que je voulais moderniser avec des téléphones portables, mais pour imaginer que ça puisse se passer aussi bien en Russie qu’en France, aussi bien dans les années 1950 qu’aujourd’hui. Tchekhov met en scène des personnages qui se sentent en marge, souvent en province. Quel sens donnez-vous à la mise en scène de ce spectacle à Paris, à la Comédie-Française, qui représente un lieu central, en apparente opposition ? C’est vrai. C’était exactement comme a fait Louis Malle avec Vanya, 42e rue où il filme New York au début des années 1990 et tout à coup il entre dans une salle de répétition et il tombe dans la pièce de Tchekhov. Je crois que ça m’amusait énormément de parler de la province, de gens enfermés dans une province, alors je sais pas laquelle, mais tout d’un coup on pourrait très bien penser au film de Depardon (Profils paysans) sur toute la question paysanne en France, en sachant qu’on était en plein VIe arrondissement et qu’autour, de part et d’autre du plateau, il y avait des gens de 2016. Donc le côté citadin, le côté parisien, à la Comédie-Française en plus effectivement, et Tchekhov au milieu ; cette confrontation, c’est tout le projet en fait. Il s’agit de parler de nous sans mettre en scène des gens à Paris qui jouent leur propre personnage du tout. Parce que nous, c’est complètement l’inverse. Et les questions sont plus grandes que cela et beaucoup plus sociétales. Donc je leur disais toujours qu’il fallait qu’on donne la sensation que tout le monde est assis dans cette grande maison et qu’en même temps, si on ouvre la porte, on a la rue, on a des voitures. Tout cela n’est que de la fiction qui parle du réel en fait. Donc, tant mieux s’il y avait cette étiquette Comédie-Française qui était vraiment en opposition avec l’œuvre. Justement, il y a une vraie porosité entre la fiction présente et la réalité dans ce spectacle. Est-ce quelque chose que vous avec souhaité dès le départ ? Oui, surtout à la Comédie-Française. J’avais vraiment envie qu’il puisse y avoir quelque chose des personnages dans chaque acteur. Mais si j’ai fait le dispositif bi-frontal, ce n’était pas seulement pour que les gens se sentent à table avec les comédiens. Mais aussi pour que, même si on est dans la fiction, la fiction ne prenne jamais non plus le pouvoir sur le réel, tout comme on ne dénonce pas le quatrième mur. Pour moi, on était vraiment dans une histoire. Mais dès que le théâtre prenait trop de place, dès que l’auteur s’imposait trop, je leur disais toujours que cela n’était pas possible et qu’il fallait que la forme soit plus complexe que cela. Il fallait que le spectateur ne soit jamais content dans son siège. C’était tout le défi du travail, raconter une histoire sans être enfermé dans le confort d’une histoire théâtrale avec un rideau rouge. Avez-vous d’autres projets en cours ? En automne prochain, je fais une création qui s’appelle Mélancolies qui va mêler Les Trois sœurs et Ivanov de Tchekhov, avec un travail d’écriture de plateau. C’est un peu la suite de Vania. Au lieu qu’il y ait quatre-vingt-dix pour cent de texte et puis dix pour cent d’écriture de plateau, cela sera de l’ordre de soixante-quarante. Et je travaille sur une adaptation des deux œuvres. C’était la suite logique. Là, j’essaye de faire rencontrer sur un projet les deux formes. On commence les répétitions et le spectacle sera créé en automne prochain. Avez-vous des conseils, des pistes, à partir de votre expérience, pour les jeunes artistes, que défend Artistik Rezo, qui désirent percer dans la profession ? Cela n’est pas facile pour les jeunes. Peut-être de ne pas le faire tout seul, parce que sinon on s’épuise et parce qu’on est aussi dans des réalités, il faut payer son loyer… Je pense que, quand on est ensemble, on arrive à collectiviser une pensée et à unir ses forces. Dans un groupe de douze, quand il y en a trois qui ne vont pas bien, cela ne se voit pas. Quand on est tout seul, ces projets sont lourds à porter parce qu’au départ c’est une utopie, on part de rien et il faut y croire. Ensuite, je crois que c’est la persévérance. Il ne faut pas avoir peur que cela ne vienne pas tout de suite. Parfois, les percées sont très fulgurantes. On peut monter quelqu’un et le redescendre très vite. Je crois aussi que le fait de prendre le temps de développer un projet, c’est prendre le temps d’asseoir son identité et ne pas prendre le risque d’être attiré tout de suite par la lumière. On apprend de toutes les critiques mais c’est important de ne pas être trop pressé et en même temps d’être affirmé dans sa pensée sinon c’est très vite décourageant. Et de jouer. Je me suis beaucoup battue pour jouer, je trouve qu’il y a beaucoup trop de projets où les gens ont un désir de création, c’est évidemment génial de répéter, mais les projets sont joués deux fois. La moyenne, c’est deux dates pour les spectacles en France, c’est monstrueux. Si j’avais fait ça, je pense que je ne serais pas là aujourd’hui. Je me suis battue pour que Lagarce se joue. C’est en voyant Lagarce joué, en voyant les difficultés parfois qu’on rencontrait en jeu que j’ai appris et que j’ai voulu monter les autres spectacles. Et aujourd’hui, en sept ans de compagnie, on n’a jamais fait de dernière. Alors oui, c’est vrai que quand on finit un spectacle on a presque envie de retourner tout de suite à un autre spectacle. C’est dur de faire de la diffusion, de la production, mais c’est important parce que montrer son travail, même si, parfois, il n’est pas encore abouti, le jouer, déjà, c’est être payé, c’est une manière de se professionnaliser et c’est une manière d’être dans la réalité du paysage théâtral français. C’est se demander comment inscrire son travail sur le territoire, les actions artistiques, toutes ces choses qui font qu’une compagnie prend vie. Quand on démarre, on a juste envie de faire des spectacles, parfois on peut continuer de le faire mais ne pas sortir de son garage. Jouer, je pense ! Propos recueillis par Jeanne Rolland -> La critique du spectacle : Vania ou Tchekhov parmi nous
[Photo Julie Deliquet et la troupe, Théâtre du Vieux-Colombier © Simon Gosselin, collection Comédie-Française] |
Articles liés

Découvrez les artistes diplômés du Centre National des Arts du Cirque à La Vilette
Rendez-vous incontournable avec la relève du cirque, ce spectacle sous chapiteau à La Villette est l’occasion de découvrir les artistes tout juste diplômés du CNAC – Centre National des Arts du Cirque. Pour les jeunes talents qui arpentent la...

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo
La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Justice livre un show explosif et festif à l’Accor Arena de Paris Bercy
Ce mardi 17 novembre 2024, après une première partie orchestrée par Pedro Winter, boss du label Ed Banger, Justice a électrisé une salle pleine à craquer, première date des deux soirées prévues à Paris, chez eux, à domicile. La...




 D’un travail d’écriture collective de plateau, au sein de son collectif In Vitro, à une adaptation d’Oncle Vania de Tchekhov, à la Comédie-Française, dont a enfanté le spectacle
D’un travail d’écriture collective de plateau, au sein de son collectif In Vitro, à une adaptation d’Oncle Vania de Tchekhov, à la Comédie-Française, dont a enfanté le spectacle