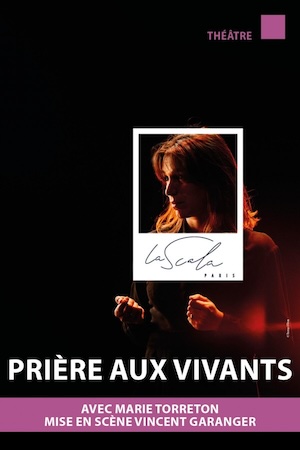“House” : métaphore tragique d’Israël par Amos Gitai à la Colline
© Simon Gosselin
Le réalisateur israélien Amos Gitai revient au théâtre avec l’adaptation pour la scène de son film documentaire réalisé en 1980. Revenant sur les traces de cette maison de Jérusalem Ouest, Gitai y rencontre tous ses habitants depuis le début du vingtième siècle, un voyage historique, géographique et très politique. Pas sûr que ce spectacle fasse vraiment avancer la situation au Proche Orient, mais il a le mérite, à travers la vision d’un chantier à ciel ouvert, de poser les termes d’un lourd conflit, ancestral et chargé d’émotions contradictoires.
Echafaudages
La scène est un immense chantier sur lequel deux grands échafaudages dressent leur architecture de métal. Rappelons que le concepteur du spectacle est architecte de formation et qu’il ne cesse, à travers ses oeuvres, de fouiller les traces architecturales et mémorielles de son pays. A l’avant-scène, deux ouvriers palestiniens taillent des pierres énormes et cimentent un muret. Leur ouvrage, sans cesse recommencé, avec de la sueur et des larmes, propulse les Palestiniens à l’avant-scène d’un spectacle où vont défiler les autres habitants de Jérusalem, chacun racontant sa propre histoire autour de cette maison que l’on construit et reconstruit au fil du temps. Le spectacle d’Amos Gitai se présente donc comme une archéologie du souvenir, et va donner successivement la parole à tous ceux qui sont en lien avec cette maison, en revendiquent une appartenance, nationale, historique, mémorielle.
Une maison collective

© Simon Gosselin
Dans les années 1930, on construisait de grandes maisons, à Jérusalem et à Tel Aviv, partagées pas de grandes familles. Il n’était pas rare que la cuisine soit collective, parfois la salle de bain. Il en va tout autrement aujourd’hui, où l’immobilier en Israël culmine à des niveaux financiers incroyablement élevés, et où chaque pierre symbolise de l’argent. Pour le promoteur israélien incarné en hébreu par Micha Lescot, il faut que la roue tourne et l’argent sert à bâtir, plus large, plus haut. Point de scrupule à exiger ce qu’il est difficile d’obtenir en si peu de temps, les ouvriers palestiniens n’ont qu’à poursuivre leur travail, même si soudain l’un des deux prend la parole pour raconter comment sa famille a été dépossédée de son logement, grâce à la « loi sur la propriété des absents ». On apprend alors qu’en 1948, date de la création d’Israël, la maison appartenait à un médecin palestinien Mahmoud Dajani qui a du fuir. La tristesse, la rage habite soudain ces visages jeunes dont les yeux racontent la dépossession d’un lieu de vie. Puis c’est au tour d’Irène Jacob, qui joue une femme d’origine turque, de raconter son attachement à cette maison, son lieu d’ancrage culturel après tant d’errances, sans connaître parfaitement l’hébreu. De la Turquie à la Suède, d’Istanbul à Stockholm, cette maison dessine un retour aux origines avec son lot de souffrances et de joie.
“Nous n’avons pas fait l’histoire”

© Simon Gosselin
Ce terrible aveu d’impuissance ressort des témoignages réels d’habitants de Jérusalem, placés dans la bouche des acteurs sur le plateau. Micha Lescot incarne Michel Kishka, un artiste petit-fils d’une famille de déportés à Auschwitz, dépositaire de la mémoire tragique des Juifs d’Europe Centrale, et qui décide de quitter Bruxelles pour s’installer en 1978 à Jérusalem, dans la rue Dor Dor VeDorshav, une rue chargée d’histoire, qui a entendu parler allemand -avec des colonies allemandes venues au début du 20° siècle-, arabe, anglais, yiddish, hébreu. Une jeune femme américaine juive orthodoxe, coiffée d’un grand foulard, pénètre dans le bain rituel avant son mariage, en évoquant son retour à la Terre Promise, alors que la même actrice, Bahira Ablassi, qui a tourné avec Amos Gitai dans Laila in Haïfa, campe une jeune palestinienne obligée de rester silencieuse par peur de l’hostilité envers les Arabes. Il y a des phrases terribles, reprises par la voix des acteurs, « Je les hais comme ils me haïssent, mais je suis obligé de travailler ici. Nous sommes prisonniers de ce pays » disent ces jeunes palestiniens. Les récits s’enchaînent, les paroles se succèdent, mais sans jamais hélas que les regards ou les voix ne se croisent, ne communiquent. Seuls les formidables choristes, dirigés par Richard Wilberforce, s’accordent par leur chant a capella. Un terrible aveu d’impuissance nous submerge alors, après deux heures trente de spectacle, sur un bout de terre aujourd’hui encore en proie aux extrémistes de tous bords.
Hélène Kuttner
Articles liés

Barkanan en concert, la folk s’invite aux Étoiles !
Delco music présente Barkanan aux Étoiles à Paris ! Barkanan, c’est Ianis et Léo, deux frères auteurs-compositeurs, multi-instrumentistes, qui explorent une folk dont l’atmosphère intimiste enveloppe la voix haut perchée de Ianis. Quant au piano, à la batterie et...

“The Gazer”, un thriller psychologique au cinéma le 23 avril
Frankie est atteinte d’une maladie dégénérative qui l’empêche de se repérer dans le temps. Encline à la paranoïa et sujette à des pertes de consciences fréquentes, elle enregistre des messages sur des cassettes pour se repérer et assurer sa...

Jordana en concert au Popup du Label
Jordana Nye, 24 ans, est une artiste caméléon qui refuse de se laisser enfermer dans un style. Révélée en 2020 avec Classical Notions of Happiness, un mélange de pop lo-fi et de folk intime, elle a depuis exploré l’indie...