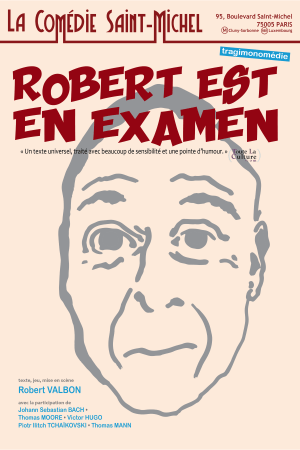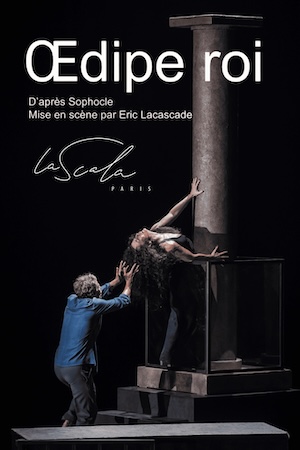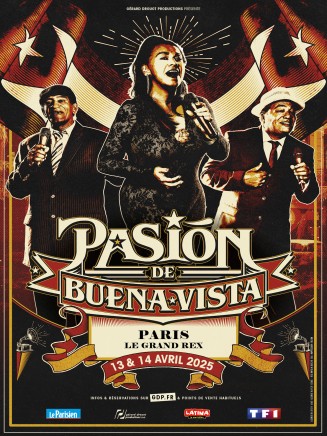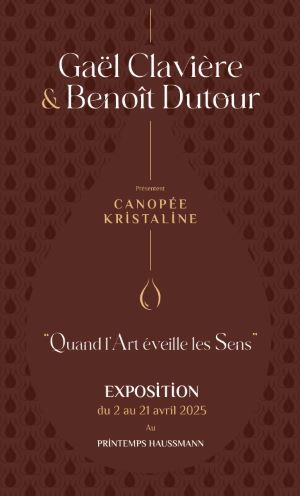Balanchine-Teshigagawara-Bausch : le souffle du présent
C’est un trio particulièrement réussi que propose actuellement l’Opéra de Paris en présentant « Agon », météorite de Balanchine (1957), « Le Sacre du Printemps » de Pina Bausch (1975), deux oeuvres du compositeur russe Igor Stravinsky, ainsi que « Grand Miroir » du Japonais Saburō Teshigawara (2009). Une progression à grande vitesse dans la modernité des chorégraphies les plus marquantes de ces dernières années, avec en prime le magnifique concerto pour violon d’Esa-Pekka Salonen, compositeur et chef-d’orchestre de cette exceptionnelle soirée.

Ascension vers la modernité
Qu’y a t-il de commun entre « Agon », ballet « IBM » qui rappelle les quadrilatères de Mondrian et déploie une dynamique d’une précision de métronome électronique, « Le Sacre du Printemps » et la violence tellurique d’un rite sacrificiel, et « Grand Miroir » où le Japonais Teshigawara fait se mouvoir en toute liberté des corps d’entre les mondes, soumis aux simples lois de la nucléarité ? Rien à priori, tout au final. George Balanchine crée « Agon » sur une composition de Stravinsky « destinée à réveiller les Dieux » en 1957, avec une suite de danses françaises traditionnelles chronométrées en un découpage de 20 minutes en tout. Deux pas de trois succèdent à un pas de deux, dans un vent d’énergie jazzy et new-yorkaise, mais régis par les contraintes mathématiques d’un ordonnancement rigoureux. Le jeu d’enfant ici est démoniaque car les jeunes danseurs ressemblent à des marionnettes désarticulées dont les bras et les jambes se meuvent en autonomie. Les danseurs nouvellement étoilés, Germain Louvet et Hugo Marchand, rayonnent de beauté et de noblesse, Dorothée Gilbert sourit d’être si bien entourée et Myriam Ould-Braham, nerveuse et mutine, gracile et aérienne, coquine et sensuelle, fait de son pas de deux avec Hugo Marchand un réel moment de grâce.

Du soleil vers la nuit transfigurée
Autant « Agon » place le spectateur en face d’une expérience cabalistique, une performance stylistique qui tend vers la perfection des mouvements dans des lumières solaires, des costumes en noir et blanc, autant le « Grand Miroir » nous plonge ensuite dans un entre deux mondes où le chorégraphe Saburō Teshigawara va projeter des silhouettes fantastiques sur le fil d’un déséquilibre constant. Plus de lignes ici, plus de géométrie à la symétrie parfaite. Seul le souffle de la respiration, le lâcher prise et la retenue gouvernent des corps qui se ploient et de déploient comme de la glaise. Corps gris comme extraits du centre de la terre, lutins androgynes au visage vert et aux cheveux carotte, feu follets d’humanité d’après la catastrophe qui ressuscitent en vrillant, en tournoyant de tous leurs membres, en transe, dans des lumières spectrales. Seul fil conducteur, le violon d’Akiko Suwanai percute l’espace à la vitesse de la lumière, entre les vagues orchestrales qui dessinent un océan de tonalités, en écho à Stravinsky. Esa-Pekka Salonen réussit une petite merveille sonore, quand Teshigawara imprime son univers chorégraphique à partir du poème « La musique » de Charles Baudelaire : « la musique me prend comme une mer … ». Emilie Cozette, Mathieu Ganio, Germain Louvet, Héloïse Bourdon, Lydie Vareilhes, Juliette Hilaire, Amélie Johannidès, Grégory Gaillard, Antonio Conforti, Julien Guillemard, ils sont tous formidables dans ce rêve cauchemardesque et stellaire.

Un Sacre époustouflant
Après un entracte ou le rideau de fer levé, nous pouvons admirer le travail des techniciens déversant des kilos de terre brune s’échappant d’énormes bennes, le spectacle se clôt par le « Sacre du Printemps » de Stravinsky dans la chorégraphie de Pina Bausch. Bien entendu, c’est une oeuvre qui est souvent présentée, qui nous obsède et nous effraie en même temps. Mais il faut avouer que cette fois encore, la sorcellerie de cette composition au rythme démoniaque, la puissance des percussions et des cuivres de l’orchestre, que Salonen conduit avec brio, nous captivent totalement. Il se trouve aussi que Pina Bausch, se saisissant dans les années 70 de ce poème musical organique en forme de rite russe païen – le sacrifice d’une jeune fille en l’honneur du Printemps – le transforme en rituel de possession sexuelle où une meute d’hommes encercle, pour la dominer, un flot de femmes apeurées, tremblantes d’effroi et se repassant la fameuse robe rouge, couleur de sang, qui désignera la jeune fille violée. Aujourd’hui, à l’heure où l’intégrité de la femme est souvent mise à mal, cette oeuvre résonne particulièrement. L’engagement des danseurs, des danseuses, est total. Et il y a Eleonora Abbagnato, que Pina Bausch dirigea lors de la création de cette oeuvre en 1997. Elle est éblouissante, unique, fantastique. Une étoile au firmament qui déchire l’espace.
Hélène Kuttner
[Crédits Photos : © Agathe Poupeney]
Articles liés

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie
Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...

“GRAFFITI X GEORGES MATHIEU”, avec JonOne, Lek & Sowat, Nassyo, Camille Gendron et Matt Zerfa à la Monnaie de Paris
En parallèle de l’exposition monographique des salons historiques, La Monnaie de Paris a souhaité montrer les échos de l’œuvre de Georges Mathieu dans les pratiques et les gestes artistiques de l’art urbain en invitant des artistes du graffiti de...

“Voltige” : le nouveau single du pianiste virtuose indie pop Mathis Akengin
Dès son plus jeune âge, Mathis Akengin a développé un lien profond avec le piano, ce qui l’a conduit à un parcours musical éclectique. Après des années de formation classique, il a élargi ses horizons au blues-rock, à la world-soul et au jazz, collaborant avec...