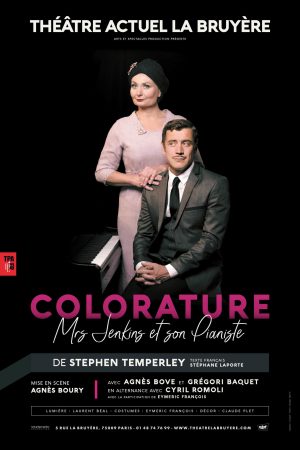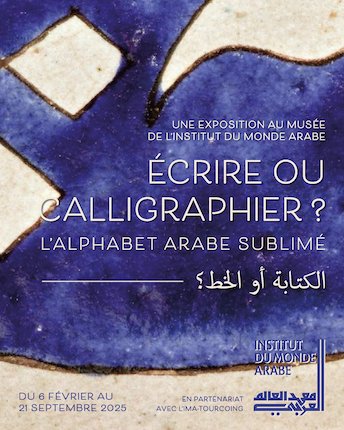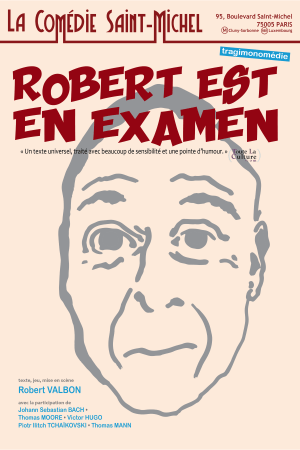Jean-Baptiste Leonetti – Carré blanc
Comment avez-vous été formé au cinéma ?
Je me suis formé au cinéma ! Regarder beaucoup de films, en tant qu’enfant et adolescent, était central dans ma vie : au lieu d’aller à l’école, j’allais au cinéma. J’ai toujours trouvé que les images étaient plus importantes que les mots. Très tôt, j’ai fait de la photo, ce qui constitue l’antichambre du cinéma, car quand vous faites de la photo, vous avez envie, au bout d’un moment, qu’elle s’anime. J’ai arrêté l’école assez tôt, et j’ai commencé comme assistant, à droite, à gauche, vers 17 ou 18 ans, mais ça ne me convenait pas. Je suis retourné dans une toute petite école de cinéma, l’EFET, et j’y ai passé trois ans avec des copains qui voulaient tous faire du cinéma. L’école était située en bordure de Paris, dans un quartier un peu chaud. J’y ai réalisé neuf films, et je suis sorti major de la promotion. Puis à l’armée (je faisais partie de la dernière génération des appelés), par un coup de chance, l’un des membres du jury était le patron des monteurs au cinéma des Armées. Il m’a recruté et pendant un an, j’ai monté des trucs aussi dingues qu’un assemblage de porte-avions, ou de sujets sur de Gaulle, ou 1914-1918. Suite à ça, j’ai réalisé des documentaires, mais j’avais toujours cette envie de faire du cinéma. En dix ans, j’ai tourné une cinquantaine de spots publicitaires. Puis j’ai réalisé mon premier moyen-métrage, Le Pays des ours, en 2004, qui a bien fonctionné, et j’ai enchaîné sur Carré blanc.
Comment s’est passée la transition du moyen au long-métrage ?
J’ai réalisé Le Pays des ours par défaut ! Je voulais faire un long-métrage d’entrée. Je pensais qu’après cinq ans de pub, je pouvais me coltiner au format long, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise idée, car cela dépendait de mon niveau de maturité, et de la façon dont j’allais dire ce que j’avais dire. Il faut un petit peu de temps pour se désintoxiquer de l’esthétique de la pub, et aussi de l’idée que la réalisation est une science exacte.
Quand je me suis mis à écrire, ce qui a pris du temps, plusieurs choses sont entrées en jeu, notamment le fait que le film ne devait pas coûter cher, sinon il aurait été inmontable, du fait de la radicalité de son sujet. C’était donc un jeu entre la frustration nécessaire sur certaines séquences (ce qui m’intéresse énormément) et le fait de coûter de l’argent. Et puis au fur et à mesure, j’ai réussi à trouver une forme d’équilibre. J’ai réécrit le scénario pendant la préparation du tournage, et j’ai du me confronter à la réalité. À ce moment-là, le budget est le budget ; en tant que co-producteur du film, je savais exactement où l’argent allait être mis.
Quelles sont les influences que vous vous reconnaissez ?
Mon cinéma est celui des années 1970, aux États-Unis : si vous regardez l’affiche, elle pourrait sortir directement de cette époque. Mon cinéma est celui de Pakula, Peckinpah, Pollak, Shlesinger… Mon film de référence a toujours été Marathon Man, et Klute aussi. Plus tard il y a eu Kubrick, mais je pense que pour l’apprécier il faut un peu de temps… par contre, une fois rentré dedans, difficile d’en sortir !
De même, j’ai été influencé par la photo, chaque cadre dans Carré blanc a été conçu en harmonie avec ce médium ; je pense aux photographes de guerre des années 1970, comme Don McCullin, ou bien des plus anciens comme Eugen Smith. Ou alors des artistes plus poétiques comme Stephen Shore, ou Richard Ecclestone… Les images du film sont assez cliniques, j’ai essayé d’aller au maximum dans la simplicité. Il ne faut pas se leurrer sur l’importance de l’imprégnation du cadre, qui est souvent tributaire du montage. Le montage a été conçu avec un principe de frustration, selon lequel, lorsque on était satisfait du plan, on établissait une frustration pour que le spectateur ait envie de voir le prochain cadre. Le film est lent, mais très découpé : il fait plus de 1’500 plans, ce qui est énorme.
Comment avez-vous géré la direction d’acteur, dans ce film où les dialogues sont minimalistes ? Quelles consignes avez-vous donné à Sami Bouajila et Julie Gayet ?
C’est tout le problème d’un premier film : il faut revendiquer des influences et s’en affranchir. Si vous dites à un acteur « Voilà ce que je vais faire », vous allez le paralyser, car il va penser avoir affaire à un copiste. Ce qui m’intéresse chez lez acteurs, c’est la sobriété et la justesse, deux mots forts que nous avons gardé comme un cap, tout au long du film. L’absence de dialogue est compensé par le geste, l’attitude, les regards. Quand on voit Donald Sutherland dans Klute, il est sobre à l’extrême et toujours juste. Ici aussi, je voulais que la justesse de Sami Bouajila et Julie Gayet se nourrisse de leur sobriété et inversement.
 Certaines séquences sont très marquantes, comme les tests de personnalités durant les sessions de recrutement. Comment avez-vous travaillé sur le sujet ?
Certaines séquences sont très marquantes, comme les tests de personnalités durant les sessions de recrutement. Comment avez-vous travaillé sur le sujet ?
Je n’ai heureusement rien vécu de ça, car j’ai fait ce qu’il fallait pour ne pas tomber dans un cirque comme celui-ci. Je me suis inspiré de la réalité, de témoignages de gens que j’ai connus. En revanche, j’ai poussé la chose à l’absurde, en proposant un monde aux solutions aberrantes mais possibles. Ces solutions existent parce que ce monde existe aussi. Ce qui m’intéressait particulièrement, outre l’autorité et la façon de faire faire n’importe quoi, à quelqu’un, n’importe comment, c’était que les solutions étaient aussi stupides que les tests eux-mêmes. Donc on se cassait la tête à trouver des tests plus improbables les uns que les autres, avec des débats surréalistes sur le tournage !
Le film de genre n’est pas très bien accueilli en France, considérez-vous que ce film d’anticipation puisse échapper à la règle ?
J’ai une cinémathèque très éclectique, de Carpenter à Tarkovski ; je ne connais pas de mauvais genre. Je ne connais que des films bons ou mauvais. Le mauvais genre, c’est pour les bourgeois. Films de genre, ça ne veut rien dire ! On a un problème avec l’anticipation en France, je n’en ferai pas une maladie. Je n’ai pas les moyens, ni l’envie, d’aller contre ce système. Je n’ai pas la prétention d’ouvrir une voie, mais peut être que certaines personnes qui hésitent, en voyant le film, se diront que c’est possible. Ma chance a été de ne pas savoir qu’en France, on ne peut pas faire ce genre de films. Je ne suis pas le seul à savoir mettre une caméra dans une pièce, à vouloir raconter des histoires différentes de celles qui se font ; le seul problème est celui-ci : « Jusqu’où êtes vous prêt à aller pour réaliser ce film ? » Il ne faut pas anticiper les réactions face à ce genre de film au départ, sinon vous ne le ferez jamais. C’est un parcours très long, semé d’embûches, au cours duquel vous allez braver de nombreuses interdictions. Les scores ne seront sans doute pas énormes, l’interdiction au moins de 16 ans a été relativement assassine en ce qui concerne la distribution. Nous n’avons pas compris, car il n’y a pas une goutte de sang dans le film. Seule la violence psychologique explique ce classement, totalement subjectif. Ça n’arrive jamais, mais ça nous est tombé dessus…. Cependant de nombreux exploitants le sélectionnent, parmi les meilleures salles de France : Le Saint-André-des-Arts, le Méliès, le Majestic de Lille… L’exploitant du Saint-André-des-Arts m’a dit : « C’est un vrai film d’auteur, c’est-à-dire qu’il n’aurait pu être fait par personne d’autre que vous-même ! »
Le film est-il destiné à un public international ?
Les capitaux du films sont luxembourgeois, belges, russes et suisses, mais Canal + et Cinécinéma ont mis aussi un peu d’argent. Les anglo-saxons sont très intéressés par le film, d’ailleurs il est sélectionné au festival de Toronto dans la section « The Vanguard », qui se consacre à la remise en question la narration, mais également à Austin, le plus grand festival fantastique des USA. Il est également sélectionné à Sitges, en Espagne mais bon, les Espagnols sont des sauvages, on devrait pouvoir travailler avec eux (sourires).
Quelles ont été les premières réactions du public auquel vous avez montré le film ?
Nous avons organisé des projections pour les bloggueurs, qui constituent un public exigeant et radical, avec une culture cinématographique assez large. Et c’était délirant, les critiques tombaient, dithyrambiques. Alors que les critiques officiels redécouvrent des réalisateurs 25 ans plus tard, comme les Cahiers du Cinéma qui ont défendu Carpenter tardivement après l’avoir sabré, ces bloggueurs ont une culture érudite et livresque impressionnante. Je savais dès le départ qu’il n’y aurait pas de moyen terme : soit ce serait phénoménal, soit je me ferai assassiner. Je souhaite juste qu’il n’y ait pas trop de « bof, je sais pas ». Je peux entendre qu’on rejette totalement Carré blanc, mais je supporterai moins bien des sentiments mitigés.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la fin ?
La fin peut être reçue différemment selon que le spectateur est pessimiste ou optimiste. C’est en tout cas une réflexion sur ce qui reste quand on s’est rendu compte que la société, la politique, la philosophie ne sont que des mots et des abstractions. Nous avions tourné plusieurs fins, dont une énorme séquence dans une forêt, avec un tournage pendant deux nuits sous un orage et la pluie, avec un bébé… et puis non. Mon idée principale était que le spectateur ressente un malaise en sortant de la salle, en voyant le monde qui nous entoure. « on y est presque, qu’est-ce qui manque pour qu’on y soit ? » le film développe juste une autre forme d’absurdité par rapport à celle à laquelle on vit.
Propos recueillis par Mathilde de Beaune
A lire sur Artistik Rezo :
– la critique de Carré blanc
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7M6_YkMZU3g[/embedyt]
Carré blanc
Une film de Jean-Baptiste Leonetti
Avec Sami Bouajila, Julie Gayet et Jean-Pierre Andreani
Sortie le 7 septembre 2011
[Crédit photo : en haut, photo du film, DistriB Films. En bas, le réalisateur Jean-Baptiste Leonetti, Aliosha Alvarez]
Articles liés

« Scarlett O’Hara, la dernière conférence de Vivien Leigh » ou l’ode au théâtre partagée par Caroline Silhol
La comédienne Caroline Silhol choisit d’incarner, sur le plateau du Poche Montparnasse, l’actrice Vivien Leigh, révélée au monde entier par son personnage de Scarlett O’Hara dans « Autant en emporte le vent ». À travers une conférence où se...

Quelques-uns des plus beaux films d’Émilie Dequenne à voir ou à revoir
L’actrice belge, Émilie Dequenne, est décédée à 43 ans le dimanche 16 mars, emportée par un cancer très rare. Émilie Dequenne se fait connaître en 1999 à l’âge de 17 ans dans la réalisation des frères Dardenne, “Rosetta”, dont...

Exposition “Steve McQueen : L’héritage d’une icône” du 28 au 30 mars à Courbevoie
Du 28 au 30 mars, ne manquez pas l’exposition exclusive “Steve McQueen : L’héritage d’une icône” organisée par Les Épicuriens. Pendant tout un week-end, plongez dans l’univers du légendaire Steve McQueen, icône intemporelle du cinéma et passionné de belles...