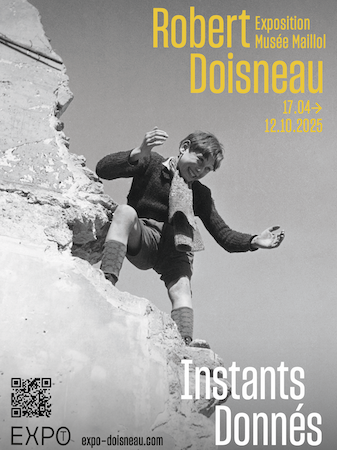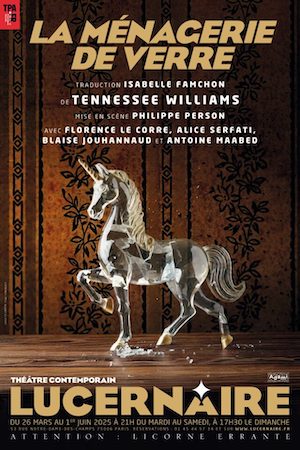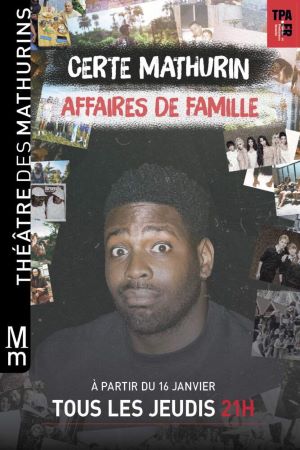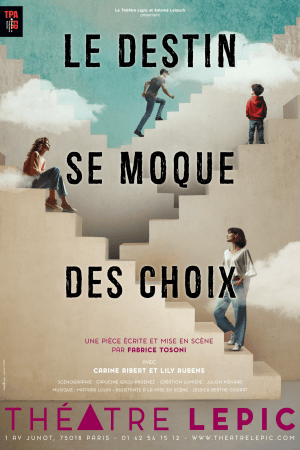Ezra Miller – Interview – Another Happy Day
Il est rare de voir un jeune de 20 ans aussi mature pour son âge. Preuve nous est donnée à travers notre interview que derrière cette attitude de rebelle se cache en fait un romantique de son temps passionné par l’opéra, Beethoven, Hunter S. Thompson et la Côte Est des Etats-Unis.
Vous avez débuté votre carrière… en tant que chanteur d’opéra.
Je devais avoir 6 ans quand j’ai commencé au jardin d’enfants mes premiers cours de musique. Ma professeure nous a immédiatement initiés à l’opéra alors que nous étions en âge de tous porter des scratchs ! J’ai tout de suite été saisi par ce genre musical qui est rapidement devenu une obsession. Ma mère, qui est une danseuse moderne, m’emmenait ensuite une fois par mois au Metropolitan Opera de New York. Deux ans plus tard, elle a entendu parler d’une audition pour le rôle d’un jeune enfant dans la production White Raven de Philip Glass, mise en scène par Robert Wilson. J’étais suspendu dans les airs pendant que la soprano chantait accrochée à une fausse lune ! La seule condition du rôle était de ne pas avoir le vertige, ce qui n’était pas mon cas. Travailler dans ce nouveau monde fut pour moi comme une épiphanie. L’opéra porte un regard inouï sur notre existence. J’ai tout de suite su que je voulais devenir chanteur lyrique. Le MET m’a par la suite engagé pendant deux saisons en tant que jeune soprano. Je me souviens avoir chanté dans Boris Godounov de Moussorgski et La Bohème de Puccini. Mais mon souvenir le plus frappant reste d’avoir chanté auprès de Luciano Pavarotti alors qu’il était à la fin de sa carrière. Ce fut sur une production de la Tosca où j’interprétais un enfant de chœur.
Mais votre voix a mué, ce qui a mis fin à votre carrière de soprano…
Ne m’ayant pas proposé de castration, cela devait arriver ! Je me souviens encore de l’instant où ma voix a changé. Du jour au lendemain, j’ai dû renoncer à l’opéra. J’ai alors ressenti un vide énorme. Il me fallait trouver une autre forme artistique pour m’exprimer. J’ai donc pris des cours de théâtre au collège. Je continuais toutefois de chanter, ce qui m’a propulsé vers la comédie musicale Runaways d’Elizabeth Swados. Un homme est venu me voir un soir dans les coulisses. Il m’a proposé de faire du cinéma. J’avais 13 ans et j’ai lu de nombreux scripts sans avoir de véritable coup de cœur ; jusqu’à ce que je tombe, un an après, sur celui d’Afterschool. Ce scénario était fait pour moi, car il reflétait à l’époque mon tempérament intérieur. Le personnage de Robert lutte contre la désensibilisation qu’apportent les nouveaux médias. Il symbolise à lui seul toute ma génération. À 15 ans, il en a déjà trop vu et essaye de mettre un sens à sa vie. D’une certaine manière, ce film pose la question de frontière entre fiction et réalité.
Ce qui est justement aussi une particularité du journaliste Gonzo que vous interprétez dans Beware of the Gonzo (inédit en France). L’initiateur de cette appellation, Hunter S. Thompson rappelle souvent ces mots de Faulkner : « La fiction est souvent le meilleur des faits ».
Les faits, par nature, ne rendent pas compte de l’expérience subjective que vit une personne. La façon dont les êtres humains vivent un événement est remplie de drames. Rien que de rentrer dans un magasin peut pour quelqu’un être un voyage en lui-même. C’est l’impression qui compte le plus. Pour cela, je suis d’accord avec Faulkner ainsi que Hunter S. Thompson. On retrouve ce concept dans toutes les formes d’art.
Afterschool marquait vos premiers pas dans un long-métrage, tout comme pour son réalisateur Antonio Campos et l’acteur Michael Stuhlbarg.
Nous sommes partis sur le même terrain d’entente puisqu’il s’agissait pour tous d’une première expérience. Le caractère de mon personnage Robert évoluait constamment durant le tournage, comme si nous étions tous à sa recherche. J’ai ainsi pu voir comment il était possible de construire un personnage tout le long d’un processus cinématographique.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FQk2GdE4F1s[/embedyt]
Vous avez affirmé avoir arrêté l’école… après avoir fait un rêve en compagnie de Beethoven !
Le journaliste qui a rapporté ces propos les a quelque peu exagérés ! Voici la vraie histoire : je revenais tout juste du festival de Berlin où je présentais alors Afterschool. A mon retour, j’avais raté quelques cours à l’école. Les professeurs m’en voulaient beaucoup tandis que les autres élèves étaient jaloux que je ne travaille pas autant qu’eux. Je me suis donc rapidement senti peu à ma place dans cet environnement et l’ai vécu comme une restriction où je n’apprenais au final pas grand-chose. Ce modèle académique ne me correspondait pas. Un soir, j’ai donc rêvé d’une rencontre dans le métro avec Beethoven qui était en crise de panique. Il n’était pas satisfait de ses quatre premières symphonies et j’essayais de le rassurer. Puis nous avons été attaqué par des sortes de zombies et nous devions faire équipe pour se défendre. À mon réveil, j’ai compris qu’il me fallait arrêter les études. (Rires)
Suite à Afterschool, vous avez enchainé avec City Island au côté de Andy Garcia.
Ce fut un peu plus d’un an après Afterschool. Andy Garcia est un acteur incroyable. J’ai même eu l’immense chance de tenir un dialogue politique avec lui, ce qui est réputé comme n’étant pas chose commune. J’avais aussi des positions très radicales sur Cuba par exemple. Il m’a même offert à la fin de tournage un bouquin sur l’histoire de son pays natal.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1V8ldV0jSdY[/embedyt]
Faisait-il un meilleur père que plus tard John C. Reilly dans We need to talk about Kevin ?
De l’ensemble des parents que j’ai pu avoir à l’écran, tous ont été adorables avec moi et entrain à m’enseigner la magie du cinéma. C’est impossible de les comparer, ou en tout cas cela serait difficile de le faire. Andy Garcia m’a toutefois pris sous son aile. Ses conseils me sont toujours utiles aujourd’hui. Et il m’en donnait un par jour ! Celui que je retiens le plus est de « briser l’ardoise ». Il ne faut jamais reproduire le même jeu mais toujours proposer quelque chose de neuf ; que cela soit au cinéma ou dans la vraie vie. Il est pourtant difficile de reproduire la même émotion sur plusieurs prises.
À propos d’émotion, le dernier face-à-face avec Tilda Swinton dans We need to talk about Kevin était-il difficile à tourner ?
Cette séquence fut l’aboutissement de tout notre travail fait sur ce film. Nous l’avons prévu en dernier, car je devais avoir la tête complètement rasée. Pour la première fois depuis le début de l’histoire, la façade de Kevin tombe pour laisser place à une sincère émotion. Il se rend compte de la réalité des faits. À travers l’adolescence, nous avons tous l’habitude d’adopter un regard du monde où tout est blanc ou noir. Il se rend enfin compte de son erreur alors qu’il est proche de ses 18 ans. Il a beau avouer ne pas savoir pourquoi il a commis cet acte, je suis sûr qu’il le sait très bien. Il cherchait tout simplement à avoir une communication honnête avec sa mère ; ce qu’ironiquement, il réussit à avoir au final.
Qu’avez-vous ressenti en apprenant la tuerie perpétrée par Anders Behring Breivik en Norvège ?
Venant d’interpréter plus ou moins le même personnage, j’ai essayé de comprendre pourquoi il avait commis cet attentat. L’une des premières choses que j’ai faites fut de connaître son antécédent familial. J’ai ainsi appris que son père était parti très tôt dans sa jeunesse. Breivik a quand même rédigé tout un manifeste basé sur des sujets politiques et socio-économiques. Au-delà de cette démarche, il faut comprendre d’où provient sa haine émotionnelle. Celle-ci doit très probablement venir de son antécédent familial. C’est la même perspective que celle de Kevin : ils ne peuvent pas véritablement expliquer leur geste.
Avant We need to talk about Kevin et suite à City Island, vous avez joué le rôle d’un jeune adolescent gay en conflit avec son père dans Every Day. Comment avez-vous préparé ce rôle ?
Vous savez, on peut trouver toute sorte de variété dans la sexualité d’un être humain, qui peut aller bien au-delà du genre pour lequel celui-ci est attiré. C’est un trait assez insignifiant quand j’interprète un personnage, car sa personnalité ne va pas simplement être régie par sa sexualité. Les deux personnages gay que j’ai pu interprétés dans Every Day et prochainement dans The Perks of being a Wallflower sont ainsi radicalement différents. La seule chose qu’ils ont en commun est qu’ils sont fiers de ce qu’ils sont. Leur homosexualité s’exprime qui plus est dans un moment important de leur existence, celui de l’adolescence.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=87UEJQWP-Ho[/embedyt]
Ces personnages évoluent pourtant dans un monde assez libéral, ce qui n’est pas forcément le cas aux Etats-Unis, ou ailleurs dans le monde.
La société américaine est basée sur une série de contradictions et d’hypocrisies. Plus que n’importe quelle autre culture, nous sommes obsédés par tout ce qui tourne autour de la sexualité, de la drogue et de la violence. Ce puritanisme est la raison pour laquelle il existe autant de répression. Nous sommes arrivés à un point où l’être humain se voit refouler de sa propre existence et de ses désirs propres. C’est comme un fait scientifique : si vous mettez un embryon en quarantaine, il va certainement se propager davantage qu’à l’extérieur jusqu’à devenir un parasite. C’est cette répression qui nous conduit à ces soi-disant monstruosités qui ne sont que le reflet de notre personnalité.
Nous avons le même problème en France. Nos politiques ont, par exemple, récemment débattu sur la législation de certaines drogues douces.
Dans l’idéal, il ne faudrait rien rendre d’illégal. La vie elle-même est à près tout composé de nombreuses drogues. Ce à quoi il faut faire attention est l’usage que l’on en fait. À partir du moment où vous rendez quelque chose d’illégal, un engrenage se crée. Certaines drogues douces sont tellement utilisées quotidiennement qu’il faudrait les rendre légales. De plus, un contrôle sur la qualité serait ainsi mis en place, et ce serait beaucoup moins dangereux pour la santé.
Vous interprétez vous même un drogué dans Another Happy Day que l’on peut voir comme un sombre film de Woody Allen.
(Rires). Exact, il y a la même variété d’êtres humains ayant des névroses bien différentes les unes des autres ! Je vois ce que vous voulez dire par là. Le film était dur à tourner et rempli d’émotions puisque nous l’avons tourné en une vingtaine de jours dans le Maryland.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=TRz-196Cizo[/embedyt]
Il semble que vous soyez très attaché à côte Est des États-Unis entre le Maryland, le New Jersey ou encore New York.
C’est exact ! Je suis pourtant allé sur la Côte Ouest lors d’un tournage pour la série « Californication ». Mes films se situent davantage dans la banlieue de la Côte Est des États-Unis et non dans les grandes villes. J’ai aussi grandi dans cet environnement. J’ai ainsi pu retranscrire à l’écran les quelques « démons » que l’on peut trouver dans cette région (rires). L’Est sera toujours ma maison bien que l’on puisse aussi s’amuser à l’Ouest. Il y existe toutefois quelques invraisemblances : les habitants veulent se croire relaxés alors qu’ils ne le sont pas forcément. Un New-Yorkais clamera toujours sa crise d’angoisse à l’inverse d’un Californien !
 La religion peut-elle être source de conflit au sein d’une famille comme peut-être dans Another Happy Day ?
La religion peut-elle être source de conflit au sein d’une famille comme peut-être dans Another Happy Day ?
Je ne vois pas la religion comme un thème à extraire en particulier, mais la question est intéressante. Bien entendu, la religion est liée à la tragédie humaine. Elle nous caractérise beaucoup en fin de compte. Il n’y a qu’à voir la relation que nous entretenons avec elle face à la mort.
Vous avez aussi eu la chance de jouer avec d’immenses acteurs tels que Brian Dennehy, Ellen Burnstyn et George Kennedy. Qu’avez-vous appris d’eux ?
Je suis fasciné par ces acteurs qui ont réussi à percer aussi longtemps dans le métier. Tourner avec eux fut comme si vous regardiez un artisan travaillant d’arrache-pied sur son objet pour arriver à un rendu parfait. Le jeu de ces trois acteurs et leur tempérament intérieur coïncident mutuellement. Un autre point commun est leur sens de la discipline que vous ne voyez pas chez la nouvelle génération. Sur le tournage de Another Happy Day par exemple, Ellen Burnstyn et George Kennedy étaient les seuls à rester sur le plateau attendant la nouvelle prise tandis que les autres se précipitaient dans leur caravane ou à la cantine.
Pour revenir sur We need to talk about Kevin, vous avez affirmé avoir écouté l’opéra Guerre et Paix de Prokofiev pour préparer votre rôle, ce qui est loin de la musique indépendante que vous interprétez avec votre groupe Son of an illustrious father.
Et pourtant ! Figurez-vous que nous avons même retranscrit le dernier air tiré de l’opéra Dino et Enée de Purcell ; comme quoi, l’opéra est toujours là ! Tout ce que je fais tourne autour de ce genre musical. J’essaye aussi de transposer l’émotion de l’opéra au cinéma.
Vous avez donc chanté en russe, en italien, et même composé une musique pour votre groupe intitulé Sanskrit.
Le Sanskrit est une ancienne langue indienne. Il équivaut à ce que l’on appelle le Mantra. C’est pourquoi le chœur répète souvent les mêmes syllabes dans ce morceau. Tout a un début, un milieu et une fin : ce mot symbolise la nature de toute matière. J’ai écrit cette musique dans une période difficile de ma vie où j’étais en pleine « agonie émotionnelle ». Lorsque nous chantons ces mots, nous luttons pour essayer de parvenir à saisir la réalité de la vie.
Est-il un réalisateur avec qui vous souhaiteriez tourner ? Suite à We need to talk about Kevin, nous pourrions penser à Gus Van Sant par exemple.
Je l’ai rencontré lors d’une audition pour Restless. J’aime son style et la perspective qu’il propose dans certains de ses films. Il fait parti de ces grands réalisateurs qui arrivent à parfaitement visualiser leur désir. Mais le véritable Elephant restera pour moi celui d’Alan Clark. Quel film !
Propos recueillis à Paris le 2 janvier 2012 et traduit de l’anglais par Edouard Brane (Twitter : Cinedouard)
Articles liés

“Que d’espoir !” un cabaret hors normes au Théâtre de l’Atelier
Valérie Lesort, artiste prolifique multiprimée aux Molières pour son univers visuel unique, s’empare des cabarets du dramaturge israélien Hanokh Levin, maître incontesté de la satire. Dans une mise en scène riche en inventivité plastique faite de transformations à vue...

Succès-reprise du spectacle “La Joie” d’Olivier RUIDAVET
Après le succès remporté par le spectacle au Petit Montparnasse à la fin de l’année 2024 et celui des deux exceptionnelles données au mois de mars dernier au Théâtre Montparnasse, LA JOIE revient, encore ! Solaro traverse les épreuves...

“À l’air libre” le nouveau spectacle de Laurent Balaÿ au Théâtre du Temps
Laurent Balaÿ est de retour avec son nouveau spectacle À l’Air Libre! Après le succès de son seul en scène De l’Air ! autour de son parcours de comédien, il revient avec une nouvelle galerie de personnages aussi attachants que drôles,...