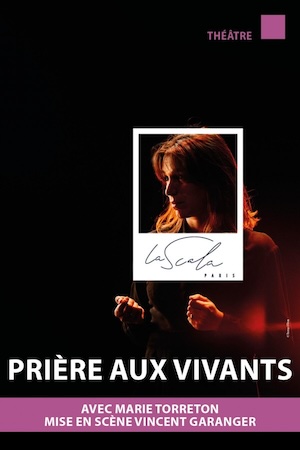Said Dokins : “Le graffiti fait une énonciation politique à travers le geste calligraphique”
Said Dokins, artiste mexicain, est connu à l’échelle internationale pour ses interventions en grand format dans l’espace public. Il aborde des questions sociales et politiques en utilisant un style unique qui fusionne d’écritures occidentales et asiatiques avec le graffiti.
Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre carrière artistique ?
Je suis un artiste visuel de profession, mais j’ai également consacré une partie de mon travail à la recherche, à la conservation et à la gestion.
Ma pratique artistique comprend diverses disciplines et supports tels que la calligraphie, l’installation, l’art vidéo, l’expérimentation avec la lumière, la photographie et l’utilisation de technologies comme la réalité augmentée. Cependant, je pense que ce qui a suscité le plus d’intérêt au niveau international sont mes interventions calligraphiques de grand format dans l’espace public, peut-être en raison de leur nature sociale, la relation qu’elles entretiennent dans les communautés ou le fait qu’elles se trouvent dans des lieux qui semblent parfois inhabituels ou éloignés.
J’ai grandi dans une mégalopole, à Mexico, avec près de 9 millions d’habitants. Je fais partie d’une génération marquée par l’effervescence de la mondialisation, la célébration d’une prétendue liberté communicative avec l’arrivée d’internet, et le consumérisme orienté vers les jeunes… Cette génération est également marquée par une prétendue liberté dans l’utilisation de l’espace public, mais aussi à cause d’un contrôle social fort.
Dans mon parcours, en tant qu’auteur de graffiti, je suis tombé sur la calligraphie. Il me semble que cette rencontre a été très importante, car d’une certaine manière, grâce à la calligraphie, nous nous définissons, nous communiquons la façon dont nous nous voyons mais aussi la façon dont nous voulons être vus. Grâce à la calligraphie, nous pouvons projeter la force, la rapidité, la sécurité, l’élégance, la douceur, mais aussi les nerfs, les traumatismes, les désirs. Avec la calligraphie, nous pouvons révéler les parties les plus profondes de notre être et aussi les cacher.
Je suis également président d’une organisation civile pour les nouvelles pratiques artistiques dédiée à la recherche, la promotion et la diffusion des arts alternatifs qui ne sont souvent pas pris en compte par les institutions. L’idée est de créer de nouveaux objets d’étude et, au niveau social, de contribuer à l’impact sur les politiques publiques.

Said Dokins, Femmes combattantes sociales, Central de muros, 2019. Mexico © Leonardo Luna
Comment est née l’idée d’intervenir dans les espaces publics avec de la calligraphie ?
Il y avait une correspondance directe entre l’aspect politique, le graffiti, la calligraphie et l’espace public, c’est-à-dire que le graffiti fait une énonciation politique à travers le geste calligraphique. À son tour, la calligraphie, de même que le graffiti est un acte en soi, il y a une sorte de performativité.
La différence est que le graffiti est fait dans des endroits qui ne lui sont pas destinés et que dans la tradition calligraphique il y a une préparation préalable et soigneuse. Si le graffiti est totalement institutionnel ou marginal, la calligraphie est officielle et même aristocratique et l’amener dans la rue est un défi politique assez intéressant.
J’ai commencé à faire du graffiti à la fin des années 90, comme un moyen d’expression libre en dehors des institutions. Je pense qu’intervenir dans l’espace public est justement une façon de participer au débat, depuis une tranchée puissante : la rue, c’est là que tout le monde participe d’une manière ou d’une autre. Ce que tu fais dans la rue est pour tout le monde et appartient à tout le monde, cela devient un domaine public. Tu es regardé par les personnes de la communauté qui passent tous les jours, tu es jugé et éventuellement elles participent aussi, en t’effaçant ou en installant des lumières pour mieux voir ton travail, en peignant ou en alternant à tes côtés, en parlant de ce que tu fais. Autrement dit, toute œuvre faite dans l’espace public fait face à ça, à ce qui est “public”.

Said Dokins, La réalité nous manque, de la série Histoires d’un mot, 2018. Bloop Festival, Ibiza, Espagne © Leonardo Luna
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Il y a une longue histoire d’inspiration pour mon travail, mais sans aucun doute mon cercle familial a eu une influence importante. Je pense que ce qui me motive le plus à faire ce que je fais, c’est de redéfinir sans cesse la pratique avec laquelle j’ai commencé, le graffiti.
Pour moi, le graffiti c’est aussi de l’écriture et le fait d’écrire est une action mais c’est aussi un chemin et au fil du temps, l’écriture change, évolue et se définit en fonction de nos besoins. Dans le monde du graffiti, ces changements se traduisent par un style.
Le style que j’ai développé est basé sur l’influence du graffiti mexicain, le cholo, et je me suis beaucoup intéressé à la calligraphie médiévale, en raison de son fort niveau de prégnance, c’est un style qui impose. Les Mexicano-Américains utilisaient la calligraphie médiévale, le style Old English, comme symbole de prestige. Au Mexique, une grande partie de la génération qui a commencé à faire du graffiti dans les années 90 a eu une très grande influence du graffiti cholo. En ce sens, je pense que l’une des influences les plus importantes de mon travail est Chaz Bojórquez, l’un des grands maîtres du Cholo Graffiti Writing. Lorsqu’il est allé au Mexique en 2007, j’ai suivi un petit atelier avec lui et nous sommes restés en contact, je le considère comme un grand ami et mentor.
D’autre part, j’ai suivi des cours de calligraphie traditionnelle avec des professeurs mexicains comme Antonio Anzures et Gabriel Martínez Meave et des étrangers comme Denis Brown et Carl Rohrs.
Je m’intéresse à la calligraphie japonaise en raison de l’importance rituelle de l’acte d’écriture lui-même, de l’énergie qu’il reflète, pour son expressivité plastique. En étudiant la calligraphie japonaise, on découvre l’importance spirituelle de l’écriture. J’ai étudié la calligraphie japonaise à l’école Shu Ken au Mexique avec Maître Masahiko Hiyama (仁彦檜山) et Nobuko Taniguchi (信子谷口).

Said Dokins, Histoires d’un mot, 2014. Intervention calligraphique à l’Université polytechnique de Valence. Poliniza Festival, Espagne © Kike Sempere
Que cherchez-vous à transmettre à travers votre œuvre ?
Je considère ma pratique davantage dans le domaine de la multi-disciplinarité, elle s’appuie sur mon expérience de graffeur depuis la fin des années 90, mes études d’art et de philosophie et ma rencontre avec la calligraphie.
Cela a conduit à un intérêt conceptuel pour la relation entre la mémoire, le langage, le signe et leurs répertoires de représentation, où j’ai l’intention d’étudier les notions de texte et d’inscription comme modes d’interprétation de l’existence au sens large et comme résultat de divers discours culturels. C’est dans la rue que j’explore l’obsolescence des espaces publics, le caractère éphémère du langage, ainsi que la nature hyperbolique et poético-politique de l’acte d’écrire.
En plus d’avoir étudié à l’École nationale des arts plastiques, vous avez également étudié la philosophie et la littérature à l’Université nationale autonome du Mexique. Comment ces deux disciplines, l’art et le langage, se fondent-elles dans votre travail ?
Quand j’ai commencé à étudier les arts visuels, j’ai laissé le graffiti un peu de côté. J’ai eu beaucoup d’expériences, d’une part je venais d’une connaissance empirique, de la rue, du graffiti et cela m’a aidé à comprendre plus rapidement les questions formelles des arts visuels, j’ai appris le langage académique de l’art. D’autre part je me suis intéressé à l’art conceptuel, à la performance, aux interventions, à l’art spécifique au site, au situationnisme, au land art, à l’art participatif, à l’art lié au social, au public.
Très vite, je me suis intéressé aux études esthétiques, j’ai étudié quelques années de philosophie et j’ai suivi d’autres cours d’esthétique et de théorie critique. J’ai toujours été intéressé par la relation de l’art avec le textuel, avec le signe et avec l’écriture. Je suis retourné dans la rue avec un regard différent, peut-être plus ouvert.
Je crois que l’académie me fournit des outils pour problématiser des questions dans mon travail, ainsi que des questions du graffiti et d’art urbain, pour comprendre ces pratiques à partir d’autres positions et surtout pour envisager des projets où une certaine rigueur en termes de recherche est nécessaire.

Said Dokins, Panoptique, Écritures en fuite. San Luis Potosí, Mexique © Leonardo Luna
Pouvez-vous nous parler de la place de l’art urbain dans la scène culturelle mexicaine ?
La place du graffiti et de l’art urbain au Mexique est très similaire à celle de toutes les régions du monde. Le graffiti continue à être criminalisé, ou vu à travers les lunettes de la “culture populaire” et l’art urbain tend de plus en plus à être déterritorialisé. Au cours de la dernière décennie, nous avons témoigné une série de tensions dans les mouvements qui ont eu lieu dans l’art urbain et le graffiti, où l’industrie culturelle, les institutions qui légitiment l’art et le marché ont monopolisé la voix autoritaire sur la pratique.
Au départ, l’art urbain était un art piétonnier, totalement contextuel, illégal, politique et éphémère ; aujourd’hui, ce qui attire l’attention, ce sont les grands festivals, où participent non seulement des artistes urbains mais aussi des designers et des illustrateurs, où la production de la fresque est généralement hors contexte, comme s’il s’agissait d’un concours de la fresque la plus grande. On voit aussi apparaître des musées d’art urbain, qui abritent entre quatre murs ce qui devrait être à l’extérieur, et bien sûr les réseaux sociaux, où il n’est plus nécessaire d’avoir l’expérience d’être surpris par une intervention d’art urbain, il suffit de faire défiler les belles stories et les posts, et si vous êtes plus aventureux, vous pouvez organiser un visite.
Ces tendances conduisent l’art urbain à sa spectacularisation, plus qu’à sa réflexion ou à la connaissance de ces pratiques. Elles ont fonctionné sans doute comme des modes d’imposition d’une série de visualités qui sont celles qui prévalent dans les tendances globales. Cela met en jeu l’effacement du caractère vernaculaire, marginal et périphérique du graffiti et de l’art urbain, et c’est ainsi que se configurent les nouveaux modèles actuels.
Aujourd’hui, avec la pandémie de COVID-19, nous constatons que la transition vers le numérique règne malgré le fait que les plateformes virtuelles sont toujours aussi nulles. En même temps, les graffeurs continuent de rester dans la rue pendant que d’autres dorment ; et nous voyons les artistes urbains redoubler leurs efforts pour rester pertinents dans l’espace public. Des centaines d’initiatives artistico-urbaines sont apparues : des hommages posthumes, des mèmes incarnés dans les rues, des festivals virtuels, des appels à rester chez soi ou non, tous les efforts pour maintenir la scène vivante.
Je crois qu’une des solutions positives à cette situation est toujours l’ouverture, c’est-à-dire que les institutions, les galeries et les musées soient réellement ouverts aux pratiques de l’art urbain, dans toute sa diversité. Il faut qu’ils prennent des risques pour les projets sociaux et politiques réels. De même, les collectifs d’art urbain devraient renforcer et maintenir la pratique dès la création et ne pas se laisser influencer par les tendances.

Said Dokins, NÆRHET, 2018. Festival de Nuart, Stavanger, Norvège. En collaboration avec la Fondation Johannes Læringssenter © Leonardo Luna
Pouvez-vous nous raconter l’histoire d’un de vos projets que vous aimeriez mettre en avant ?
L’une des interventions que j’ai le plus appréciée s’est déroulée à Stavanger, en Norvège, où j’ai mené plusieurs entretiens avec des immigrants récemment arrivés à Stavanger sur leur expérience loin de chez eux, et j’ai également parlé aux habitants sur leur attitude envers les étrangers. Grâce à ces conversations avec des personnes venant de pays aussi diverses que le Pakistan, l’Afghanistan, la Chine, les États-Unis, ou l’Afrique du Sud, nous avons pu explorer les notions de liberté et d’appartenance. L’idée était de recueillir les paroles de personnes individuelles et de les rassembler en quelque chose qui représentait une expérience partagée.
Le texte qui en a résulté est “NÆRHET”, “proximité” en norvégien, faisant référence à la façon dont notre réalité individuelle est façonnée par notre environnement et comment celui-ci peut être affecté par le déplacement et la migration.
Un autre projet qui, je pense, a marqué une étape importante dans mon travail est l’exposition rétrospective Écritures en fuite, que nous avons organisée au Mexique, dans une ancienne prison qui est devenue un centre pour les arts. Dans cette exposition, j’ai présenté des dessins, des installations d’encre, des photographies, et des archives, avec l’intention de présenter le travail que j’ai développé au cours de la dernière décennie.

Said Dokins, Translations, Écritures en fuite. San Luis Potosí, Mexique © Leonardo Luna
Avez-vous un projet en tête que vous rêvez de réaliser ou un lieu particulier où vous souhaitez intervenir ?
Actuellement, je suis très intéressé par l’idée d’écrire comme un acte, le graffiti comme une empreinte, mais aussi comme une expérience elle-même qui crée un sens dans le moment de l’action. Je me suis demandé comment enregistrer cette expérience, cet acte éphémère qu’est le graffiti et j’ai trouvé dans la photographie de longue exposition une forme d’enregistrement de la lumière qui peut nous donner ce résultat. J’ai également travaillé avec l’animation et je travaille actuellement avec un ami photographe, Leonardo Luna, sur ce projet appelé Héliographies de la mémoire, qui d’une part tente de définir ce qui est pour moi l’acte pur du graffiti, et en même temps, permet l’appropriation de l’espace à partir d’une autre perspective. Nous captons l’invisible, en agissant dans l’air, surtout dans des lieux importants comme des sites historiques, des places publiques, des monuments ou des bastions, où la place devient un espace de resignification.
Grâce à ces calligraphies de lumière, j’ai réussi à séparer symboliquement le graffiti du mur et à le laisser retenu dans l’espace.
Nous avons réalisé ce projet dans plusieurs villes du Mexique, ainsi que dans d’autres villes du monde telles que Paris, Bordeaux, Amsterdam, Arnhem, Heerlen, Dresde, Berlin, Munich, Stavanger, entre autres.
Mon rêve est d’emmener ce travail sur tous les continents et le seul que nous ayons encore à visiter est l’Asie.

Said Dokins et Leonardo Luna, Tour de feu, de la série Héliographies de la mémoire. Dresde, Allemagne
Pour plus d’informations sur Said Dokins, je vous invite à visiter son site web et son Instagram.
Propos recueillis par Maria Bitar
Articles liés

Shai Maestro de retour en solo avec son album “Solo: Miniatures & Tales” le 2 mai chez naïve
En 2025, Shai Maestro entame un nouveau chapitre : son premier enregistrement en piano solo, sortie prévue le 2 mai chez naïve. Ce projet explore l’équilibre subtil entre structure et spontanéité et reflète l’évolution de son rapport à la...

“Une Mouette” haute en couleurs signée Elsa Granat
À la Comédie Française, Elsa Granat plonge dans la pièce la plus célèbre de Tchekhov pour en extraire une adaptation contemporaine, passionnelle, en forme d’ode à la création, portée par le talent lumineux des comédiens dont Marina Hands et...

“Les Fausses confidences” : Alain Françon revisite l’œuvre de Marivaux au Théâtre de la Porte Saint Martin
Araminte, riche veuve, est encouragée à épouser le comte Dorimont par sa vieille mère. Rien de plus normal dans la bourgeoisie du 18e siècle que dépeint Marivaux. Mais c’est Dorante, un jeune avocat qui tombe fou d’amour pour elle....