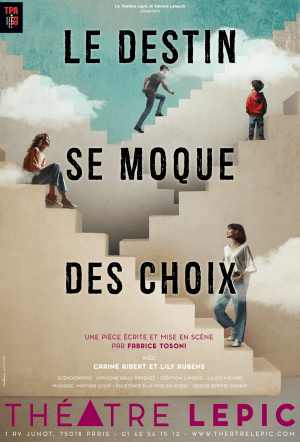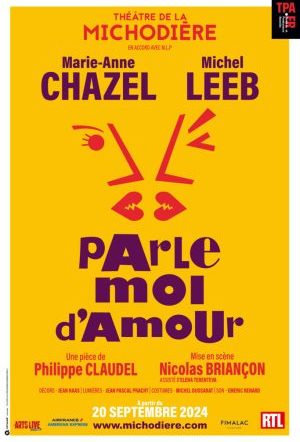|
Le 6 février 2017
Romain Tardy est un artiste visuel qui explore les liens entre son et image, entre le monde dématérialisé et le monde matériel … À travers des approches contextuelles, il propose des expériences à la fois sensorielles et conceptuelles, notamment par l’exploration de la dimension vivante de l’outil numérique, qu’il tente de mettre, au grès de ses expérimentations, au défi. Rencontre avec cet artiste aussi visuel que conceptuel.
 Comment as-tu débuté ta pratique ? Comment as-tu débuté ta pratique ?
Après avoir étudié les arts appliqués et un passage aux Beaux Arts, j’ai commencé à pratiquer le VJing, dont le principe est de venir poser sur une musique jouée en live un contenu visuel qui réagit en direct.
Cette pratique m’a fait prendre conscience des liens entre son et image dans un contexte de soirée à l’époque. L’idée était d’essayer d’amener une dimension vivante à un outil numérique, puisqu’il s’agissait dans un premier temps de créer des animations visuelles et dans un second temps de les mixer sur un rythme.
Il y a donc ce rapport de réaction directe à quelque chose ; à la musique, au public, à l’univers d’un club qui est assez particulier car concentre une énergie sonore, corporelle et visuelle. Avoir une dimension humaine dans un dispositif numérique est aussi l’une des raisons de mon intérêt pour le VJing car c’était une manière de présenter sans intermédiaire le résultat de mon travail à un public.
J’ai cependant assez vite vu les limites du contexte du club. On ne peut pas vraiment monter un discours, c’est plus de l’ordre de la stimulation visuelle, de quelque chose de très immédiat. C’est tout de même quelque chose que j’ai gardé dans mon travail, l’idée de proposer des expériences sensorielles, mais que j’ai voulu mettre au service d’un propos qui représente plus que des expérimentations graphiques. C’est comme ça que j’en suis venu à sortir du contexte du club mais aussi du format de l’écran, vécu comme une forme d’enfermement. Ça m’a amené, petit à petit, à utiliser le mapping et d’une façon générale aujourd’hui des supports physiques, qu’ils soient mappés ou non, et par l’utilisation d’objets qui ne soient pas forcément techniques ou technologiques.
Quel est le cœur de ta démarche artistique ?
Je pense qu’il a évolué mais je pressentais déjà à l’époque et je sentais dans le mapping la question de la physicalité des images produites dans l’ordinateur. Comment s’interroger sur ces aller-retours que l’on fait tous les jours entre le monde dématérialisé et le monde matériel dans lequel on vit ? Que se passe t-il quand l’image dématérialisée vient se superposer à quelque chose de matériel ? C’est un enjeu plastique qui pose également la question des mutations de notre monde et de nos cerveaux ces quinze dernières années.
 Quel est le plus gros challenge que tu as à affronter dans ta pratique ? Quel est le plus gros challenge que tu as à affronter dans ta pratique ?
Ce sont surtout des défis liés à des évolutions du monde dans lequel on vit. Le premier serait lié à ce domaine que l’on a tendance à appeler « art numérique », que je ne trouve pas très juste mais qui permet de mettre une étiquette sur des pratiques technologiques au service d’un propos artistique. L’idée est de dépasser l’enjeu technologique pour faire reconnaître cette pratique comme une pratique artistique à part entière.
C’est l’un des défis qui m’intéresse, surtout étant issu d’une scène qui n’est pas artistique par essence. Le VJing est limité à un effet visuel immédiat dans le contexte peu propice à la réflexion qu’est la fête, où il reste difficile de développer un propos.
L’un des défis c’est aussi, sans renier cette partie de mon parcours qui m’a construite, de pouvoir en prendre ce qu’il y a d’intéressant comme je le disais plus tôt. De prendre cette expérience et de la transposer, de déplacer le curseur entre une expérience purement physique et une expérience qui peut être plus intellectuelle, qui propose des références.
La question de la temporalité est aussi intéressante. L’idée est d’étendre dans la durée des choses que j‘ai pu observer dans un contexte de rapidité. D’autant plus dans le champ des arts numériques car on associe la technologie à la rapidité alors qu’elle est tout à fait compatible à la lenteur.
 Tu associes la dimension de contextualité avec celle d’interactivité, en quoi sont-elles liées selon toi ? Tu associes la dimension de contextualité avec celle d’interactivité, en quoi sont-elles liées selon toi ?
Il y a selon moi deux types d’interactions. Celle à laquelle on pense lorsqu’on parle d’art technologique, à savoir la réaction d’un dispositif à la réaction du spectateur par un moyen technologique, souvent en temps réel. C’est quelque chose que j’ai abordé dans mon dernier projet, OX. J’aime l’idée de mettre la machine au défi de quelque chose qu’elle ne peut pas forcément réaliser. La question autour de ce projet est celle de savoir si la machine peut avoir une expérience sensible de la musique, si elle peut avoir des réactions qu’un humain ne peut pas avoir, pas forcément en terme qualitatif. Il y a là une notion d’interactivité directe car la machine écoute la musique et y réagit. Parfois ça fonctionne bien, d’autres fois moins. Cette notion d’imperfection dans les outils technologiques m’intéresse de plus en plus.
Le deuxième mode d’interaction est la création même de l’œuvre, en observant un contexte et en essayant de le comprendre.
Lorsque j’ai créé « The Ark », je ne connaissais rien du Mexique. La première phase consiste à parler avec un maximum de gens, de noter un maximum de premières impressions, mais au final on ne sera jamais qu’une personne propulsée dans un contexte qui n’est pas le sien et qui réagit avec son bagage et sa culture. L’idée est de s’ajouter au contexte sans jamais s’y substituer.
Tu ne travailles jamais avec des outils de médiation, du moins physiques ?
Jusqu’à maintenant non, si ce n’est des textes de présentation du projet, mais jamais de façon explicite ou détaillée, parce que je ne le considère pas comme un enjeu déterminant.
C’est là aussi qu’il faut selon moi prendre du recul entre ce que l’artiste connait de sa pièce et ce que le public en connaît quand il la voit. Je m’en suis surtout rendu compte cette année quand j’ai présenté la pièce « Je rate mon cerveau pré-internet », le projet pour lequel je travaille maintenant et pour lequel je vais faire une résidence à Montréal cet été. Le cœur de la pièce est une série d’interviews de 40 personnes sur leurs souvenirs du monde avant internet, selon différentes thématiques. Le fait d’associer des mots à ces images là, entrecoupées de références, comme des extraits d’interviews de Marguerite Duras qui parle de l’an 2000, ouvre une nouvelle dimension. Ce sont des mots qui ramènent à des souvenirs personnels. J’ai de plus en plus envie d’intégrer des mots à mon travail. J’ai toujours été attaché au langage mais c’est quelque chose que je ne me suis bizarrement jamais autorisé à intégrer directement dans les œuvres alors que je l’utilise beaucoup comme un outil de travail.

Quel challenge aimerais-tu relever, où aimerais-tu idéalement pousser la limite ?
Dans deux directions. La première arrive cette année avec une exposition solo à grande échelle pendant plusieurs mois, qui rassemble plusieurs de mes travaux. Jusqu’à maintenant, je suis intervenu avec une œuvre, dont le propos est lié à un contexte, mais dans un parcours d’exposition les œuvres réagissent entre elles. En tant qu’artiste, il n’y a pas de meilleur auto-psychologie que de faire une exposition qui met en vis-à-vis tes différents travaux et donc ton parcours. C’est l’occasion d’aller plus en profondeur dans une démarche, dans une médiation, et de voir comment les concepts s’articulent. Le deuxième défi est de travailler sur des installations pérennes en croisant les disciplines : travailler avec des architectes, des urbanistes, des designers, …
Pour conclure, un film ou un livre à nous recommander ?
J’ai relu « La vie matérielle » de Marguerite Duras, que j’ai trouvé très intéressant.
Merci Romain !
Au plaisir de découvrir ta prochaine exposition !
Marie Monclus
Pour Thinkers & Doers
contact@thinkers-doers.com
www.thinkers-doers.com

[Crédits Photo 1 : © Andréa Aubert / Photo 2 -> 4 : © Romain Tardy ]
|







 Comment as-tu débuté ta pratique ?
Comment as-tu débuté ta pratique ? Quel est le plus gros challenge que tu as à affronter dans ta pratique ?
Quel est le plus gros challenge que tu as à affronter dans ta pratique ?