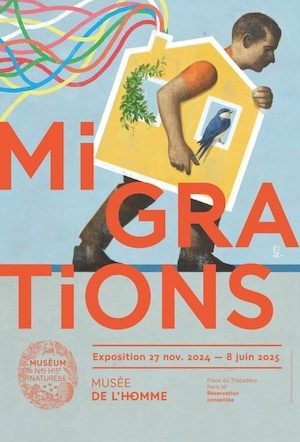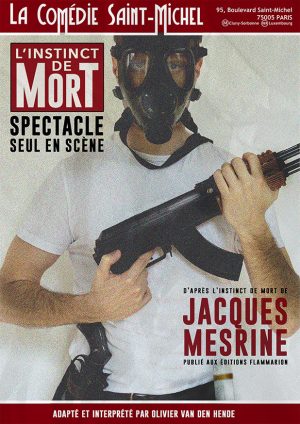Quik – interview
Vous n’étiez qu’un enfant quand tout a commencé…
Oui, j’avais dix ans ! J’étais tellement petit que j’ai dû attendre d’avoir douze ans pour atteindre les trains… Je regardais les noms sur les murs en allant à l’école, je les inscrivais sur mon sketch book – je n’osais pas y écrire le mien. Mais quand mon book a été plein, j’ai compris qu’il se passait quelque chose, et que j’en faisais partie. C’était vraiment collectif. Je pouvais voir immédiatement qu’untel était latino, l’autre noir. Chacun avait sa propre saveur. Les graffitis noirs étaient plus puissants, plus « funk », ceux faits par les latinos étaient plus rythmés. J’ai donc compris que je pouvais exprimer ma propre différence, y compris mon lamentable sens de l’humour, à travers mes graffitis. Ensuite j’ai fait une école d’art, où j’étais regardé de travers. Ils se demandaient ce que moi, le garçon noir, je faisais là. Ils auraient trouvé plus normal que je dessine des paquets de cigarettes ! Mais plus on me hait, plus je résiste. J’étais petit, chétif, j’ai compris que je devais trouver quelque chose pour me défendre ! Le graffiti était un sport, agressif. C’était ma façon de me battre. Les gens normaux ne font pas de graffitis. Il faut que la société vous ait un peu bousillé…
Dans votre geste, il y avait de la rage ?
Chez moi il n’y a pas tellement de demi-mesure, je me sens très bien ou complètement enragé. On ne connaissait pas mon travail sur les trains parce que c’était joli, j’étais populaire pour avoir commis énormément de destruction. Quelque chose de joli, on aurait pu me le pardonner. Mais je voulais que ce soit laid. Je pouvais prendre un train entier et tagger toutes les fenêtres ! Il y avait une mystique du graffiti. C’était très puissant de voir passer le train taggé… Ce que je voulais, c’était un pouvoir. J’étais capable de peindre un train en vingt minutes et de retourner boire un coup… Par la suite, j’ai fait tellement de choses : j’ai travaillé en prison, dans des bureaux pour IBM, j’ai enseigné. Je fais en sorte que ça reste intéressant. J’ai aussi travaillé dans l’armement nucléaire, quand j’étais jeune. J’ai choisi de faire de l’art plutôt que de tuer des gens. Les autres graffeurs n’ont pas autant de cordes à leur arc. Mon éducation m’a préparé à être le meilleur, quelle que soit la voie que je choisirais…
New York à l’époque, c’était un âge d’or ?
Pour le graffiti, oui, mais ni pour la ville, ni pour les gens. C’est sous la pression que le blues, le rock ou le hip-hop peuvent naître ! Il faut que les choses soient sur le point d’exploser pour avoir un Miles Davies… Même chose pour le graffiti. En 1979, quelqu’un nous avait laissé un building. Chaque mardi (un mauvais soir pour le graffiti), on s’y rencontrait, on se montrait nos books. Il passait Seen, Basquiat, Keith Haring, Crash… Tout cela se passait très tranquillement, vous fumez un joint, vous buvez une bière, vous discutez ! Ce type d’énergie rassemblée donne une force incroyable.
Vous en êtes nostalgique ?
Bien sûr. J’en rêve encore… Bizarrement, dans mes rêves, les trains sont souvent dans les montagnes, parce que j’adore la nature, mais je n’arrive jamais à les peindre. Je suis chassé par la police, etc… Alors que tout cela est derrière moi ! Enfin, pas tout à fait. Environ une fois par an, je peins un train, juste pour le principe. Pour pouvoir dire : « Oui, je suis un king, je peins encore des trains ! » Je ne suis pas un street artist, je suis un king ! Quand l’époque des trains a été finie, nous avons été déçus… L’âge d’or s’est terminé quand Blade, Dondi, Lee ont commencé à vendre dans des galeries. Personne n’était capable de faire mieux. Donc c’était inutile, à quoi bon ? Et puis nous étions devenus trop vieux pour ce genre de conneries. Vous pouvez être blessé, aller en prison – je suis passé par là, et croyez-moi, ce n’est pas drôle !
Mais le danger faisait partie du jeu ?
Oui, c’était un défi, un peu comme un jeu de guerre. Et bien sûr, c’était dangereux. Vous pouviez être arrêté par la police, renversé par un train, électrocuté. Des gamins en sont morts. Parce que rappelez-vous, des gamins, c’est ce que nous étions ! Un garçon met toujours des siècles à grandir…. Le graffiti, c’est une addiction, un sport, et cela a pris des années à certains d’entre nous pour arrêter. Regardez, je peins toujours des trains. Mais nous évoluons. Certains d’entres nous, depuis, ont grandi comme artistes. Cela fait vingt ans maintenant, et Blade est au musée. Moi, j’ai eu deux vies : les graffitis sur les trains, et les œuvres inspirées du graffiti, et faites pour les galeries.
Futura vous a encouragé à opérer ce passage…
Sans lui, je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui. Futura et ceux de sa génération faisaient des expositions avant nous. Ils voulaient faire de l’argent. Je suis resté en retrait quelques années. Mais Futura avait foi en moi, il m’a présenté des gens…. C’est de lui que j’ai appris qu’il fallait sans cesse maintenir l’intérêt, évoluer. J’ai créé Quik, comme il a créé Futura2000. Sans lui, je ne me serais pas retrouvé au Japon à dessiner des toys, par exemple… Quand on m’a proposé d’exposer pour la première fois, j’avais vingt-trois ans. J’ai appelé mon père en larmes pour le lui annoncer. Il a ri, et m’a demandé si j’avais bu !
Vous avez aussi passé beaucoup de temps en Europe…
La Hollande a changé ma vie. J’y ai trouvé du respect. Là, ils voyaient que mon travail avait des racines et des motivations politiques, émotionnelles. C’était comme si on m’avait retiré un poids énorme. En Amérique, j’étais toujours vu comme un Noir, même quand j’étais en train de travailler dans un bunker nucléaire pour protéger ce foutu pays ! Artistiquement, j’ai grandi en Hollande et en Allemagne, où j’ai eu la possibilité d’exposer. J’ai vu qu’on y exposait tous les New-yorkais qu’on ne montrait pas chez nous. J’y ai aussi découvert d’autres types de propositions artistiques, comme Anselm Kiefer ou Georg Baselitz, dont la découverte a fait partie de mon éducation. Rien à voir avec le street art, j’insiste ! J’ai peint des trains, je n’ai jamais peint dans la rue ! Le « street art », ça aide à vendre, à exposer, il faut en passer par là, mais c’est une idée commerciale.
 Il y a une dimension très narrative dans votre travail…
Il y a une dimension très narrative dans votre travail…
Oui, je raconte mon histoire. J’ai rencontré récemment un collectionneur qui avait dix-sept de mes peintures. Et il m’a dit qu’il savait tout sur moi, ma famille, ma fille, mon chien… Ce n’est pas toujours reconnaissable, mais lui le comprenait, le voyait. Quand j’étais plus jeune, je faisais des visages tristes et heureux sur les trains. J’en dessinais une vingtaine côte à côté, et quand le train bougeait, ils s’animaient. Je sais ce que je fais. C’est un art figuratif, non abstrait. Quand ils regardent, ils ne peuvent pas savoir que je suis noir. C’est une blague à ma façon, une façon de dire : « Fuck you ». J’ai aussi peint pas mal de pin-up, à la façon des années soixante. J’ai eu une petite amie qui ressemblait beaucoup à la lithographie « Jasmin », que je viens de faire. Mon ex-femme avait un visage trop rond, je ne pouvais pas le dessiner, ça ne se vend pas. Je suis aussi un homme d’affaires ! Les blondes se vendent aussi mieux que les brunes…
Cet aspect mercantile, vous y pensez quand vous commencez quelque chose ?
Peut-être pas aussi sérieusement. En fait, quand je me mets à griffonner quelque chose, je ne sais pas trop où je vais. C’est une affaire d’émotion avant tout. Là, ça fait un mois que je n’ai pas peint. Il a fait froid, je n’ai pas été inspiré, je n’ai rien fait ! Peut-être le mois prochain, le flot va reprendre. Je ne peux pas prévoir…
Le racisme a été l’un de vos grands thèmes. Mais la société change, non ?
Je suis fier, parce que nous avons ouvert la porte. Nous sommes dans les Musées et on ne peut plus nous en chasser. Vous n’avez plus besoin d’être un homme de type caucasien pour exposer – même si ce sera peut-être un peu plus difficile. Toute ma vie, toute ma création est portée par des motivations politiques. Nous sommes des survivants. Je croise parfois des gars qui me disent : « Je sais qui tu es, tu es Quik, le type des trains ». C’est flatteur. Cela veut dire que j’ai accompli quelque chose, j’ai eu un impact. Nous voulons tous que notre vie ait un sens. Dès l’école d’art, je savais que je devais travailler dur pour faire quelque chose de mon talent. Et je savais aussi que je les obligerai à se souvenir de mon nom…
Propos recueillis par Sophie Pujas
Pour en (sa)voir plus :
Articles liés

MINIATURE : l’expo événement pour les 10 ans de la Galerie Artistik Rezo
La galerie Artistik Rezo et FIGURE s’associent pour présenter la troisième édition de l’exposition MINIATURE : un événement unique en son genre à l’occasion des 10 ans de la galerie. Cette édition réunit plus de 80 artistes français et...

Justice livre un show explosif et festif à l’Accor Arena de Paris Bercy
Ce mardi 17 novembre 2024, après une première partie orchestrée par Pedro Winter, boss du label Ed Banger, Justice a électrisé une salle pleine à craquer, première date des deux soirées prévues à Paris, chez eux, à domicile. La...

Marion Mezadorian pète les plombs au Théâtre Victor Hugo
Avec son précédent “one woman show”, Pépites, Marion Mezadorian a défrayé la chronique. Dans la même veine, celle d’une performance scénique où l’humour le dispute à l’émotion, cette nouvelle création donne la parole à celles et ceux qui craquent...