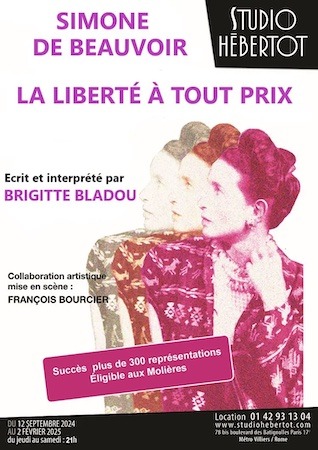Pure Evil – interview
PURE EVIL - La Cantine du Faubourg::
Vous êtes fils de peintre… Avez-vous grandi avec l’idée de suivre les traces de votre père ?
Non, cela me semblait beaucoup trop de travail ! Il faut y consacrer tellement de temps — et c’est une tâche si solitaire… Mes parents, c’est vrai, m’encourageaient à poursuivre la dimension artistique des choses. J’ai toujours été entouré par l’art, et le pop art en particulier. J’allais dans des galeries, voir des expositions. Mais en fait, j’ai passé pas mal de temps à éviter de devenir un artiste. Quand j’étais jeune, je vivais à la campagne, au Pays de Galles, mais ce qui m’attirait, c’était Londres et la subculture, comme le punk. Cela m’a conduit à passer un diplôme en mode et design. J’ai commencé à travailler pour une compagnie de skate-board, que je pratiquais. J’ai dessiné des vestes, des accessoires, ce genre de choses. Puis je suis allé en Californie, où là aussi j’ai dessiné des vêtements, du streetwear.
Quel souvenir gardez-vous de la Californie des années quatre-vingt-dix ?
 A l’époque, c’était la Mecque du skate, mais aussi un endroit où la rave culture explosait. LSD, ecstasy, beaucoup de drogues psychotropes circulaient, et tout cela a nourri le boom de la musique électronique, notamment à San Francisco. J’étais DJ, je composais de la musique, et je vendais mes T-shirts dans les raves. Je me suis rapproché de gens qui faisaient du graffiti, comme Reminisce, qui peignait de magnifiques chevaux blancs partout dans la ville. Il y avait une vraie poésie à voir ces échappées de chevaux sauvages galoper dans le centre-ville de San Francisco. C’était une nouvelle façon de voir le graffiti, plutôt fondée sur des personnages. Londres s’est mis à me manquer, avec sa crasse — je pense qu’il en faut un peu pour que les choses grandissent. Je faisais des allers-retours entre les deux villes, et je me suis mis à remarquer de plus en plus les pochoirs. A voir ce que faisaient Bast, Faile, Banksy, ou Pablo Fiassco, qui travaillaient dans cette direction. J’ai commencé à sortir la nuit, à interagir avec la rue, à faire à la fois du graffiti et du pochoir. C’était vers l’an 2000, une période de vraie explosion du street art. En particulier avec la première exposition sauvage de Banksy, dans la rue.
A l’époque, c’était la Mecque du skate, mais aussi un endroit où la rave culture explosait. LSD, ecstasy, beaucoup de drogues psychotropes circulaient, et tout cela a nourri le boom de la musique électronique, notamment à San Francisco. J’étais DJ, je composais de la musique, et je vendais mes T-shirts dans les raves. Je me suis rapproché de gens qui faisaient du graffiti, comme Reminisce, qui peignait de magnifiques chevaux blancs partout dans la ville. Il y avait une vraie poésie à voir ces échappées de chevaux sauvages galoper dans le centre-ville de San Francisco. C’était une nouvelle façon de voir le graffiti, plutôt fondée sur des personnages. Londres s’est mis à me manquer, avec sa crasse — je pense qu’il en faut un peu pour que les choses grandissent. Je faisais des allers-retours entre les deux villes, et je me suis mis à remarquer de plus en plus les pochoirs. A voir ce que faisaient Bast, Faile, Banksy, ou Pablo Fiassco, qui travaillaient dans cette direction. J’ai commencé à sortir la nuit, à interagir avec la rue, à faire à la fois du graffiti et du pochoir. C’était vers l’an 2000, une période de vraie explosion du street art. En particulier avec la première exposition sauvage de Banksy, dans la rue.
Vous l’avez vécue comme un tournant ?
Oui, parce que pour la première fois, nous étions invités à une exposition, non dans une galerie, mais dans la rue. Il a peint les murs et les tunnels en blanc et a posé des pochoirs. Cela avait du sens, de dire : n’attendez pas la permission de faire quelque chose, prenez-la. Je crois que cela a été un déclic pour beaucoup de gens, qui ont compris ce qu’ils pouvaient faire, par eux-mêmes. C’était une belle période, de rencontres. Banksy avait beaucoup de succès, gagnait beaucoup d’argent, mais personne ne pensait en ces termes. Nous voulions surtout poser des pièces un peu partout, nous amuser…
Vous avez fini par vous installer à Londres…
En fait, j’ai voulu rentrer en Californie, et je n’en ai pas eu le droit. Je suis retourné à Londres. C’était un deus ex machina, tout à fait inattendu, mais c’est le genre de choses qu’il faut affronter. Ce n’était pas mon plan, mais soudain je me retrouvais à vivre chez mes parents, ce qui n’a rien d’évident passé un certain âge, et à chercher une solution. J’ai travaillé, encore et encore, sur de nouvelles images et de nouvelles impressions. Je crois que c’est quand on est vraiment aux abois qu’on invente quelque chose. Dans ces moments où ça doit passer ou casser… J’ai fait des impressions à partir de mon travail, et à partir de là, les gens ont commencé à savoir un peu ce que je faisais. J’ai fait une exposition solo, et les choses se sont mises en place.
Pourquoi avoir choisi « Pure Evil » comme nom d’artiste ?
C’est le nom que j’avais donné à un petit lapin, un personnage que j’ai créé il y a dix ans, et qui s’est mis à prendre de plus en plus de place, peut-être à cause d’un souvenir d’enfance. Quand j’étais petit, j’avais des cousins qui vivaient à la campagne. On m’a passé un fusil, et j’ai tué un lapin. Ce qui m’a surpris – je pensais qu’il s’enfuirait. D’où ma culpabilité, qui s’est manifesté à travers ce lapin « Pure Evil », qui me rappelle tout ce que j’ai fait de mal !
Mais vous avez exploré des formes plus sérieuses du mal, comme lorsque vous avez détourné la pochette de Sergeant Pepper avec des visages de dictateurs !
Quand j’ai fait cette image, j’avais été expulsé d’Amérique, j’étais dans les limbes. J’ai commencé à collectionner des images de dictateurs. Je découpais leurs visages dans un livre : Henri VIII, Agrippa, etc. Lire les histoires atroces de tous ces gens était une façon d’affronter ma propre lutte intérieure… Et puis je me suis dit que c’était vraiment terrible, j’avais assemblé la pire collection de salauds imaginables ! Qu’avais-je fait ? Mais c’est devenu l’une de mes œuvres qui a eu le plus de succès. Si vous voulez piller une image, alors autant choisir la plus grande pochette d’album de tout les temps. Ou l’image de la terre vue du ciel, l’une des plus vues et revues au monde, pour en faire une étoile morte, comme dans mon travail « Death planet ». J’ai rencontré Peter Blake, l’auteur de l’album original, et il était heureux de ce que j’avais fait. Il en a fini avec cette image, qui est devenue plus grande que lui.
Vos œuvres font aussi appel au hors champs, à ce que le spectateur peut savoir de l’histoire de ceux que vous représentez, comme Sharon Tate dans « Polanski’s nightmare »…
Vous pouvez espérer que les gens auront cette sorte d’intelligence, feront partie du club en quelque sorte. Mais l’idée de quelqu’un qui verrait cette image, l’achèterait simplement parce qu’il la trouve cool, et la mettrait sur le mur sans rien savoir de Polanski ni de l’assassinat de Sharon Tate, m’amuse aussi. Jusqu’au jour où quelqu’un lui racontera l’histoire derrière l’image…
Pourquoi ce travail sur l’apparence ?
 Souvent le mal n’a pas de visage. Quand vous regardez quelqu’un qui a fait quelque chose d’atroce, il a parfois l’air tout à fait charmant ! J’aime les films d’horreur. Par exemple ces magnifiques films en noir et blanc où un vampire se glisse dans la chambre où dort une jolie femme… Or dans ces films, on ne vous montre pas tout – on ne voit pas la mort, c’est dans votre tête que cela se passe. J’aime que dans mon travail, il faille gratter la surface pour trouver la noirceur. Vous pouvez regarder le portrait en noir, jaune et blanc d’une femme ravissante, et ignorer qu’il s’agit de Sharon Tate. J’aime la façon dont Andy Wahrol a raconté la tristesse et la tragédie de Jackie Kennedy à travers le portrait qu’il a fait d’elle. Je n’ai rien d’un pessimiste, mais j’aime explorer, dans mon travail, le versant le plus noir des choses, dans la vie des individus mais aussi dans l’Histoire.
Souvent le mal n’a pas de visage. Quand vous regardez quelqu’un qui a fait quelque chose d’atroce, il a parfois l’air tout à fait charmant ! J’aime les films d’horreur. Par exemple ces magnifiques films en noir et blanc où un vampire se glisse dans la chambre où dort une jolie femme… Or dans ces films, on ne vous montre pas tout – on ne voit pas la mort, c’est dans votre tête que cela se passe. J’aime que dans mon travail, il faille gratter la surface pour trouver la noirceur. Vous pouvez regarder le portrait en noir, jaune et blanc d’une femme ravissante, et ignorer qu’il s’agit de Sharon Tate. J’aime la façon dont Andy Wahrol a raconté la tristesse et la tragédie de Jackie Kennedy à travers le portrait qu’il a fait d’elle. Je n’ai rien d’un pessimiste, mais j’aime explorer, dans mon travail, le versant le plus noir des choses, dans la vie des individus mais aussi dans l’Histoire.
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Je passe mon temps à regarder de vieux films, et des documentaires. Pendant ce temps, je griffonne, je note des phrases et je fais des dessins. Regardez (Il sort un épais cahier plein de collages et de dessins et le feuillette) : un tract situationniste français, une gravure prise dans un vieux livre, une page de journal, des images faites par d’autres graffeurs, une citation, un emballage commercial… C’est une approche spectrale, un peu punk rock. Ces différentes choses se mélangent, mixent. Je crois que nous sommes entrés dans la culture du thumbler. Vous allez sur le blog de quelqu’un, et vous voyez des dizaines de photographies, vous apprenez à scanner très rapidement beaucoup d’images. Michel-Ange n’aurait jamais pu emmagasiner autant d’images en si peu de temps, mais nous sommes constamment bombardés. Nous sommes entraînés à choisir, sélectionner et mixer. Quand vous composez une chanson qui vous semble originale, elle est en fait la compilation de dizaines d’autres dont vous ne vous souvenez pas, et qui vous ont permis de créer quelque chose de neuf…
Vous avez détourné le logo des jeux olympiques. Pourquoi ce type de commentaire ironique de l’actualité vous intéresse-t-il ?
C’est un procédé que j’utilise tout le temps. Je n’ai pas de réponse complète aux questions que posent mon travail, c’est aux gens de décider. Quand je dessine un ours près d’un cochon, on peut y voir un commentaire des rapports entre l’Est et l’Ouest, mais aussi, simplement une image comique ! J’aime laisser une ouverture. Pour les JO, les sommes colossales dépensées, comme la création de ces quartiers où seuls les VIP peuvent entrer, ont créé du ressentiment et de la colère, qui pourraient se transformer en émeutes. Mon passé de designer me rend capable de faire des images à la symbolique très forte, avec beaucoup de significations imbriquées. Une image puissante, c’est quelquefois c’est aussi simple qu’un tag fait en quelque secondes, quelque chose dont la simplicité vous saute aux yeux.
L’humour noir est une constante de votre travail…
Oui, j’aime l’utiliser pour faire passer un message. Vous faites sourire, et ensuite les gens s’interrogent sur la signification plus profonde de l’image. Banksy fait ça très bien : pensez à son pochoir sur les chasseurs de caddies… C’est drôle, mais pas seulement. Là encore, les gens peuvent choisir de rester en surface, ou creuser un peu plus avant.
Dans la rue, vous faites aussi bien des pochoirs que des graffitis, pourquoi ?
Je pense qu’il est nécessaire d’avoir autant d’armes que possible. De savoir se battre, non seulement avec un couteau, mais aussi avec une hache ou un marteau s’il le faut ! Et je ne voudrais pas me contenter de faire de jolis pochoirs. Il y a quelque chose de très pur et de très beau à grimper contre un mur et à être capable de tracer quelque chose à la bombe. Je suis reste un graffeur, et pour moi il est très important d’être dans l’acte.
Vous dites compter parmi vos ancêtres Thomas More, à qui l’on doit le mot d’utopie. A vos yeux, le street art possède-t-il une dimension utopique plus marquée que d’autres formes d’art ?
Oui, je pense. Nous essayons de faire plaisir aux gens, de construire notre version d’une société idéale en plaçant de belles choses dans la rue. Je crois que nous donnons davantage. J’aurais tendance à considérer le street art comme plus généreux que l’art conceptuel ou l’art contemporain en général. Je ne dis pas qu’un Rothko n’est pas généreux, il a cette générosité de la couleur et du sentiment. Mais quelquefois l’art contemporain a quelque chose d’impénétrable, c’est un cercle fermé où les gens se sentiraient supérieurs. J’aime cet acte qui consiste à laisser une œuvre derrière soi, dans la rue, à l’offrir aux passants, j’y vois une dimension zen dans le rapport à son propre travail.
Vous revendiquez aussi plusieurs saints dans votre famille. Ce passé est important pour vous ?
Oui, c’est incroyable, mais authentique ! J’ai rejeté le catholicisme, mais j’ai toujours entretenu une forme de relation à la spiritualité. C’est étrange d’être relié à cette histoire, d’autant plus que je travaille sur cette imagerie… Quant à Thomas More, c’est un personnage inspirant, un homme de lettres exceptionnel. Et un type bien ! J’ai des amis qui n’ont pas vraiment de famille, ils se sentent un peu perdus. Quand vous avez une, c’est vraiment un ancrage. Cela fait partie de ce que je suis, et j’en suis fier. Je ne me suis jamais considéré comme un produit classique de l’histoire du graffiti, même si je suis sensible à cette histoire. J’aime l’opéra, je ne m’habille pas comme un graffeur… Ca me plaît d’avoir ce background et de l’amener dans mon travail.
Quelle place occupe la musique dans votre processus créatif ?
C’est la colonne vertébrale de ce que je fais. Ma dernière composition est un album de quinze pistes, qui correspondent à quinze cauchemars, comme mes pièces du même titre : JFK, Roman Polanski, etc. C’est une façon de lâcher de la vapeur. Je pense d’ailleurs que quand on expose, il faut aussi penser à la bande-son de ce qu’on montre. Cela me vient de ma culture de DJ. Quelquefois, il est amusant de passer de la musique classique dans la galerie, simplement pour la dichotomie entre le street art et cette beauté ancienne.
Pourquoi avoir choisi d’ouvrir une galerie ?
 Au départ, un peu par accident, pour montrer mon propre travail. J’ai commencé par le louer pour quinze jours, et je n’en suis jamais parti… L’endroit était tellement parfait ! C’est aussi mon atelier, le lieu où je fais de la musique. De toute façon la dynamique collective est une dimension importante du street art. Nous avons l’habitude de communiquer, de prêter une échelle à celui qui en a besoin, de mettre les gens en contact, de signaler un mur qui peut être investi… Si vous peignez un mur à six, c’est comme une partie de tennis à plusieurs. Et puis, j’adore proposer à quelqu’un d’organiser sa première exposition – pour lui, c’est un peu comme un premier enfant ! Même si je dois constamment trouver l’équilibre entre la galerie et mon propre travail : j’ai fait cinquante expositions au cours des cinq dernières années, c’est beaucoup !
Au départ, un peu par accident, pour montrer mon propre travail. J’ai commencé par le louer pour quinze jours, et je n’en suis jamais parti… L’endroit était tellement parfait ! C’est aussi mon atelier, le lieu où je fais de la musique. De toute façon la dynamique collective est une dimension importante du street art. Nous avons l’habitude de communiquer, de prêter une échelle à celui qui en a besoin, de mettre les gens en contact, de signaler un mur qui peut être investi… Si vous peignez un mur à six, c’est comme une partie de tennis à plusieurs. Et puis, j’adore proposer à quelqu’un d’organiser sa première exposition – pour lui, c’est un peu comme un premier enfant ! Même si je dois constamment trouver l’équilibre entre la galerie et mon propre travail : j’ai fait cinquante expositions au cours des cinq dernières années, c’est beaucoup !
Comment décririez-vous la scène anglaise actuelle ?
Ce qui est incroyable aujourd’hui, c’est la vitesse à laquelle les œuvres faites dans la rue se répandent sur Internet. Vous avez à peine eu le temps de rentrer chez vous et de vous laver les mains que cela circule déjà partout… Je pense qu’aujourd’hui, c’est vrai, beaucoup commencent parce qu’ils rêvent de devenir Banksy, d’avoir sa célébrité, et de faire de l’argent. Mais ceux qui le font pour des raisons pures sont aussi très nombreux. Ce qui est excitant, c’est le nombre d’artistes qui surgissent constamment. Vous savez, quelque part, en ce moment, un musicien est probablement en train de composer une chanson que vous allez bientôt aimez, et que vous ne connaissez pas encore. C’est la même chose pour le street art : dehors, existe un gars venu du Venezuela, du Japon ou d’Islande, sur le point de créer quelque chose qui va vous fasciner demain.
Sophie Pujas
[Visuels (de haut en bas) : Richard Burton’s Nightmare, 2011. 86 x 84 cm. Edition sur papier 300gr Fedrigoni paper // Gold leaf bunny fingers, 2011. 106 x 76 cm. Stencil and golden leaf on antique pages // Joe Di Maggio’s Nightmare, 2012. 72 x 76 cm. 3 colour Screeprint 300 gsm Fedrigoni paper // Pure Evil, 2011. 106 x 76 cm. Stencil on canvas. Courtesy Lebenson gallery Paris]
Articles liés

L’exposition “Flora Verba” invite le public à redécouvrir le langage des fleurs à la Galerie Artistik Rezo
L’exposition “Flora Verba” invite le public à redécouvrir le langage des fleurs, une dialectique ancienne et souvent oubliée, qui allie nature, poésie et symbolisme. Autour d’artistes peintres, photographes et céramistes et à travers un parcours sensoriel et immersif, cette...

L’orchestre Pasdeloup présente “Drame” à la Philharmonie de Paris
Concert digne des feux de la rampe théâtrale ! Placé sous la direction du chef vénézuélien Christian Vásquez, l’Orchestre Pasdeloup vous plonge au cœur de la nuit, la scène du drame. Après son interprétation brillante dans le Double Concerto de Brahms avec l’Orchestre...

LE BAL présente l’exposition “On Mass Hysteria / Une histoire de la misogynie” de l’artiste catalane Laia Abril
LE BAL invite l’artiste-chercheuse catalane Laia Abril (Barcelone, 1986) à présenter le dernier volet de son travail au long cours consacré à l’histoire de la misogynie : “On Mass Hysteria”. Après “On Abortion” en 2016 et “On Rape” en...