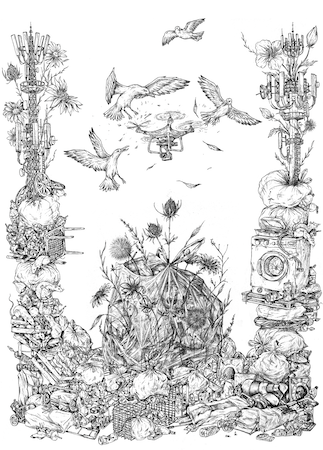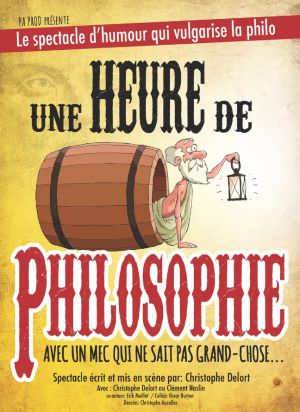Paroxysm of Sublime : d’une vision de Los Angeles à une vision du monde
Paroxysm of Sublime, vue de l’exposition. (de gauche à droite) Etienne de France, Eddie Aparicio, SMITH x DIPLOMATES, Daniel Otero Torres, iris yirei hu, Eva Nielsen. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE. Photo : Christopher Wormald
De Los Angeles et sa nature idéalisée au sentiment de solastalgie, il n’y a qu’un pas que franchissent Anna Milone et Ana Iwataki, curatrices de l’exposition Paroxysm of Sublime présentée à Los Angeles Contemporary Exhibition (LACE), et les 16 artistes en conversation dans le temps et dans l’espace autour de notre rapport à l’environnement. Anna Milone a répondu à nos questions avec Sara Favriau, Eva Nielsen et Daniel Otero Torres, artistes français ayant réalisé leurs œuvres à l’occasion de leurs résidences chez FLAX à Los Angeles, et Beatriz Cortez, artiste née au Salvador et vivant à Los Angeles.
Anna, comment ta vision de la ville de Los Angeles et de la Californie a-t-elle nourri la genèse de Paroxysm of Sublime ?
Anna Milone : Paroxysm of Sublime, dont le titre est tiré d’un poème écrit par Sara Favriau suite à sa résidence avec FLAX en 2018, est l’aboutissement de deux ans de recherches sur Los Angeles et son rapport unique à la nature. En vivant ici, on réalise que les arbres et les fleurs font partie intégrante du paysage urbain et de l’identité visuelle de la ville.
En lisant Trees in Paradise, le livre de Jared Farmer sous-titré La conquête botanique de la Californie, j’ai appris que la Californie n’avait jamais compté autant d’arbres qu’aujourd’hui, alors que paraissent régulièrement des articles sur les arbres qui succombent aux insectes ou à la sécheresse faisant écho à la dystopie souvent fantasmée et associée à la ville.
Le livre raconte l’histoire de l’écosystème de cette ville entièrement transformée par l’homme, notamment pour des raisons affectives. Aux plantes amenées par les colons afin de recréer un environnement familier se sont ajoutés, au début du XXe siècle, plantes exotiques et arbres verts dans le cadre du mouvement « imparadise Los Angeles » ayant pour objectif de transformer la ville en un jardin d’Eden idyllique selon un modèle provenant de la côte Est et d’Europe.
Ce qui nous amène à l’idée de « solastalgie » ?
D’après Jared Farmer, la colonisation naturelle est la plus insidieuse, puisqu’elle semble naturelle ! En réfléchissant à ces idées de nature agencée pour représenter un endroit idéal mais aussi de plantes amenées afin de recréer un environnement familier, j’ai découvert le concept de « solastalgie » développé par le philosophe australien Glenn Albrecht. Il décrit une maladie psychosomatique affectant l’humanité dans son ensemble et dont le symptôme est la perte de familiarité avec notre environnement qui se transforme très rapidement.
Ce sentiment d’étrangeté puis d’hostilité qui nous gagne sans avoir jamais quitté notre environnement nous a guidés à travers un voyage philosophique et amenés à analyser et déconstruire des concepts tels que nature, culture, foyer ou environnement essentiellement hérités des Philosophes des Lumières. Cela nous conduit à repenser notre vision du monde humaniste et humano-centrée, et le rapport que nous entretenons aujourd’hui avec notre environnement d’un point de vue social, économique et écologique.
Les artistes réunis pour l’exposition racontent l’histoire de cet échange entre l’Ancien et le Nouveau Monde et le début de l’exotisme à travers le voyage de plantes, l’éclosion de cette vision humaniste et romantique de la nature, ou d’autres connexions entre l’être humain et la nature, mais aussi l’histoire de philosophies spéculatives rejetant notre paradigme actuel en s’inspirant des mondes sous-terrain et des parasites, du cosmos, ou de situations fictives comme « Le Soleil dévorant la Lune ».

Paroxysm of Sublime. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE. Sara Favriau, Miel, 2019. Techniques mixtes. Dimension variable © Christopher Wormald
Sara, Miel navigue poétiquement entre Paris et Los Angeles, quelle est son histoire ?
Sara Favriau : je suis venue à Los Angeles choisir des essences d’arbres trouvables à la fois en Europe et à Los Angeles et réfléchir au produire local. J’ai décidé de retracer tout le chemin de fabrication du bois jusqu’au contreplaqué avec une essence dominante, le bouleau. Boîtes de transport et pièces sont faites de la même essence.
Ensuite, j’ai voulu faire voyager mes œuvres sans revenir à Los Angeles pour deux raisons. On parle en ce moment plus de nature que d’humain bien que tout soit lié, et il y a ce clin d’œil à Joseph Beuys et à son non engagement corporel lorsqu’il a décidé de ne pas fouler le sol américain mais de se confronter à un coyote, en abordant notamment ces idées de sauvagerie et d’apprivoisement.
D’où les boites tapissées de feutre et les pièces incisées qui font allusion au pansement et à la cicatrice. La pièce Colonies, avec ses écorces de bouleau dans une branche d’olivier, évoque une forme de colonisation de deux essences avec la notion de bouture, l’intrusion du feutre, et l’intervention de l’homme qui a transpercé une branche pour y introduire autre chose.
J’ai voulu aller vers l’animisme, la transhumance, l’altérité, ritualiser le transport aussi et interroger les notions de voyage, de disparition, de culte de la personne, puisque je suis absente pour l’installation et le vernissage même si j’ai pensé la mise en espace.

Paroxysm of Sublime. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE. Sara Favriau, Une voix béante, un genre tandem. C’était la paix, 2019. Bouleau, contreplaqué bouleau, lin, feutre, olivier. Dimension variable © Christopher Wormald
Nature, humain, comment ta réflexion se retranscrit dans ton travail ?
Je me rends compte que toute ma vie est tournée vers une forme équivoque et sensible, peut-être bien un peu animiste, mais de très loin, bien sûr.
Mon travail éclectique a beaucoup comporté de références à l’histoire de l’art et navigué entre un côté sauvage et la sculpture qui, avec l’aspect conceptuel, s’affirment avec le temps. J’écris aussi de la poésie. Je suis double à divers niveaux et me dis que j’ai aujourd’hui toute ma place pour continuer à faire confiance à l’intuition et explorer les idées d’analogies et de rapprochements sensibles.
À la lecture de Baptiste Morizot et Nastassja Martin sur le temps du mythe, temps dévolu aux créatures hybrides donc ingérables, je plaisante en suggérant être ce spécimen, de par mon éclectisme. Rester à l’écoute de l’état sensible, c’est aussi se rendre compte de cette pluralité. D’ailleurs cette œuvre est hybride, plurielle, bâtarde. Miel est une proposition poétique qui cherche à trouver le chemin d’un langage éthique, et non moral et aborde l’idée de traverser, mais pas seulement l’océan. C’est aussi être traversée par l’œuvre que je fais, de même, je l’espère, que ceux qui la voient.
Eva, tes toiles ressemblent à des collisions entre des paysages classiques et des fragments d’architecture moderne ; qu’est-ce qui t’a marquée à Los Angeles ?
Eva Nielsen : je suis venue deux fois en résidence à Los Angeles. J’ai d’abord ressenti une fascination pour la ville avec ce regard cinématographique, sans doute comme beaucoup de monde. La deuxième fois, j’ai vu les fêlures, je me suis concentrée sur l’histoire, la structure et les connexions entre les quartiers, car rien n’est caché à Los Angeles. Des séquences puissantes et différentes se succèdent quand on l’explore. J’ai d’ailleurs été fascinée par la Los Angeles River où j’ai passé beaucoup de temps.
J’adore parcourir les quartiers périphériques partout où je passe et y observer les évolutions, les constructions ou les destructions. Je suis allée à Detroit, Chicago, Toronto, Pittsburg… et suis attirée par ces processus et l’idée de strates dans la ville qui sont liées à l’histoire de chaque lieu. En réalité, architecture et logement sont toujours reliés à des aspects plus profonds.

Paroxysm of Sublime. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE. Eva Nielsen (de gauche à droite) Polhodie III, 2019 (78.75 x 71 in), Hard Sun, 2017 (35.4 x 27.5 in) Collection of Danny First Los Angeles, Aphakie, 2019 (75 x 55 in). Huile et sérigraphie sur toile © Christopher Wormald
L’exposition étant une conversation à travers le temps et l’espace, tes œuvres répondent à une toile d’Hubert Robert…
Pour rire, j’ai dit un jour à Anna Milone que voir mes toiles exposées à côté de celle d’Hubert Robert était comme faire la première partie de mon groupe de musique favori ! Il était très original pour son temps et était fasciné par des détails que les gens ne remarquent pas, ce qui me parle, car les villes sont faites d’innombrables matériaux et détails insignifiants qui nous survivent et nous racontent, avant de disparaître à leur tour. L’architecture est l’histoire de ce que nous laissons mais aussi de notre vanité. Nous bâtissons en sachant que les villes perdureront après nous.
J’utilise des fragments de ces villes redimensionnés et reproduits grâce à la sérigraphie. À la lumière de Los Angeles qui souligne les contrastes, les détails des matériaux se révèlent parfaitement. Pendant la « golden hour », on peut même y distinguer les grains de poussière.
Daniel, El Borrachero est le fruit de ta résidence chez FLAX à Los Angeles en 2019, tu es né en Colombie, vis en France. Comment ton approche transversale influence-t-elle ton travail ?
Daniel Otero Torres : je suis arrivé en France à 19 ans. Vivre à l’étranger m’a apporté une vision double et globale. La perception de la différence change en réalisant à la fois ce que l’on trouve et ce que l’on quitte. Éprouver le manque tout en se trouvant plongé dans un apprentissage constant constitue un moteur important : le courant continu de recherche et de création généré permet de surmonter ce vide particulier dont la forme évolue ensuite au gré des nouvelles expériences.
On est étranger dans le regard des autres non seulement dans chacun de nos deux mondes, mais aussi à l’intérieur de soi. Je suis issu de ce métissage culturel. Dans mon travail, même si je n’oublie pas mon pays d’origine, la question du sujet est devenue plus tournée vers l’Amérique Latine et plus globale, comme le sont nos problématiques actuelles.
L’idée qui anime mon travail est notre capacité à nous projeter ailleurs en fonction de notre subjectivité propre. Pour moi, vivre ailleurs et apprentissage sont étroitement connectés. Être né en Colombie et vivre en France sont intimement liés à mon approche.
La photographie est l’une des premières phases de mon travail. Mes sujets se retrouvent et existent dans un espace exempt de toute hiérarchie culturelle. J’ai perçu Los Angeles comme un ensemble d’enclaves multiples, et sa diversité culturelle comme un puissant point de fusion rendant la relation à l’autre constamment possible.

Paroxysm of Sublime. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE.
Daniel Otero Torres, El Borrachero, 2019. Aluminum, acier inoxydable. Dimension variable © Daniel Otero Torres
Ce mobile, El Borrachero, fait allusion au Bogotazo…
El Borrachero est un ensemble de dessins de mains sur aluminium en mouvement constant, un retour aux origines d’un moment important de l’histoire de Colombie. Il fait le lien entre passé, présent et ce qu’il se passe à l’échelle mondiale et en Amérique Latine actuellement, avec cette montée de manifestations visant à réveiller nos gouvernements.
À Los Angeles, les fleurs sont appelées « Angel’s Trumpets » et ont été introduites pour leur propriété decorative. En Colombie, on appelle ces brugmansias suspendues « Borrachero ». Quand on parle de la fleur, il y a souvent cette contradiction entre sa beauté et son usage réel. Les Muiscas, une ancienne communauté colombienne, l’utilisaient pour des rituels. Cette fleur aux nombreuses vertus médicinales comporte une substance, la scopolamine, qui peut entraver notre faculté à constituer des souvenirs et inhiber temporairement notre libre arbitre.
Les mains sont extraites d’une photographie de Sady Gonzales datant de 1948, à l’époque des émeutes du Bogotazo qui a été provoqué par l’assassinat du chef du parti libéral, Jorge Elieser Gaitan. Ces mains brandissent des machettes, des bâtons et d’autres objets. Je les ai effacés ; de la même façon, tout autre objet peut remplacer mentalement le vide laissé dans ces mains. Le choix du mobile était pour moi le moyen d’exprimer l’inertie et le mouvement constants que l’on ressent dans les manifestations.
Beatriz, parlez-nous de votre installation Our Roots …
Beatriz Cortez : recréée pour l’exposition Paroxysm of Sublime, cette œuvre Our Roots datant de 2014 explore nos racines, concept souvent utilisé en référence aux peuples indigènes américains par des latino-américains d’origine non indigène. Ceci contribue à renvoyer les peuples indigènes vers le passé, tout comme le discours émanant des états, et celui que le colonialisme a véhiculé pendant des siècles, mais aussi à concevoir les peuples indigènes comme une composante arrêtée de notre passé, arriérée et primitive.
Or mon travail est tout l’inverse ; je collabore avec des communautés indigènes et compte de nombreux amis, mentors et collaborateurs indigènes. Je veux imaginer leur savoir, leur technologie et leur culture traverser le temps. C’est le sujet de cette installation qui explore également ceux de la diversité (toutes ces racines sont différentes), de la croissance rhizomatique (les racines poussent dans toutes les directions), et de la vie sous terre, celle du monde souterrain, sur lequel mon travail a récemment porté. S’il n’est pas celui de l’être humain, il regorge de vie, de négociations, d’interactions…

Paroxysm of Sublime. France Los Angeles Exchange (FLAX) au LACE. Beatriz Cortez, Our Roots / Nuestras raíces, 2014-2019. Plantes et arbres. Dimension variable. Photo : Christopher Wormald.
Les conversations A Rush of Stories ont été l’occasion d’approfondir le propos de Paroxysm of Sublime. Le 22 octobre, vous avez parlé de ce que vous appelez « Un Dialogue de Nomades : conversation entre immigrants de couleur et philosophes français décédés » …
Je souhaitais montrer comment des philosophes comme Pierre Clastres, Gilles Deleuze ou Félix Guattari avaient exploré la question des communautés indigènes sur le continent américain, tout particulièrement à travers La Société contre l’État, cette œuvre majeure de Clastres sur la vie et la politique en dehors de la modernité.
Deleuze and Guattari ont développé ces idées, notamment en conceptualisant l’idée du nomade, la machine de guerre, ou en concevant le temps indépendamment de toute chronologie. J’ai voulu illustrer la façon dont les immigrants de couleur comme moi, les chercheurs ou les artistes qui travaillent à Los Angeles et qui m’ont inspirée, perpétuent cette conversation entre ces pensées relatives aux circulations, au nomadisme, et les philosophies indigènes sur la manière d’investir notre monde.
Je voulais surtout remettre en question l’idée que ces travaux philosophiques soient français ou latino-américains. En tant que penseuse du nomadisme, je n’imagine pas que des idées puissent être celles d’une nation, elles viennent en réalité d’ailleurs. J’ai parlé de l’exil de Spinoza, quand il était coupé de sa terre et des siens, car il travaillait sur cette idée de la vie en dehors de la modernité. Pour moi, toutes ces idées sur le nomadisme sont connectées à travers le temps et l’espace, elles ne respectent aucun schéma ni frontière.
Propos recueillis par Dorothée Saillard
Notamment en cours ou à venir :
Sara Favriau, exposition Un instant avant le monde, Biennale de Rabat
Du 24 septembre au 18 décembre 2019
Eva Nielsen, exposition Persona Grata ? au MAC VAL
Du 30 mars 2019 au 5 janvier 2020
Daniel Otero Torres, exposition Así fue, The Pill, Istanbul, Turquie
Du 20 novembre au 20 janvier 2020
Beatriz Cortez, Memory Insertion Capsule : exposition In Plain Sight, Henry Art Gallery, Seattle, États-Unis
Du 23 novembre 2019 au 26 avril 2020
Articles liés

“Vade Retro” le nouveau film d’Antonin Peretjatko en salle le 31 décembre
Norbert, vampire de bonne famille aristo-réac, doit trouver une femme de sang pur à mordre et à épouser s’il veut survivre et ne pas être renié par ses parents. Envoyé en bateau au Japon, accompagné de son valet gardien...

Célébrez le Nouvel an avec l’Orchestre Lamoureux à la Salle Gaveau
L’Orchestre Lamoureux vous invite à célébrer la nouvelle année à la Salle Gaveau avec une série de concerts aux accents viennois. À la fois soliste et cheffe d’orchestre, la brillante musicienne italienne Vanessa Benelli Mosell mène la danse, du...

“Tout va mâles ?” le nouveau spectacle d’Alex Goude au Grand Point Virgule
Après, « Théatrouille », « Timéo » et « Ménopause », venez découvrir le nouveau spectacle musical d’Alex Goude, dédié aux problèmes des hommes… Thomas, 58 ans, PDG d’une agence de pub, Romain, 42 ans, bibliothécaire, Jérémy, 25 ans, coach sportif, n’ont absolument rien en...