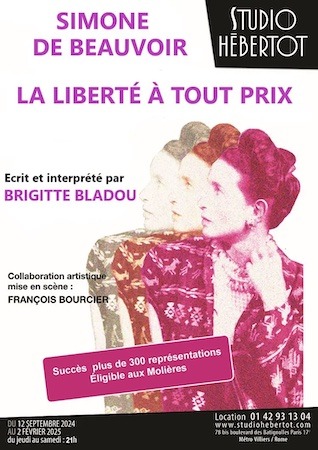Graffiti @ Fondation Cartier
Pour désamorcer la tension polémique, la Fondation Cartier a dû forcer le trait. Pari difficile que de lever la contradiction inhérente au geste même de capturer le sauvage, de saisir l’éphémère, de clôturer un espace par essence libre de toute espèce de délimitation, d’enfermer la protestation dans un couloir de résonance toujours trop étroit pour elle. Une tension qui est aussi palpable du côté du spectateur qui se précipite aujourd’hui dans les salles du musée pour y contempler un art urbain qu’il appelait hier encore acte de vandalisme.
De l’écriture murale à la peinture urbaine
L’exposition de la Fondation Cartier, restituant avec pertinence et originalité les temps forts de l’évolution du graffiti en mettant au jour la ligne de fond de cette dynamique graphique urbaine – de la signature sur rue spontanée à la fresque sur toile stylisée – permet de ressaisir les motifs profonds de la conversion du geste illégal en art reconnu. Avec un dispositif déployé en trois unités, l’exposition file la trame d’une histoire révolutionnant le cours de l’écriture graphique et redessinant, avec un trait subvertissant tous les pouvoirs au profit de l’affirmation de sa force propre, les contours du paysage urbain.
Les premières salles du sous-sol, plongées dans une ambiance tamisée, favorisent la visibilité de certains points lumineux venant éclairer, comme autant d’astres gravitant autour d’un même axe, la scène d’émergence du graffiti. Consacré aux années des premiers tâtonnements et balbutiements de cette forme d’expression encore naissante, l’espace souterrain désigne le nom des grands acteurs du mouvement – des pionniers éclairés aux dignes héritiers qui s’en sont librement inspiré – tous au fondement de son éclosion, circonscrivant chacun un rayon de ce cercle artistique à capacité d’extension illimitée.
Un circuit qui s’amorce au début des années 70, dans les quartiers populaires new-yorkais, là où les minorités ethniques, essentiellement afro-américaines et hispaniques, donnent au mouvement sa première impulsion en lançant à coups de bombes et de marqueurs une offensive visant le déplacement des frontières d’une culture officielle venant jusqu’alors flatter le reflet déformé des classes supérieures. S’agissant de figurer au centre plutôt qu’en marge, les premiers writters, ignorant encore tout du chapitre de l’histoire qu’ils sont en train d’ouvrir, signent de leur main habile l’espace urbain, recouvrent de leurs noms propres les surfaces publiques, les détournant en supports de visibilité, les élevant parfois même au rang d’écran graphique projetant, au devant de la société mais toujours en dehors du système, l’écriture d’une autre culture urbaine signant à son tour l’histoire d’une génération nouvelle.
 Polis de caractère
Polis de caractère
Dans les quartiers de Manhattan, du Bronx ou de Brooklyn, les writters new-yorkais, authentiques précurseurs du mouvement Graffiti, âgés de quinze ans à peine, passent leur temps à œuvrer contre le désoeuvrement. Prenant appui sur le socle de leur culture brute taillée dans le béton, ils rivalisent, se mettent au défi et redoublent de créativité. Véritables héritiers de la contre-culture des années 60, les pionniers du graffiti libèrent une énergie créatrice dont l’effervescence est à la mesure de la vitalité de leur parole populaire. Symptômes d’un certain malaise dans la civilisation, les premiers tags sont une façon presque comme une autre de révéler l’existence de minorités silencieuses rejetées en marge de la culture de masse et de retourner cette invisibilité en exhibition de talents toujours plus spectaculaires.
À l’origine et au fondement même de son élaboration, le graffiti procède d’une nécessité qui lui est tout intérieure. Si les premières signatures rudimentaires mais efficaces, Julio 204, Taki 183 ou Joe 182, se sophistiquent à mesure que le mouvement prend de l’envergure par-delà les frontières de son contexte originaire – les quartiers défavorisés de la banlieue new-yorkaise, autant recouverts de tags que peuplés de minorités ethniques en recherche d’identité – ce n’est pas en tout premier lieu dans le but d’un perfectionnement artistique, encore moins dans l’intention d’un certain raffinement esthétique ; c’est essentiellement le moyen pour les premiers graffeurs de se distinguer les uns des autres, de s’individuer dans le champ d’un paysage urbain sans cesse investi par de nouveaux writters.
Frères rivaux, admirant et convoitant les techniques ou esquisses encore inédites s’inventant sans cesse dans les black books, les graffeurs donnent forme à des créations toujours plus originales et toujours plus recherchées. Réinstrumentalisant la langue, la détournant et la complexifiant parfois à la limite du déchiffrable pour les non-initiés – un pixadores de Sao Paulo s’avouant illettré et donc impuissant dans sa propre langue se déclare au contraire capable de déchiffrer n’importe quel pixaçaos – les précurseurs réinventent les codes et retissent les maillages d’une hiérarchie dont ils ont bouleversé les étages, restructurent la géométrie d’un schéma dont ils ont déplacé les lignes. Master, King, ou simple Toy, chaque graffeur est à sa place dans l’univers réglé du graffiti. Une place mobile, une place dont chacun doit sans cesse repousser au-dehors les limites pour se faire un nom, une identité codée mais visible et lisible à travers les rues de la ville.
Les années 80, point focal concentrant les expériences graphiques et musicales les plus inventives, marquent un tournant décisif : le langage se fait image et la signature, picture. Les graffitis, recouvrant les rames de métro jusqu’à dissolution intégrale de l’objet et apparition phénoménale de l’œuvre, se complexifient. Ces créations mobiles, les whole cars, pièces monumentales à signature unique, sont véhiculées à travers toute la ville. Né dans la rue, le graffiti est partout chez lui.
 Rumeurs de rue
Rumeurs de rue
A l’intérieur comme à l’extérieur, la Fondation Cartier s’est efforcée de restituer l’esprit du graffiti en rassemblant deux semaines avant l’inauguration des lieux une dizaine d’artistes graffeurs formant le cercle des figures les plus influentes du mouvement d’hier et les plus représentatives de la création d’aujourd’hui – parmi lesquels JonOne, Vitché, Delta – tous chargés de réaliser, en temps réel et sous les yeux du public, de grands formats recto verso se dressant de façon proprement monumentale dans l’important volume du rez-de-chaussée. Des œuvres vibrantes témoignant de la variété des styles contemporains et exemplifiant à merveille l’étonnante diversité des courants actuels. Des toiles uniques spécialement dédiées à l’installation de la Fondation et qui seront pour cette raison, dès la clôture de l’exposition, conformément à la temporalité éphémère des œuvres de rue, tour à tour détruites.
Au-dedans, les courts et moyens-métrages permettent de ressaisir l’atmosphère fiévreuse du graffiti. Soit au travers du témoignage encore vibrant des précurseurs dont la mémoire nous introduit au cœur de l’aventure encore tâtonnante du graffiti. Soit à la lumière de la projection d’un concentré de culture urbaine dans le tournant des années 80. Soit encore à la découverte d’un documentaire inédit réalisé par Roberto T. Oliveira sondant les profondeurs du quotidien tourmenté des pixadores, jeunes des quartiers pauvres de Sao Paulo, tous originaires des favelas, dont l’esprit de révolte et le désir de reconnaissance résonnent avec ceux de leurs frères new-yorkais.
Au-dehors, sur la façade extérieure de la Fondation, des fresques murales cernant la périphérie des lieux et faisant appel à la créativité spontanée de graffeurs professionnels invités à participer à l’exposition, revitalisent l’esprit et la matière mêmes du graffiti en en reproduisant grandeur nature le contexte original de création et en en concentrant les conditions d’émergence. En le mettant en scène et en oeuvre dans le seul espace qui lui soit, par essence, authentique, le graffiti renaît à la rue.
Si la Fondation Cartier est un lieu dont la sobriété menace parfois d’aseptiser, voire de neutraliser les thématiques qui y sont présentées, les installations sonores et visuelles mises en place dans la perspective de l’exposition viennent cette fois renforcer le pouvoir d’évocation des années graffiti, contemporaines de l’avènement du Street Art et marquées par la naissance de nouvelles formes d’expression artistiques solidaires plus tardives, telles que le break, le hip-hop ou le rap. Autant de rappels à caractère explicite ou subliminal qui font courir dans les couloirs de la Fondation – eux-mêmes recouverts d’inscriptions ressuscitant l’esprit des plus belles années du graffiti – la rumeur de cette époque où la rue, les terrains vagues et les rames de métro étaient encore les plus vastes espaces d’expression et d’expérience artistiques, favorisant la libre circulation des idées, le partage des techniques de réalisation et la permanente visibilité des talents.
Nora Monnet
Graffiti
Prolongation jusqu’au 10 janvier 2010
Ouverture tous les jours sauf le lundi
De 11h à 20h / Nocturne le mardi jusqu’à 22h
Renseignements au 01 42 18 56 52
Fondation Cartier
261, boulevard Raspail 75014 Paris
Métro : Raspail / Vavin
Bus : lignes 38, 68
Articles liés

L’exposition “Flora Verba” invite le public à redécouvrir le langage des fleurs à la Galerie Artistik Rezo
L’exposition “Flora Verba” invite le public à redécouvrir le langage des fleurs, une dialectique ancienne et souvent oubliée, qui allie nature, poésie et symbolisme. Autour d’artistes peintres, photographes et céramistes et à travers un parcours sensoriel et immersif, cette...

L’orchestre Pasdeloup présente “Drame” à la Philharmonie de Paris
Concert digne des feux de la rampe théâtrale ! Placé sous la direction du chef vénézuélien Christian Vásquez, l’Orchestre Pasdeloup vous plonge au cœur de la nuit, la scène du drame. Après son interprétation brillante dans le Double Concerto de Brahms avec l’Orchestre...

LE BAL présente l’exposition “On Mass Hysteria / Une histoire de la misogynie” de l’artiste catalane Laia Abril
LE BAL invite l’artiste-chercheuse catalane Laia Abril (Barcelone, 1986) à présenter le dernier volet de son travail au long cours consacré à l’histoire de la misogynie : “On Mass Hysteria”. Après “On Abortion” en 2016 et “On Rape” en...