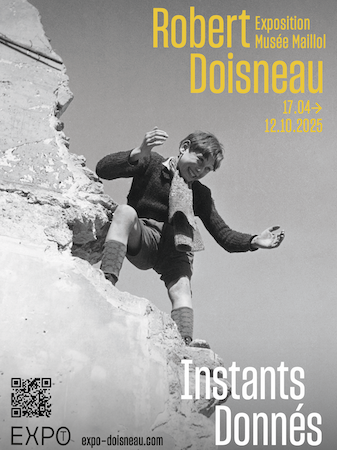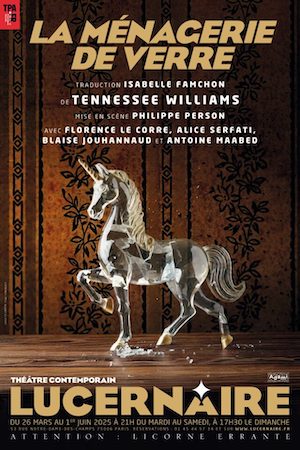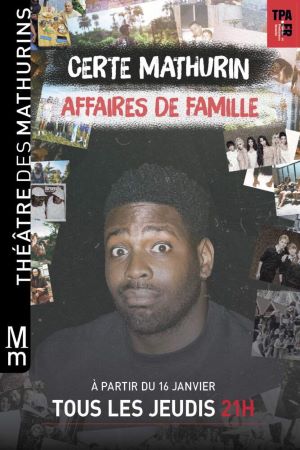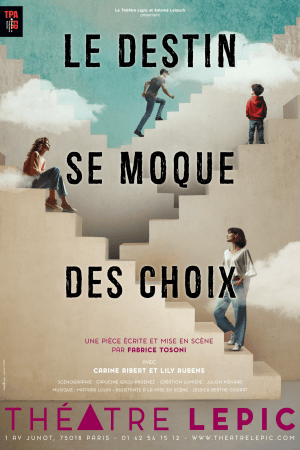JonOne – interview “Quand on crée, il faut vouloir donner, pas calculer”
|
JonOne |
Né en 1963, JonOne fut une figure emblématique du graffiti new-yorkais, avant de s’installer en France à la fin des années quatre-vingt, et de tracer son propre chemin. Rencontre. Comment avez-vous commencé à créer ? En écrivant mon nom dans le métro. Assez tôt, j’ai regardé ça comme une forme d’art. Même si c’était un acte de vandalisme. J’adorais aller dans les trains avec des litres et des litres d’encre industrielle. Une encre méchante qui gratte, entre dans les peaux… J’aimais que ça coule, que mon nom soit écrit partout sur les sièges. Ce qui me faisait marrer, c’était de venir le matin, et de voir les gens très bien habillés s’asseoir sur mon nom, et se lever avec. Je trouvais ça beau ! A l’époque, je n’étais pas compris. Ma vie, c’était un échec après l’autre. J’appartenais à une génération délaissée, ratée. Le seul bonheur que j’avais, c’était la couleur. Vous étiez en colère ? Vous sentiez déjà que vous alliez en faire votre vie ?
Vous ressentez de la nostalgie pour cette période ? En un sens, oui, mais je ne me construis pas sur ça. Je suis né à Harlem, je n’ai jamais vu la rue comme ce joli cadre où tout le monde serait gentil et s’aimerait. Non, c’est un lieu très hostile. Il y a de la souffrance, des gens qui dorment dehors. Si je cessais de vendre, je pourrais peut-être passer de l’autre côté, me retrouver à l’Armée du salut… Ce type de violence est revendiqué dans mon travail. Mais le passé est une partie de moi qui ne m’inspire pas de nostalgie. Aujourd’hui, mon travail bouge différemment, dans des galeries. Mais dans vos toiles, vous avez conservé l’énergie d’alors, non ? Oui, c’est vrai. Je suis tendu, en permanence. Il faut me voir comme une voiture. Pas une twingo, mais une Porsche Panamera, une BMW, ou une Austin Martin (Rires). Des voitures puissantes, rapides. Aujourd’hui, je ne suis qu’en deuxième vitesse. Je pourrais aller en dixième… L’une des qualités, en peinture, c’est la patience. Je dois attendre mon tour. Il y a beaucoup d’artistes ici en France. J’attends une opportunité pour tester mon potentiel, voir jusqu’où je peux aller avec.
Oui. J’ai entendu dernièrement que pour Matisse, l’important, c’était d’avoir l’idée d’abord. Il disait qu’on travaille à l’envers : on a l’idée, ensuite on fait en sorte de l’accomplir. Je crois que c’est un peu comme ça que je travaille. J’ai une idée de combinaison de couleurs par exemple, et ensuite j’essaye de la réaliser au plus près. En ce moment, par exemple, j’ai envie de faire beaucoup de noirs et blancs. Parce que j’ai fait tellement de toiles en couleurs par le passé. Je vais donc commencer à faire du noir et blanc, et voir où cela me mène. L’inspiration, c’est ça. Vous rappeliez que vous étiez un autodidacte. Matisse fait partie de ceux qui ont compté pour vous ? Oui, j’aime la façon dont il remplit la couleur, et il fait partie de ma palette d’inspiration comme artiste. Je suis dans la recherche d’inspiration, non-stop. On m’a souvent comparé à Kandinsky, mais aujourd’hui, ce n’est plus tellement vrai. Ce qui m’inspire, c’est aussi le mystère d’un artiste. Et j’aime les artistes qui se salissent. Pour mon travail, j’entre dans la toile. Je ne fais pas partie de ceux qui ont une petite palette et créent une barrière entre eux et la toile. Parfois, ça fonctionne ! Mais moi, je suis physique avec la toile. Je me souviens d’images de Kandinsky avec une cravate – c’est très bien, ça ne me dérange pas. Mais quand je vois des photos de Giacometti dans son atelier, les cheveux en bataille, tout sale, je m’identifie à lui beaucoup plus. Parce que mon parcours, ça a été ça, me salir. Qui d’autre vous a nourri ? Marc Rothko, Robert Motherwell, Jonathan Messe, Yang Pei-Ming, Miquel Barceló, Diego Rivera, Frida Kahlo… Vous voyez, c’est très divers… Et je change tout le temps…
Pourtant, vous avez appartenu à des collectifs, comme le 156 All Starz… Oui, mais ce n’était pas l’essentiel. J’ai toujours été un individu. Je pensais « moi », pas « nous ». J’avais des problèmes immenses dans ma vie, et la seule façon pour moi de trouver la paix, c’était la peinture. J’ai trouvé mon petit secret du bonheur, que j’arrive à partager… Je ne crache pas dessus. C’est impossible de peindre sans argent. Il faut savoir jongler entre la créativité et un marché qui réclame sans arrêt des toiles. Il faut rester maître de son atelier. Je cherche la nouveauté. Ce qui me plaît, c’est d’avoir des opportunités de travailler. Mon langage commence à être vu différemment. Mes toiles sont une jungle, et on pose sur elle des yeux plus neufs. Récemment Air France m’a demandé une couverture pour un magazine diffusé à 350’000 exemplaires, dans tous leurs avions. C’est une nouvelle façon de véhiculer mon nom. Une façon de s’imposer, pas dans le Street Art, mais dans la peinture, tout simplement ! De faux JonOne ont même circulé récemment en salle des ventes… Produits par des parasites ! Il y a des gens qui pensent que l’argent facile existe. Moi, je n’ai jamais joué au loto. L’argent facile, ça ne m’intéresse pas, je suis sur terre pour travailler, peindre. Votre dernière exposition s’appelle « Transformations ». Pourquoi ?
Propos recueillis par Sophie Pujas
[Visuels : œuvres de JonOne. Encre et acrylique sur toile / 2012. Courtesy Galerie Rive Gauche-Marcel Strouk] |
Articles liés

“PERDRIX” une pièce déroutante et onirique au théâtre du Troisième Type
Trois marcheurs revisitent leurs existences à travers un monde en ruines. Une odyssée entre ville et campagne, rêve et réalité. Dans un monde obscur et désolé, une jeune femme cherche à quitter la ville. Une nuit de brouillard, elle...

Streetoyenneté, une exposition qui ouvre le regard sur la citoyenneté
Dans un monde en perte de sens et soumis à de fortes turbulences, face à la déconsolidation démocratique et aux nombreux défis, tant humanistes qu’écologiques, le dispositif Streetoyenneté analyse pour mieux renforcer la notion de citoyenneté, à travers une...

“Vieille Petite Fille” une réécriture poignante du Petit Chaperon rouge au Théâtre du Troisième Type
Entre réécriture libre du conte du Petit Chaperon rouge et autofiction, Vieille Petite Fille est un récit d’affirmation et d’émancipation qui s’appuie sur le célèbre conte pour mettre au grand jour les mécanismes d’aliénation matrilinéaires. L’écriture de cette pièce...




 Je ne me suis jamais vu comme l’artiste classique, passé par les Beaux Arts, qui réfléchit sur le monde d’une façon peut-être plus scolaire. Je suis un autodidacte, un passionné. C’est de moi-même que je me suis cultivé, que j’ai appris à aimer tel ou tel artiste. Mais je voulais participer à cette peinture qui me donnait tellement de joie. Je pense que mon travail très coloré donne le sourire, c’est une fête. Dans l’existence oubliée que je menais, ma peinture, c’était mon bijou. Quand j’ai commencé à voir le bonheur que les gens pouvaient avoir à travers mon travail, oui, j’ai commencé à me sentir artiste. Quand j’ai compris que je pouvais transmettre des sentiments, un message, par ma peinture.
Je ne me suis jamais vu comme l’artiste classique, passé par les Beaux Arts, qui réfléchit sur le monde d’une façon peut-être plus scolaire. Je suis un autodidacte, un passionné. C’est de moi-même que je me suis cultivé, que j’ai appris à aimer tel ou tel artiste. Mais je voulais participer à cette peinture qui me donnait tellement de joie. Je pense que mon travail très coloré donne le sourire, c’est une fête. Dans l’existence oubliée que je menais, ma peinture, c’était mon bijou. Quand j’ai commencé à voir le bonheur que les gens pouvaient avoir à travers mon travail, oui, j’ai commencé à me sentir artiste. Quand j’ai compris que je pouvais transmettre des sentiments, un message, par ma peinture.  Naturellement, non, puisque rien ne se fait naturellement dans la peinture, il n’y a pas de route facile, jamais. C’est arrivé grâce à des hasards. Quand j’habitais à New York et que je vandalisais, j’avais envie d’autres sensations par rapport à mon travail. De voir ce que je pouvais faire de plus. J’ai commencé à fréquenter des artistes. Je voyais qu’ils faisaient des vernissages, des expositions. Au début, je ne comprenais pas trop l’idée ! Je trouvais même ça un peu naze, je préférais avoir un impact direct, que les gens s’en prennent plein la gueule, d’un coup ! Mais après des années dans la rue, je cherchais un nouveau type de complicité avec ceux qui aimaient mon travail. Plus concret, plus profond. Je réfléchissais aussi au fait que mon travail était éphémère. Je voulais laisser une trace.
Naturellement, non, puisque rien ne se fait naturellement dans la peinture, il n’y a pas de route facile, jamais. C’est arrivé grâce à des hasards. Quand j’habitais à New York et que je vandalisais, j’avais envie d’autres sensations par rapport à mon travail. De voir ce que je pouvais faire de plus. J’ai commencé à fréquenter des artistes. Je voyais qu’ils faisaient des vernissages, des expositions. Au début, je ne comprenais pas trop l’idée ! Je trouvais même ça un peu naze, je préférais avoir un impact direct, que les gens s’en prennent plein la gueule, d’un coup ! Mais après des années dans la rue, je cherchais un nouveau type de complicité avec ceux qui aimaient mon travail. Plus concret, plus profond. Je réfléchissais aussi au fait que mon travail était éphémère. Je voulais laisser une trace.  Bonne question… Ce n’est pas si facile de vous donner des noms. J’aime bien quand c’est « hardcore ». Je ne parle pas de prendre des risques à la con, mais d’avoir un style. Je viens de voir dans la rue des flops faits avec des rouleaux, il y a un côté brut, pas calculé, que je trouve beau. Le geste, l’action, le risque, je peux l’étudier, le regarder longtemps. Les jolis pochoirs, ce n’est pas forcément mon truc. Quelqu’un qui scanne une image, la photoshoppe, c’est cool, mais je ne me souviens jamais de son nom. Ce n’est pas que je ne regarde pas, au contraire. Mais comme pour le style vestimentaire, tout le monde a l’air de se conformer plus ou moins à une norme… Aujourd’hui, quand on parle de Street Art, on parle beaucoup de d’activisme social et communautaire. De partage, d’embellissement de la collectivité. Mais moi, je suis plutôt dans un travail égocentrique sur moi-même… J’ai dû écrire mon nom un million de fois !
Bonne question… Ce n’est pas si facile de vous donner des noms. J’aime bien quand c’est « hardcore ». Je ne parle pas de prendre des risques à la con, mais d’avoir un style. Je viens de voir dans la rue des flops faits avec des rouleaux, il y a un côté brut, pas calculé, que je trouve beau. Le geste, l’action, le risque, je peux l’étudier, le regarder longtemps. Les jolis pochoirs, ce n’est pas forcément mon truc. Quelqu’un qui scanne une image, la photoshoppe, c’est cool, mais je ne me souviens jamais de son nom. Ce n’est pas que je ne regarde pas, au contraire. Mais comme pour le style vestimentaire, tout le monde a l’air de se conformer plus ou moins à une norme… Aujourd’hui, quand on parle de Street Art, on parle beaucoup de d’activisme social et communautaire. De partage, d’embellissement de la collectivité. Mais moi, je suis plutôt dans un travail égocentrique sur moi-même… J’ai dû écrire mon nom un million de fois ! Parce que j’ai l’impression d’être un lézard – en mue ! Je pense que je suis aujourd’hui dans la période la plus intéressante de ma vie. Je me sens bien, jamais avant je n’avais jamais senti cette liberté, cette puissance, cette confiance. Mon travail, c’est avant tout une énergie. Mes images ne sont pas figuratives ou graphiques, c’est plutôt le journal intime de ma vie. Parfois, je me compare à Jackson Pollock. J’ai appartenu à ce mouvement qu’on appelle Street Art, ou graffiti. Et cela a été un long chemin de d’implication, et de discipline pour parvenir à peindre comme je le fais. J’ai travaillé dur, mais toujours avec ce doute, savoir si mon travail serait ou non accepté. Mais j’ai fini par réaliser que je n’étais pas différent d’un artiste comme Jackson Pollock. Il venait de la peinture figurative, et il est très probable que quand il a commencé à faire ses coulées de peinture, les gens n’ont pas compris. Ils l’ont pris pour un fou, pour un gars venu d’une autre planète, faisant n’importe quoi. Et maintenant, les gens vénèrent son travail…
Parce que j’ai l’impression d’être un lézard – en mue ! Je pense que je suis aujourd’hui dans la période la plus intéressante de ma vie. Je me sens bien, jamais avant je n’avais jamais senti cette liberté, cette puissance, cette confiance. Mon travail, c’est avant tout une énergie. Mes images ne sont pas figuratives ou graphiques, c’est plutôt le journal intime de ma vie. Parfois, je me compare à Jackson Pollock. J’ai appartenu à ce mouvement qu’on appelle Street Art, ou graffiti. Et cela a été un long chemin de d’implication, et de discipline pour parvenir à peindre comme je le fais. J’ai travaillé dur, mais toujours avec ce doute, savoir si mon travail serait ou non accepté. Mais j’ai fini par réaliser que je n’étais pas différent d’un artiste comme Jackson Pollock. Il venait de la peinture figurative, et il est très probable que quand il a commencé à faire ses coulées de peinture, les gens n’ont pas compris. Ils l’ont pris pour un fou, pour un gars venu d’une autre planète, faisant n’importe quoi. Et maintenant, les gens vénèrent son travail…