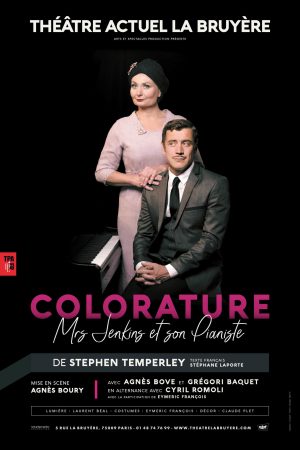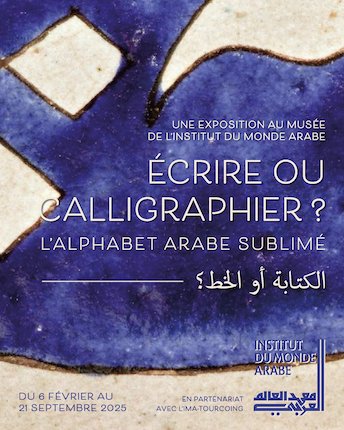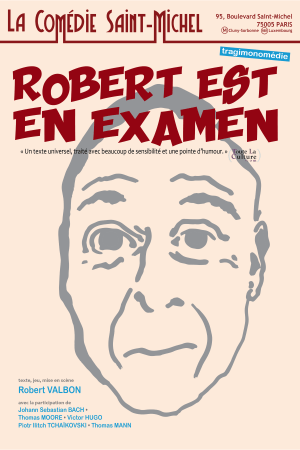Alisa Phommahaxay : “En Asie, l’art juste pour créer, sans sujet imposé, est très récent”
© Holly Falconer
Rencontre avec Alisa Phommahaxay, curatrice d’exposition, attachée de presse et spécialiste du street art en Asie. Où l’on comprend pourquoi la sous-culture queer et le street art contestataire en Asie ont comme point commun l’activisme…
Qui es-tu Alisa ?
D’origine laotienne par mes parents, j’ai fait mes études en France : licence d’histoire de l’art et master en art plastique. Je suis partie à Londres pendant cinq ans, entre 2010 et 2015. J’y ai eu des opportunités que je n’aurais peut-être pas rencontrées en France. Très vite après mes diplômes, je suis devenue curatrice d’exposition dans l’Est de Londres pour XOYO à Shoreditch. Je choisissais librement mes sujets d’exposition qui tournaient autour de la sous-culture queer et de l’art urbain. J’y ai d’ailleurs présenté Romain Froquet en 2012. À l’époque, la scène street art à Londres n’était pas cachée du tout, JR faisait ses collages sur la Tate, la ville avait une énergie qui laissait sa place aux jeunes. J’ai ensuite fait pas mal de missions freelance sur Londres. Puis mi 2015, je suis retournée à Paris avec l’envie de faire quelque chose pour le pays de mes parents. Je suis donc repartie quatre mois au Laos enseigner aux Beaux-Arts, sur la thématique “De Malevitch au street art”. Malgré le niveau assez bas localement, j’étais très motivée et j’ai pu organiser une exposition au sein des Beaux-Arts en présence des officiels locaux. Au second semestre 2015, me voilà de retour sur Paris, en pleine période d’attentats et donc de crise. En 2016, j’ai inauguré ma première exposition sur le clubbing au Point Éphémère ; j’y ai rencontré Nicolas Laugero Lasserre qui m’a proposé d’être commissaire pour son projet de musée d’art urbain, Art 42. J’avais un regard plus muséal que les autres curateurs. En parallèle, j’ai organisé des expositions, essentiellement sur la culture queer et les non-binaires que je définis pour le premier comme un état d’esprit (on peut être queer en étant hétérosexuel par exemple) et pour le second comme une personne qui ne se considère ni homme, ni femme. Depuis Londres, j’avais une étiquette “trash”, sans pour autant vouloir choquer. En tant que curatrice, il fallait faire ce qui me parlait. J’occupe aussi le rôle d’attachée de presse : ce n’est pas une vocation en soi, mais le buzz que j’ai réussi à avoir sur mes propres expositions a généré de la sollicitation spontanée il y a deux saisons pour que je m’occupe de la communication des autres. Je me suis interrogée sur le lien entre la jeunesse queer et l’art contestataire, et c’est lors d’une discussion avec Orlan que j’ai réalisé que le point commun c’était l’activisme.

Holly Falconer, “Sisters Uncut Protest at Yarl’s Wood Immigration Removal Centre” (2016) UK, pour l’expo “Parade” 2017, mois de la photo off
Tu as écrit le livre Bangkok Street Art aux éditions Critères. Raconte-nous la genèse de ce projet.
J’ai toujours eu un attrait pour l’Asie, ma culture est plus franco-anglaise, je n’ai jamais été élevée au sein de la communauté laotienne, mais j’éprouvais un besoin personnel d’y retourner. Je me rendais au Laos tous les hivers pendant quelques mois et, en y allant, je faisais un stop à Bangkok. J’ai réalisé qu’il y avait une scène urbaine florissante, différente de celle de l’Europe. Je voulais m’acheter un livre à ce sujet et comme il n’existait pas, et bien je l’ai écrit. À la base, je voulais faire toute l’Asie mais le temps de trouver un éditeur, il y avait de la matière intégrale sur la Thaïlande. L’ouvrage est sorti en juin 2019. Il faut comprendre que sous la junte militaire thaïe, les artistes sont réprimés. L’oppression mène à la création de fresques plutôt qu’à une contestation frontale. C’est la base même de l’art contestataire que je décris dans mon livre.

BACC – Bangkok – 2018 – © Alisa Phommahaxay
Tu reviens d’un périple de trois mois en Asie justement, qu’y as-tu préparé et décelé?
En fait, j’ai été contactée par l’éditeur Omniscience au moment de la rédaction de mon livre sur la Thaïlande. Il était intéressé par ma démarche, notamment par mon approche sociologique, mais j’étais liée avec Critères. Du coup, avant de partir mi-janvier en Asie, j’ai eu un feu vert de leur part pour un ouvrage sur le street art, mais cette fois sur toute l’Asie, avec une sortie prévue en septembre/octobre 2021. Je compte couvrir le Vietnam, le Myanmar (ex-Birmanie), le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée du Sud, le Népal, le Laos et Hong Kong, en un mot, un véritable atlas du street art en Asie. Bien sûr, j’y reprends la Thaïlande, en y incluant cette fois-ci Chiang Mai. Je souhaite organiser l’ouvrage par thème, plus que par pays, car les influences sont différentes entre chaque pays, et faire un résumé des festivals locaux.
Justement, parle-nous de cette scène street art asiatique. Qu’a-t-elle de différent de la nôtre ?
Déjà, il y a une disparité entre les pays asiatiques. Certains sont plus axés graffiti, d’autres plus street art. J’ai une théorie à valider par exemple sur le Vietnam : c’est essentiellement du graffiti old school à l’américaine, est-ce par similitude avec notre alphabet, en plus de l’influence de l’ancienne occupation US ? Dans d’autres pays, la culture graf est moins forte car il est plus difficile de jouer avec la forme des mots dans l’alphabet local. Au Cambodge, le street art est plus timide, sous influence Khmer, et fait référence au bestiaire animalier et au bouddhisme. Dans tous les cas, la scène street art asiatique est jeune, active, avec la présence de beaucoup d’expatriés et de réimpatriés (les franco-laotiens ou franco-vietnamiens par exemple). C’est une scène jeune car beaucoup de pays sont sortis de guerre il y a peu. Là-bas, être artiste contemporain, ce n’est pas statutaire et le parrainage des expatriés continentaux est fort. J’ai rencontré lors de mon dernier voyage beaucoup d’artistes mais j’ai choisi délibérément de ne présenter dans mon prochain livre que les locaux. Par exemple, au Cambodge, j’ai pu discuter avec Théo Vallier et Chifumi, deux artistes d’origine française. Il est drôle de constater que ces artistes-ci s’inspirent de la culture khmère dans leur travail, mais que les jeunes locaux réinterprètent les travaux de ces français ; on observe donc un double phénomène d’acculturation. Il existe beaucoup de festivals locaux, montés par des occidentaux, poussés par l’Alliance Française ou l’Institut français, selon les pays, mais fréquentés par des expatriés, comme le “Cambodia Urban Art Festival” organisé par Chifumi et Laetitia Troussel. J’aimerais beaucoup que ces festivals soient fréquentés par des visiteurs locaux.

Mur en cours à Saigon 2020 avec Anoir, © Alisa Phommahaxay
Quels coups de cœur de ton dernier voyage souhaites-tu partager avec nous ?
Parmi les artistes, il y a Jecks Bkk en Thaïlande. Daos et Anoir au Vietnam. Lisa Mam au Cambodge. Pour les festivals, le “Bukruk” en Thaïlande et le “St+art” en Inde. Sinon, je recommande la boutique Dream Graff Shop à Chiang Mai en Thaïlande, l’endroit est juste “ouf”.
Quels sont tes projets actuels et futurs ?
J’ai toujours eu un côté geek/gamer qui a été exploité pendant le confinement (rires), mais j’ai repris le travail très vite car j’ai beaucoup de projets sur la fin d’année 2020 et sur le début 2021. En tant qu’attachée de presse, je m’occupe de l’exposition de Raphael Federici, Afrofuturisme écologique qui se tient jusqu’au 30 juin à l’espace Oberkampf. Cet été, à la Vanities Gallery, je m’occupe de la communication de l’exposition de peinture abstraite de Silvère Jarrosson, Genèses & Gestes et j’ai un projet en cours avec Joachim Romain et JM Robert à Uzès pour la rentrée. En tant que curatrice, j’ai deux expositions au programme sur le graffiti : une aux États-Unis et une en France d’ici fin 2020, ainsi qu’une exposition photo d’ici la fin de l’année.
Les mots de la fin : que penses-tu de la scène art urbain actuelle en France et de ses perspectives d’avenir ?
Je prédis que l’art urbain va de plus en plus sortir de la rue pour rentrer dans les galeries car le marché explose. C’est un bon moyen pour les artistes d’en vivre. Aujourd’hui, la rue ne va pas sans les galeries. Je suis personnellement adepte du vandalisme, mais je reste réaliste : il est légitime que cette forme d’art rentre dans les musées et galeries. D’ailleurs, les mieux côtés ont une crédibilité street. C’est ce qui fait la différence entre un street artiste et un peintre : ce dernier rentre directement en galerie sans être passé avant dans la rue et n’y peint qu’a posteriori. Peut-on dire que c’est de l’art urbain simplement parce que c’est dans la rue ? Pour moi, la notion de mise en danger est importante dans cette qualification d’artiste urbain.
Retrouvez l’actualité d’Alisa sur son site.
Propos recueillis par Barbara Legras
Articles liés

« Il Viaggio, Dante » : un voyage splendide à travers nos rêves et nos cauchemars
À l’Opéra Garnier, le compositeur Pascal Dusapin et son librettiste Frédéric Boyer, écrivain, poète et traducteur, reprennent l’opéra créé en 2022 au Festival d’Aix-en-Provence, dans la brillante mise en scène de Claus Guth. Avec le chef Kent Nagano et...

“Maintenant je n’écris plus qu’en français” un seul-en-scène à découvrir au Théâtre de Belleville
Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance : intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe,...

“Furie” une réflexion autour du rejet collectif par Thomas Chopin
Furie est une chorégraphie de genre fantastique qui parle de l’école, du bahut, de ce lieu où nous passons presque vingt ans de notre vie. Inspiré des teen movies, Thomas Chopin se questionne sur la manière dont les enfants apprennent à...