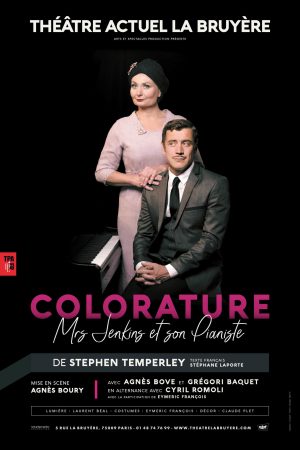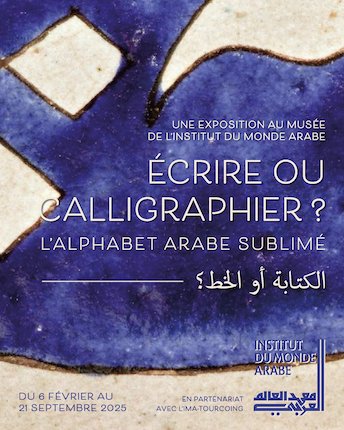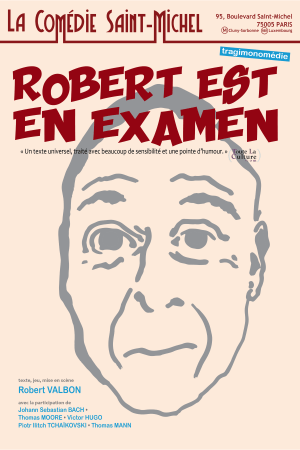Robert Combas – Un été à Sète et dans ma tête – galerie Laurent Strouk
|
Exposition Un été à Sète et dans ma tête Œuvres de Robert Combas Du 13 novembre au 31 décembre 2015 Du lundi au samedi de 10h30 à 19h Entrée libre Galerie Laurent Strouk |
Du 13 novembre au 31 décembre 2015
Cette exposition présente un ensemble très important d’oeuvres abordant sous toutes les formes la ville de Sète, une ville qui, sans en avoir l’air, concentre le génie libertaire, autrement dit, le génie de ceux qui ne mettent rien plus haut que la liberté. Le Platonisme Hard de l’acète de Sète : Peindre ce que voient les aveugles Nous sommes dans la galerie de Robert avec son galeriste, Laurent Strouk, la compagne de Robert, Geneviève, Nigou, chien génial, et Dorothée, pure présence. Les toiles récentes ne sont pas encore sur châssis, elles gisent à même le sol, presque bord à bord. J’ai ôté mes chaussures, comme pour sentir les vibrations que la peinture communique au parquet. Jeune, Robert avait vu le peintre Kijno, qui est devenu son ami, et avec lequel il a peint des toiles communes, marcher sur les toiles – comme d’autres marchent sur l’eau ; aujourd’hui, Robert Combas fait de même. Lui qui aime les jolis souliers foule ses peintures avec des baskets aux couleurs de son travail. Il avance comme s’il marchait sur le sol des premières minutes de l’univers. Courbé, comme l’est un travailleur sur son ouvrage, il arpente et ne s’arrête jamais. Ce sont les œuvres faites à Sète, une ville qui, sans en avoir l’air, concentre le génie libertaire, autrement dit, le génie de ceux qui ne mettent rien plus haut que la liberté. Cette ville fabrique des singularités rebelles, elle produit des individus solitaires, elle accouche de tempéraments – Brassens & Valery, Vilar & Belaval, Soulages & Combas. Excusez du peu. D’où le titre : Eté à Sète et dans ma tête ( donc un grand coup de poing dans la gueule) me dit Robert. Puis il ajoute : « dans la figure plutôt que dans la gueule, non ?, ça fait peut être moins vulgaire… ». Ce sera l’un ; ou l’autre. Sète c’est plus qu’une ville pour Robert. C’est bien sûr l’endroit où sa famille arrive après Lyon où il est né ; c’est le lieu de l’enfance et de l’adolescence ; c’est le lieu des jeunes années ; c’est le lieu des bêtises de cet âge ; c’est le lieu de l’Ecole des Beaux-Arts où ses parents modestes, notamment son père ouvrier et communiste, se réjouissent qu’il soit admis ; c’est le lieu où l’académisme des faux rebelles fonctionnaires ne célèbre que ce qui est déjà institutionnel dans la révolte mais ne voit pas la révolte qui se dit, s’annonce et se prépare sous le pinceau de Robert. C’est aussi désormais la ville dans laquelle le peintre dispose d’une maison pensée par Geneviève et qui fait face au vaste monde que raconte le cimetière marin du poète. Au-dessus des bâtisses de Soulages et de Vilar, face à la mer méditerranée avec son histoire, de Homère à Valéry, la maison pèse de tout son poids ontologique. Sète vit sa vie loin de la côte des snobs et des bourgeois, des mondains et des désoeuvrés, des milliardaires et des nouveaux riches. Sète la populaire et la mal peignée, Sète l’hirsute et la tatouée, Sète la poissonnière et la harengère, Sète la rital et l’africaine, Sète qui pourrait être la ville de Popeye – qu’on imagine mal à Saint-Tropez ou à Cannes… Sète est une force dans une époque avachie. J’ai pu voir dans cette maison comment fonctionne l’athanor de l’alchimiste qu’est Robert Combas. Il transforme le plomb du monde en or de l’art. Quand n’importe qui, marchant sur la plage, ne verrait que bois flotté, ficelles ébouriffées, galets bosselés, détritus blanchis par le sel, l’artiste crée un serpent, donne vie à un animal, fait surgir des figures qui s’imposent dès qu’il a touché la chose. Ce vulgaire bâton devient en effet un serpent qui ondule dès que Robert le prend en main. Dans l’atelier, de vastes papiers se remplissent de citations de ce que l’on voit par les baies vitrées : la petite voiture verte peinte par lui, les entrelacs des feuilles dentelées du palmier, les bateaux sur la mer, un voilier et un bâtiment militaire, le rose des lauriers rosee, les plantes en pot qui gigotent immobiles, Nigou qui pose, avec rouge à lèvre et fard aux yeux, Geneviève qui pense, jambes et seins comme des citations, un nageur qui sort de l’eau frigorifié ( un autoportrait ?), Robert qui joue de la guitare, comme un phylactère avec « la, la, la… », les jambes, les hanches et le ventre d’une femme sans tête, un avion, des idoles d’une civilisation primitive qui n’existe pas. Mais Robert Combas prend prétexte de paysages extérieurs pour peindre des paysages intérieurs. Il faut donc le croire quand il me dit : « Je fais de la peinture abstraite »… Au départ, je souris ; après réflexion, je me dis, comme feu le commissaire Bourel dans un Maigret : « Mais bon sang, c’est bien sûr ! ». Et l’énigme qui n’existait pas se trouve résolue. En effet Combas peint, mais le sujet importe peu. Le réel sert de point d’appui au saut esthétique effectué par le peintre qui a moins le souci du dessin, comme jadis, que celui, dionysiaque et actuel, de la peinture, donc de la matière du monde. Ce qui fut dessiné, léché, presque calligraphié, telles des miniatures dans la fresque, a laissé place au geste des abstraits. Le temps lent des œuvres anciennes passe son tour et rend possible l’avènement d’un temps vif, d’une précipitation presque. L’ancien Combas, bien que pressé, prenait le temps ; le nouveau, toujours aussi pressé, n’a plus le temps. Du moins : il ne le prend plus. Plus le temps de prendre son temps ; c’est désormais le temps qui le prend. Cette accélération du temps met le sujet au second plan et la peinture au premier. La mer impose le bleu qui donne un temps bleu. La végétation impose un temps vert qui donne le temps vert. La terre impose l’ocre qui donne un temps ocre. Et ces temps vibrent comme, sous les effets du vent, mistral et tramontane, vibrent la surface de la méditerranée , vibrent les branches des arbres de la végétation du lieu, vibre le sol de la colline. Sète c’est aussi soi qu’on emporte à Sète. Eté à Sète, donc, et dans ma tête… Robert Combas peint des visages encagés. Certes, on songe à l’homme au masque de fer ; ou aux masques d’infamies que les tribunaux de l’inquisition infligeaient à ceux qu’elle estimait hérétiques ; on pense aussi à ceux qu’utilisent les amateurs de soirées sadomasochistes qui masquent le visage ou provoquent la suffocation qui est jeu de la mort et du plaisir, éternel contrepoint du sperme d’Eros et des larmes de Thanatos. Mais le masque est aussi et surtout une allégorie, une métaphore de l’enfermement de soi. Certaines de ces cages sont comme un crâne, le crâne du squelette qui nous habite, qui pousse en nous chaque jour jusqu’à prendre le pouvoir un jour définitivement sur le visage que l’on eut, donc que l’on fut ; d’autres sont comme des casques d’armures médiévales qui laissent voir les yeux et la bouche. Il faut les regarder ces regards, les chercher derrière les cages, derrière les masques : la peur, la crainte, l’angoisse, la solitude. Derrière le masque, il y a la tête ; dans la tête il y a le masque. Ces masques sont de couleur vive : rouge comme le sang, bleu comme la mer. Ils disent la tête prise ; la prise de tête. Le cerveau encagé ; la cage qu’est tout cerveau. La machine qui broie le crâne ; le crâne comme une machine. Le masque comme un visage ; le visage comme un masque. Le dedans montré au-dehors. En un mot : la souffrance d’exister. Pour utiliser les mots de Cocteau : la difficulté d’être. Ce dedans de l’être n’est pas seulement montré dans, par et avec les masques. Il l’est aussi avec les découpages et les collages de corps nus venus se poser sur des dessins effectués par un quidam dans les années quarante. Sur ces feuilles rectangulaires, jaunies, trouvées à l’encan, l’anonyme a dessiné des vêtements classiques ; sur les mêmes papiers, Robert Combas a ajouté des corps nus : corps de femmes avec chaussures à hauts talons sur un corps d’homme masqué, l’ensemble devenant transsexuel, à moins qu’il ne s’agisse d’une marionnette animée par un être dont on devinerait le corps, derrière tous ces mécanismes de chair. Sur les robes à crinolines sont posées des icones à la Marlène Dietrich ; une fée Mélusine se cache le visage, mais montre ses bas, ses jarretelles, ses dessous sexy ; la même exhibe un postérieur d’anthologie, cul sublime entraperçu sous une jupe de jeune fille ; un humain au crâne rasé ayant le corps moulé dans une combinaison qui pourrait être de latex tient une lance et regarde le regardeur comme en le provoquant ; une religieuse voilée porte des bas, écarte les jambes et donne l’impression que le tabouret lui entre dans le sexe et dans le ventre ; etc. Guêpières, jambières, bas, bottes à lacets, porte-jarretelles, chaussures à hauts-talons, sous-vêtements ad hoc, gants, lanières, sangles, le corps y est sublimé dans l’éros simple de ceux pour qui le corps n’a plus de comptes à rendre à la morale judéo-chrétienne. Robert souhaite me parler seul à seul. Je remets mes chaussures. Il a gardé les siennes. Nous nous retrouvons tous les deux sur la terrasse de sa galerie. Il voudrait me dire qu’il y a dans ses toiles comme une grammaire d’objets particuliers, des signes pour se mouvoir dans un labyrinthe. Rien de bien particulier, mais ici un trèfle à trois feuilles roses dont les vibrations changent en fonction de la lumière, là des lignes qui sortent d’une toile, mais pénètrent ( ou sortent) dans une seconde œuvre, la ligne parcourt donc des panneaux hétérogènes sans qu’on soit obligé de le savoir, ailleurs sont semées des graines comme des figues ou des figues comme des graines, ou bien encore un entrelacs de coeurs roses, le tout pour produire un genre de rébus ontologique que lui seul comprend, mais qu’il me fait partager. Au bout du compte, ce secret rejoint la confidence faite qu’il peint finalement une peinture abstraite. Car, devant la surabondance de motifs sexuels, il me dit : « mais tout ça, c’est platonique ». Les longues jambes gainées dans des bas de soie noire, les tailles de guêpe serrées dans des guêpières noires elles aussi, les bottes aux laçages interminables, les chaussures à hauts talons, les habits du déshabillage, les vulves ouvertes comme des fruits mûrs, les postérieurs exhibés et les fesses écartées, tout cela, bien sûr, est peinture platonique. Comment ne pas croire Robert qui, en fait, me dit aussi : « J’invente des dimensions qui n’existent pas » ? Mais ces dimensions qui n’existent pas dans la vie, elles existent dans l’œuvre. Et l’œuvre c’est la vie ; la vie, c’est l’œuvre. L’exposition montre donc ce qu’il faut cacher ; elle cache ce qu’il faut montrer. Elle montre à l’œuvre « une centrale électrique de couleurs » – ce sont ses mots. Il aimerait aussi, me dit-il : « Peindre pour les aveugles ». L’artiste qui peint des toiles abstraites et qui montre des situations platoniciennes est sur la bonne voie. Ce qu’il donne à voir aux voyants, c’est déjà, je crois, ce que voient les aveugles. [Visuel : © Robert Combas/ Courtesy Galerie Laurent Strouk // Texte de Michel ONFRAY] |
Articles liés

« Il Viaggio, Dante » : un voyage splendide à travers nos rêves et nos cauchemars
À l’Opéra Garnier, le compositeur Pascal Dusapin et son librettiste Frédéric Boyer, écrivain, poète et traducteur, reprennent l’opéra créé en 2022 au Festival d’Aix-en-Provence, dans la brillante mise en scène de Claus Guth. Avec le chef Kent Nagano et...

“Maintenant je n’écris plus qu’en français” un seul-en-scène à découvrir au Théâtre de Belleville
Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance : intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe,...

“Furie” une réflexion autour du rejet collectif par Thomas Chopin
Furie est une chorégraphie de genre fantastique qui parle de l’école, du bahut, de ce lieu où nous passons presque vingt ans de notre vie. Inspiré des teen movies, Thomas Chopin se questionne sur la manière dont les enfants apprennent à...