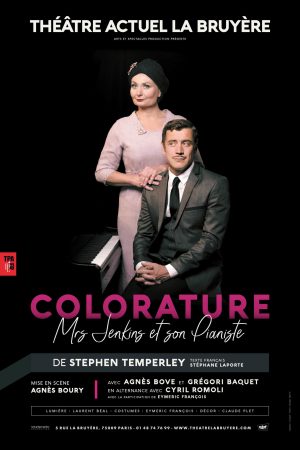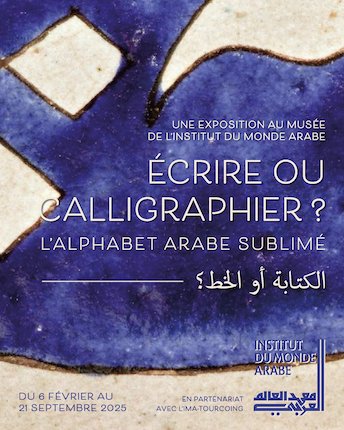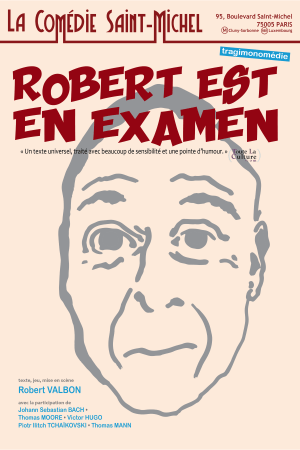Goscinny et le Cinéma – Cinémathèque
Passionné par le septième art dès son enfance, Goscinny s’est inspiré dans ses bandes dessinées des plus grands chefs-d’oeuvre du cinéma, du péplum au western en passant par la comédie musicale. Ludique et interactive, ponctuée de costumes et décors, l’exposition met en regard planches originales et extraits de films pour révéler l’importance du cinéma dans le travail de ce scénariste de génie. Au cœur du parcours, la reconstitution des studios Idéfix, qu’il a créés, se rêvant en Walt Disney, dévoilera toutes les étapes de création d’un dessin animé. 40 ans après la mort de leur créateur, Astérix, Lucky Luke, les Dalton, Iznogoud et le Petit Nicolas sont devenus des personnages de cinéma à part entière. Pari réussi pour « Walt Goscinny » !
Exposition coproduite par la Cinémathèque française et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, en partenariat avec l’Institut René Goscinny.
Goscinny et le cinéma : exposer une idée fixe
« Je crois qu’il faut écrire pour la bande dessinée comme il faut écrire pour le cinéma. » (René Goscinny)
René Goscinny n’aura écrit et réalisé que quatre longs métrages : Astérix et Cléopâtre (1968), Daisy Town (1971), Les 12 travaux d’Astérix (1976) et La Ballade des Dalton (1978). Mais cette courte filmographie de cinéaste à part entière, interrompue par sa mort le 5 novembre 1977, masque une activité soutenue de scénariste pour le cinéma (Le Viager, sommet) et la télévision, et surtout un rapport incroyablement fécond à un art qu’il aura passé sa vie à approcher pas à pas, jusqu’à réaliser enfin son rêve en 1974 avec la création des studios Idéfix.
De « gagman » anonyme pour Bourvil (Le Tracassin ou les plaisirs de la ville, Alex Joffé, 1961) à patron du premier studio d’animation européen, Goscinny poursuit son idée fixe et s’abandonne tout entier à son irrépressible désir de cinéma, né dans les années 30 devant Blanche-Neige et les 7 nains (Walt Disney, 1937) et La Chevauchée fantastique (Stagecoach, John Ford, 1939). Comment expliquer cette quête éperdue d’un homme de presque cinquante ans, déjà parvenu bien au-delà de ses rêves les plus fous, « calife de la bande dessinée » en France, reconnu par le monde entier et riche à millions ?
En se lançant dans les studios Idéfix, contre toute rationalité budgétaire puisqu’il embauche une cinquantaine de salariés permanents, il ne se contente pas de créer de toutes pièces la filière d’animation française. « Walt Goscinny » suit bien sûr son héros absolu, modèle industriel compris, mais surtout, il dévoile son ambition de toujours, secrète et pourtant exposée à chaque page des albums de Lucky Luke et Astérix : il est cinéaste, il se sait cinéaste.
Eux, ses millions de lecteurs, ne s’en sont pas aperçus, trop occupés à s’esclaffer et à savourer d’infinis degrés de lecture, quand les innombrables exégètes ne se perdent pas dans d’absconses hypothèses sociologiques, mais lui, René, sait que, depuis longtemps déjà, il écrit des plans plutôt que des cases, qu’il en fait le croquis sommaire si besoin est, que ses géniaux complices dessinateurs (Morris, Uderzo) sont ensuite chargés de réaliser sur le papier, ce dont il aurait été bien incapable, piètre dessinateur mais suffisamment dessinateur tout de même pour se livrer aux joies du storyboard. Morris et Uderzo : l’apport de ces deux-là est si décisif (l’un maître de la couleur, l’autre du mouvement, pour aller vite) que filer la comparaison scénariste/dessinateur, metteur en scène / chef-opérateur serait trop commode, et finalement injuste, mais il n’empêche que c’est bien Goscinny qui conçoit et décrit chaque plan. Scénariste, il est maître du récit et s’échinera sa vie durant à trouver l’idée de départ, soit, mais c’est aussi lui qui conçoit le découpage et choisit le point de vue adopté. C’est donc lui qui décide de la place de la caméra. Et c’est là, dans sa dernière salve d’albums d’Astérix (à partir du début des années 70), que son génie de metteur en scène est peut-être le plus saisissant.
Mais avant de parvenir à ce stade ultime d’audace et d’expérimentation, qui ne doit plus grand-chose aux films adorés et connus par cœur, René Goscinny a d’abord été un œil, un très singulier œil de spectateur de cinéma : l’œil parodique par excellence.
En sept parties, des premiers chocs enfantins au César posthume qui lui est décerné en 1977 par « les professionnels de la profession » reconnaissants, notre exposition Goscinny et le cinéma : Astérix, Lucky Luke & Cie montre comment cette familiarité et ce désir profond de cinéma innervent la totalité de l’œuvre du plus grand des scénaristes de bande dessinée.
Il s’agit de montrer comment le cinéma est partout chez Goscinny ; comment, par exemple, le burlesque américain, et en particulier Laurel et Hardy, ressurgit tout naturellement en Astérix et Obélix quand il s’agit de créer un couple d’hommes autosuffisant. Dans Astérix, le cinéma fournit le décorum du péplum et ses morceaux de bravoure (course de chars, combats de gladiateurs, Reine des reines égyptienne et intrigues politiques romaines) ; Goscinny et Uderzo, eux, ont trouvé l’essentiel : les Gaulois, leur village et un univers parfaitement stable et cohérent. Pour ses premiers pas, Astérix a emprunté au slapstick américain beaucoup de son dynamisme et de ses codes. Mais les talents conjugués de ses deux créateurs – Laurel et Hardy, encore, évidemment – l’ont vite fait évoluer vers l’anachronisme et la satire sociétale, le démontage des clichés nationaux et des travers d’époque.
Mais Astérix deviendra vite une star de cinéma, des premiers balbutiements télévisuels aux triomphes de Mission : Cléopâtre ou du Domaine des dieux, comme un juste retour des choses, comme si le cinéma n’en finissait plus de reconnaître l’un de ses serviteurs les plus dévoués, René Goscinny, dont chaque scénario, chaque storyboard, porte l’empreinte et le regret du film qu’il aurait pu devenir. Mais c’est bien sûr avec Lucky Luke, dont chaque album est gorgé de références et de motifs westerniens, que Goscinny affirme le plus fortement l’étendue de sa cinéphilie et sa capacité à transformer à sa guise les grands motifs de son cinéaste préféré, John Ford.
Pour Goscinny, les westerns de Ford, et en particulier sa « trilogie de la cavalerie » (Fort Apache / Charge héroïque / Rio Grande), sont une source d’inspiration constante en même temps qu’une somme d’épineux problèmes à résoudre. Comment, en effet, transformer le pathétique fordien, fondé d’abord sur une tragédie de l’appartenance, en un amusant album de bande dessinée, avec son héros asexué, sans faille et désinvolte, soit l’exact inverse du héros fordien, souvent névrosé, plein de remords, se sachant coupable et archi-faillible ? Mission impossible pour quiconque, personne d’ailleurs n’ayant songé à parodier Ford (à l’imiter, oui), sauf pour Goscinny, dont le génie réside justement en sa capacité à adapter l’inadaptable, à transformer les larmes en rires, la tragédie en comédie. De la reconstitution d’une salle de cinéma de Buenos Aires à un dernier montage des innombrables adaptations posthumes (Goscinny for ever!), en passant par le péplum, le western et le fort goût goscinnien du démontage de toutes les conventions cinématographiques, notre exposition est conçue comme une promenade à travers le plus populaire des arts, le cinéma, revu et encore magnifié par le plus doué et le plus amoureux de ses captifs, René Goscinny.
(Source : communiqué de presse]
Articles liés

Quelques-uns des plus beaux films d’Émilie Dequenne à voir ou à revoir
L’actrice belge, Émilie Dequenne, est décédée à 43 ans le dimanche 16 mars, emportée par un cancer très rare. Émilie Dequenne se fait connaître en 1999 à l’âge de 17 ans dans la réalisation des frères Dardenne, “Rosetta”, dont...

Exposition “Steve McQueen : L’héritage d’une icône” du 28 au 30 mars à Courbevoie
Du 28 au 30 mars, ne manquez pas l’exposition exclusive “Steve McQueen : L’héritage d’une icône” organisée par Les Épicuriens. Pendant tout un week-end, plongez dans l’univers du légendaire Steve McQueen, icône intemporelle du cinéma et passionné de belles...

“Absalon, Absalon !” : le vertige d’un théâtre total
À l’Odéon, Séverine Chavrier, metteure en scène et directrice de la Comédie de Genève, nous immerge totalement dans le flamboyant roman de l’Américain William Faulkner avec un spectacle qui convoque en même temps l’art de l’acteur et l’utilisation de...