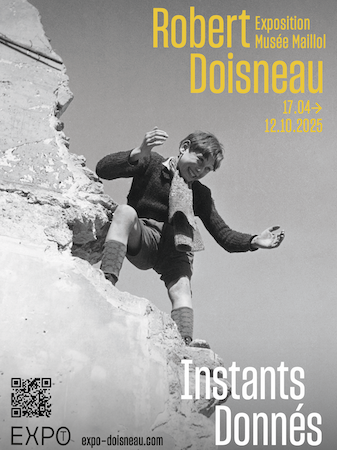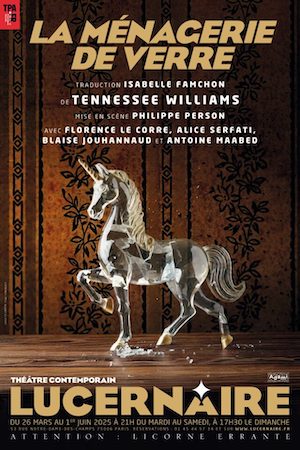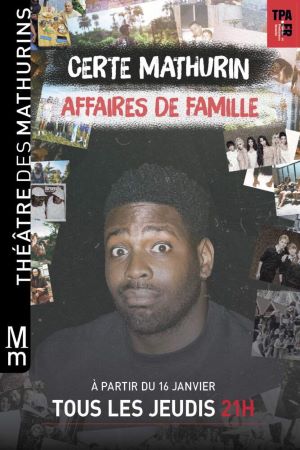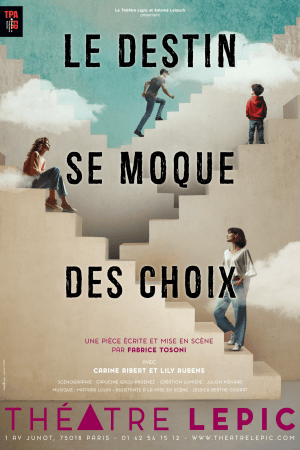Zevs, l’art de l’invisible
|
Zevs, l’art de l’invisible |
Né en 1977, il fut l’un des pionniers du street art français. Portrait de Zevs.
Sa première œuvre montrée au public représentait un fantôme. Il n’avait pas quinze ans, c’était pour une exposition de groupe sur les hauteurs de Belleville. Le ton était donné : celui qui n’avait pas encore choisi Zevs comme nom d’artiste traquerait l’invisible, ce qui se dérobe et déjoue le dialogue attendu entre ombre et lumière. Le visage nocturne des villes, d’abord, en faisant ses premières armes du côté du graffiti, dans le Paris des années 90. C’est la période où il choisit le nom de Zevs, par allusion au RER qui a failli le foudroyer, et adopte l’éclair comme signature. Un temps, il participera aux côtés d’Invader au collectif ‘Anonymous’ – l’occasion de happenings vidéos expérimentaux et volontiers potaches. Bientôt il imagine de dessiner les ombres des villes. Et même la silhouette d’un sans-abri – mauvaise conscience de la ville, sa part d’ombre la plus brutale. Il est l’un des premiers à amener l’art urbain du côté du conceptuel – faire de l’art une idée, autre façon d’introduire de l’invisible dans la création. «Ca a été présent très tôt, se souvient-il. A côté de l’un de mes premiers graffitis, j’avais écrit : ‘Ready made’. Conceptuellement, c’était un premier coup d’épée dans l’eau. Mais l’envie était là, et plus tard, avec les ombres du mobilier urbain, j’ai vraiment fait du ready made dans la ville. En redoublant des formes déjà présentes, déjà inscrites ; il n’y avait pas grand-chose à faire…» Très tôt, il présente également son travail en galerie. Vers l’an 2000, il élabore ainsi des «violations visuelles » : des photographies célèbres privées de visages par une tâche de lumière. « J’ai choisi des images toutes-puissantes comme celles de Monroe ou Che Guevara. Même dans l’effacement du visage, on reconnaît ces photographies iconiques, décrypte-t-il. Toutes se rapportent à la lumière : Platon qui théorise le monde visible et invisible dans son allégorie de la caverne, Edison l’inventeur de l’électricité, Daguerre celui de la photographie. Quant à Marylin Monroe, c’est une star, et on sait bien que les étoiles nous renvoient une lumière morte… » Autre terrain de jeu : les logos des marques, qu’il “liquide” en faisant dégouliner leurs contours trop connus, notamment sur toile ou à travers des sculptures. Du tremblement des formes naît l’incertitude. « Quand j’attaque ces entreprises c’est pour les rendre plus fragiles. Elles sont tout à coup à même de disparaître, c’est en tout cas l’émotion que suscite les coulures ou les flashs sur les visages… » Une façon de travailler sur le copyright. Quitte à souligner ce qu’on voile ? Cette ambiguïté est au cœur de son travail – jusqu’à sa réappropriation possible par les marques. L’une de ses œuvres récentes sur toile revisite l’une des célèbres piscines de David Hockney, ‘A bigger splash’. Travail d’évidement, d’élision, toujours : « J’ai enlevé le ‘splash’, et peint les logos d’entreprises d’hydrocarbures sur le mur de la villa ». Invisible, il l’a été longtemps lui aussi, ou du moins masqué, jusqu’à ce qu’une arrestation en 2009 le contraigne à montrer son visage. « Cela s’est produit dans un moment de tourment, comme une forme d’accident. Mais un accident provoqué, puisque je savais en me mettant dans cette position que ça pouvait arriver. L’anonymat, ça marche un temps ! Mais au fond cela s’est fait naturellement, comme on passe de la nuit au jour… » Aujourd’hui, il expose à la Vitrine AM, à deux pas du Palais Royal. Pour le lieu, il a conçu un papier peint dont les rayures évoquent les colonnes de Buren, toutes proches. « Souvent, quand je prépare une exposition, j’aime jouer sur des effets de contexte. » Comme pour jouer une nouvelle fois sur ce qui n’est pas immédiatement lisible. Au sein d’une valise, un ensemble de polaroïds qui présente l’ensemble de son parcours. « C’était une façon un peu légère d’avoir une sorte de petit musée portatif, et de mettre le doigt sur la question de la préservation des œuvres. » Déjà exposées à Berlin, dans un appartement, ces polaroïds sont fragiles, grignotés par la lumière – et en cela menacés de disparition prochaine, un écho délibéré de l’art éphémère dont ils constituent la trace. Un enregistrement sonore inédit complète l’expérience. La nuit, un film de 1999 est projeté sur la vitrine. Une façon de se glisser dans l’interstice entre rue et galerie… Il s’agit d’une déambulation en scooter filmée lors d’une éclipse. « J’avais envie de saisir ce moment mais c’était impossible avec mon travail de l’époque à la peinture blanche, d’où l’idée de cette vidéo, où je montre Paris dans l’atmosphère de l’éclipse, des réverbères qui s’allument, etc. » Et la quête de l’insaisissable se poursuit. L’un des dernières interventions de Zevs en espace urbain ? Des graffitis « invisibles » – une peinture phosphorescente repérable seulement sous certains éclairages. Pour l’un d’eux, cette phrase sibylline aux allures de profession de foi : «L’invisible est éternel ». Sophie Pujas
|
Articles liés

“Que d’espoir !” un cabaret hors normes au Théâtre de l’Atelier
Valérie Lesort, artiste prolifique multiprimée aux Molières pour son univers visuel unique, s’empare des cabarets du dramaturge israélien Hanokh Levin, maître incontesté de la satire. Dans une mise en scène riche en inventivité plastique faite de transformations à vue...

Succès-reprise du spectacle “La Joie” d’Olivier RUIDAVET
Après le succès remporté par le spectacle au Petit Montparnasse à la fin de l’année 2024 et celui des deux exceptionnelles données au mois de mars dernier au Théâtre Montparnasse, LA JOIE revient, encore ! Solaro traverse les épreuves...

“À l’air libre” le nouveau spectacle de Laurent Balaÿ au Théâtre du Temps
Laurent Balaÿ est de retour avec son nouveau spectacle À l’Air Libre! Après le succès de son seul en scène De l’Air ! autour de son parcours de comédien, il revient avec une nouvelle galerie de personnages aussi attachants que drôles,...




 Dans la rue, il s’amuse à attaquer les publicités de giclées rouges qui signent des assassinats symboliques, nourris des codes du film noir, qu’il affectionne. Il se désigne alors comme « serial pub killer »… L’aboutissement de ce projet : des « visuals kidnapping ». « Puisque les photographies que je flashais étaient retirées, j’ai trouvé bon de retirer moi-même l’image. » Les mannequins des publicités sont découpés des panneaux – et arrachées au regard quotidien, ne laissant plus que les contours d’une absence. « La publicité est une autre dimension du spectre, pour moi. Parce que ce sont les formes qui cherchent à se faire voir le plus. Dans la disparition, telle que je la provoque, il y a un travail d’appropriation. » Pour l’une de ces figures de papier, empruntée à Lavazza et relogée un temps dans un galerie, il demandera, par jeu, une rançon… «J’ai toujours aimé l’histoire du vol de la Joconde en 1911, l’attraction du vide, tous ces gens venant au Musée voir l’absence du tableau. J’ai appliqué ce principe d’une absence suscitant le désir à une image publicitaire. »
Dans la rue, il s’amuse à attaquer les publicités de giclées rouges qui signent des assassinats symboliques, nourris des codes du film noir, qu’il affectionne. Il se désigne alors comme « serial pub killer »… L’aboutissement de ce projet : des « visuals kidnapping ». « Puisque les photographies que je flashais étaient retirées, j’ai trouvé bon de retirer moi-même l’image. » Les mannequins des publicités sont découpés des panneaux – et arrachées au regard quotidien, ne laissant plus que les contours d’une absence. « La publicité est une autre dimension du spectre, pour moi. Parce que ce sont les formes qui cherchent à se faire voir le plus. Dans la disparition, telle que je la provoque, il y a un travail d’appropriation. » Pour l’une de ces figures de papier, empruntée à Lavazza et relogée un temps dans un galerie, il demandera, par jeu, une rançon… «J’ai toujours aimé l’histoire du vol de la Joconde en 1911, l’attraction du vide, tous ces gens venant au Musée voir l’absence du tableau. J’ai appliqué ce principe d’une absence suscitant le désir à une image publicitaire. »