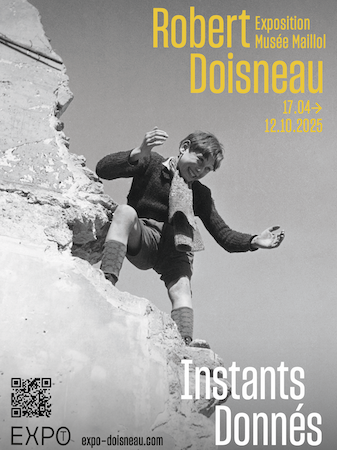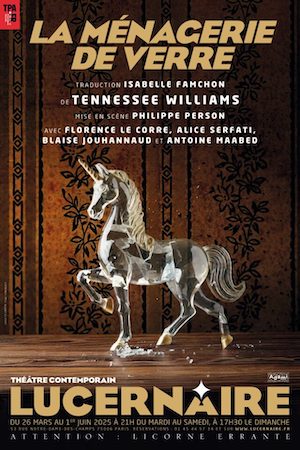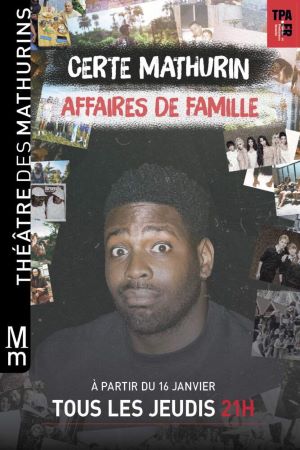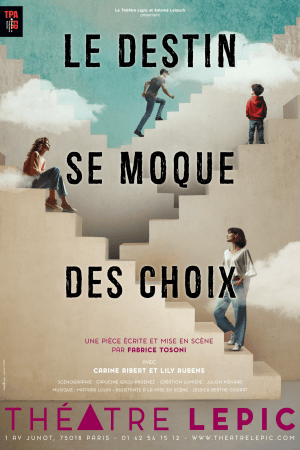Sowat – interview
|
Sowat |
C’est l’une des plus impressionnantes aventures récentes du monde du graff. En 2010, Lek et Sowat investissaient Le Mausolée, ancien supermarché à l’abandon, avant d’y faire venir une quarantaine d’autres artistes. L’expérience a duré plus d’un an, avant de devenir un livre, et un film. Rencontre avec Sowat.
Comment avez-vous débuté dans le graffiti ? J’avais 15 ou 16 ans. J’en ai vu dans mon quartier, à Marseille. J’ai commencé une nuit, avec des copains, sur une voie ferrée près de l’école. La calligraphie est venue après, mais j’ai toujours fait de la lettre, parce que je ne savais pas dessiner. L’histoire du graffiti, c’est celle de signatures qui ont grossi… J’ai eu plein de petits métiers, et ça fait trois ans que je ne fais plus que ça. En 2010, j’ai rencontré Lek. On a fait un mur ensemble, ça marchait bien. Dès la première peinture, on n’avait pas de problème d’ego, on était à l’aise avec l’idée que l’autre repasse par-dessus ce qu’on avait fait et ainsi de suite. Lek appartient à la deuxième génération du graffiti à Paris. Très vite, il a commencé à aller peindre dans les lieux abandonnés. Il fait partie de ceux dont j’ai suivi les travaux, et qui m’a influencé alors que je ne le connaissais pas encore, en m’incitant à aller peindre dans ce genre d’endroit. Mais ces lieux, qu’est-ce qu’ils ont de si puissant ? C’est une vraie émotion, parce que l’interdit demeure. On y allait déjà quand on était minots, avant même de peindre, pour y casser des vitres, et être tranquilles… Mais ce ne sont pas tant des lieux abandonnés que nous cherchons, que des lieux vierges. Etre le premier à trouver un lieu, c’est comme une drogue, tu y reviens toujours. Tu commences par de petites choses, avant de tomber sur des hôpitaux psychiatriques abandonnés, des écoles, des cimetières de bateaux, des bunkers, des bâtisses du dix-septième perdues dans la forêt… Ca devient un peu une collection. Et on y trouve des supports incroyables. On est un peu obsédé par le tracé direct : le trait que tu fais sur le mur est final. Donc le but est de trouver des supports tellement beaux que quoi que tu fasses dessus, ce soit bien ! Et avec le Mausolée, Lek a un peu trouvé le Saint-Graal… Pourquoi ? L’idée de peindre en extérieur, pas simplement sur des toiles, c’est de vivre des choses. Là, dès le début, on avait l’impression d’être dans un film. Les premières fois, quand on a exploré les lieux à la lampe torche, on se serait cru dans La Nuit des morts vivants ou La Route de John Hillcoat, cet imaginaire-là… C’était immense, mais protégé, parce que c’était assez glauque, et difficile d’y entrer… Puisque c’était dans Paris, on a su tout de suite qu’on pourrait faire venir des gens. Evidemment, c’était bingo que ce soit un supermarché abandonné, parce que le symbole est donné sur un plateau ! Mais en fait, la partie supermarché représente un dixième de l’espace. Ce que nous avons peints, ce sont surtout des parkings et des stocks. C’est l’occasion qui a fait le larron.
Même si tu y a passé un an, et que tu as l’impression qu’il est à toi, le lieu ne t’appartient pas ! Le lieu aurait aussi pu être muré ou détruit. On voulait le dévoiler avec un livre. On a démarché des maisons d’éditions à l’automne, puis on s’est enfermé avec Lek pour faire les textes. Le livre est sorti en avril ; on a réussi notre coup, le lieu n’était pas encore tombé. Pourquoi en avoir fait une oeuvre collective à grande échelle ? Nous n’avons pas théorisé, les choses se sont construites au fur et à mesure. Mais on a choisi une portion symbolique de notre mouvement, en invitant aussi bien des gens de la première génération que de la dernière. En partie parce qu’on ne se reconnaissait pas dans les évènements autour du graffiti. Par exemple dans l’exposition au grand palais, dont le thème était l’amour…. Quand on est issu de notre culture, il n’y a pas plus antinomique ! De l’amour, il n’y en a pas. C’est une histoire de violence, de haine, d’envie… A la fondation Cartier, il y avait eu une exposition magnifique, mais qui insistait avant tout sur les historiques américains. Pourtant, on peut raconter l’histoire de l’émergence du graffiti en France, de la même façon qu’aux Etats-Unis. On s’est dit que puisque les institutions ne voulaient pas de nous, on allait faire le plus beau des musées possibles… On a décidé de n’inviter que des Français, justement, parce que le graffiti français n’existe pas vraiment à l’international. Alors que le graffiti anglo-saxon est hyperdocumenté. D’autant plus que ce lieu parisien, était symbolique de la période Sarkozy : ces lieux squattés qu’on vide, en s’en prenant à la population la plus faible du pays. C’était un drame franco-français. Vous avez aussi fait le choix de ne faire venir que des graffeurs… Oui, parce qu’on pense que notre culture est en danger — on voulait lui écrire une lettre d’amour, lui construire un mausolée. Cette culture d’image argentique, de tradition orale, est en train de disparaître. Avant, tu rencontrais un graffeur qui te parlait de ce qui avait été fait dans tel ou tel lieu, tu prenais le RER, tu traversais la ville pour aller voir, dans une banlieue perdue. Internet a changé tout ça. Mais cette nouvelle culture, vous l’avez utilisée aussi, pour montrer le projet… Bien sûr ! Il y deux manières de réagir au changement : soit se désoler et se dire que c’était mieux avant. Soit, puisque maintenant la culture, c’est Internet, faire le film le plus ambitieux possible, qui sera vu par le maximum de gens. Certes, on est triste que cette culture disparaisse. Mais quelque part, ce changement, on en est partie prenante, puisque ce qu’on fait, on veut que ce soit vu, on l’envoie à des blogs et à des sites. L’idée, c’était un plan séquence démentiel de sept minutes, qui donnerait l’impression que le lieu était peint en une journée. Vous parliez de la dureté du milieu du graffiti. Pourtant, le partage est au centre de l’aventure du Mausolée… Oui, mais ça reste un milieu hostile. Quand deux graffeurs se retrouvent, ils vont rarement parler de courbes, de couleurs, de peintures. Ils vont se demander qui est embrouillé avec qui, qui a recouvert qui ! C’est une culture macho, de garçons de quinze à trente ans un peu monomaniaques ! Nous, bien sûr, l’amour est au centre du projet, mais on se demandait justement comment le texte du livre allait être perçu. Parce qu’on parle de nos peurs, de nos doutes. Dans ce milieu, ça ne se fait pas ! Tu es un bonhomme, tu assures, et tu n’as jamais peur… Et pourtant, dans les sous-sols, on avait physiquement peur – de rencontrer des mecs bizarres, par exemple. Et on doutait. Pourquoi on fait ça, pourquoi on s’obsède pendant un an ? On n’a pas arrêté de flipper sur le bien-fondé de notre démarche…
Maintenant, on voit le résultat, le film, le livre, et on est ravis, mais pendant tout ce temps, on ne savait pas ! Je suis père de famille ; c’est dur dans le monde dans lequel on vit, où tout est centré sur l’argent, de justifier qu’on va passer un an dans un vieux centre commercial abandonné ! Pour des choses qui ne seront pas à vendre, et au mieux, nous feront connaître. On savait qu’on ferait une exposition où il n’y aurait rien à vendre, avec les objets abandonnés par les squatteurs. Sur le papier, c’est beau. Mais concrètement, en un an, nous avons produit un film gratuit, un livre qui ne nous rapportera rien, et une exposition sans rien à acheter. Ce qui fait que le projet est beau, c’est à mon sens que c’est un fragment de graffiti, un fragment de cette culture gratuite, où tu t’assois dans un coin du métro pour apercevoir une œuvre. Vous êtes aussi membre des DMV… Toujours par goût du partage ? Oui ! Pour le film, ma première motivation, c’était d’impressionner les DMV… Quand on travaille avec un groupe, le partage est au centre. L’important dans le collectif, ce n’est pas chacune nos personnalités, c’est ce qu’on arrive à faire en commun. Mais Lek est comme ça aussi. C’est au cœur de notre culture. Puisque c’est un milieu dur, tu te constitues en groupe, en crew. C’est ce qu’on a toujours fait. La différence avec le Mausolée, c’est qu’on a poussé le bouton un peu plus loin en disant aux gens, plutôt que de peindre leur nom, de faire de grandes compositions abstraites à deux, quatre, six ou huit mains… Et que ça fasse un tout, qui soit intéressant, plus que le fait que tel ou tel ait participé. Mais là aussi c’est aussi une réaction à l’institutionnalisation du milieu. En quoi ? Il y a une vraie vague en ce moment, beaucoup d’expositions autour du graffiti. Mais nos premières expériences avec des galeristes ont souvent été qu’ils nous disaient de ne pas faire de toiles en commun, parce que ça ne se vend pas. En prenant l’exemple de l’expo Basquiat-Warhol qui n’avait pas marché – il y a trente ans ! Mais c’est une insulte à notre culture, à l’ADN de ce qui nous a constitués comme artistes. On a toujours créé des oeuvres à plusieurs, ça ne nous a jamais empêché de faire des choses seuls… C’est ce que je fais avec les DMV, et Lek avec son crew French Kiss, et d’autres. Le collectif permet de faire des choses mille fois plus belles, ambitieuses, intéressantes, que ce que tu peux réaliser seul. Je suis loin d’être le plus doué des DMV, et ça me pousse ! Travailler avec des gens que tu estimes donne des idées. Et quand tu travailles depuis dix ans avec quelqu’un, il ne te ment pas pour te faire plaisir sur ce qu’il pense de ton travail. Comment s’est formé le crew ? Bom. K et Iso ont monté le groupe, rejoints très vite par Kan, en 99. Au fur et à mesure du temps, ils ont fait venir des gens, ont invité Dran, Brusk, Jaw, et Gris1. J’ai fait venir Blo. Le groupe a grossi en fonction des affinités et de la peinture. Il faut que chaque membre du groupe aime le travail du nouveau membre, mais aussi s’entende avec lui. Parce que la vérité, c’est que tu vas faire des choses en commun, voyager ensemble… C’est autant une histoire d’amitié que de peintures. Il y a des groupes immenses, avec des centaines de groupes, et d’autre plus petits, comme le notre. On est neuf, c’est une petite famille.
Au fond, ça empêche les problèmes d’égo. Je peux être inspiré par un collègue sans chercher à le recopier. Et ca permet aussi de proposer des choses assez différentes à chaque fois. Selon les murs, un tel ou un tel va aller de l’avant. Ce n’est pas toujours la même esthétique qui prime. Sophie Pujas [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jYnLx9l-0Sw[/embedyt] [Visuels : Lek & Sowat (Mausolee project). Photographies de Man – Art is Life. Flickr. Courtesy Sowat] |
Articles liés

“PERDRIX” une pièce déroutante et onirique au théâtre du Troisième Type
Trois marcheurs revisitent leurs existences à travers un monde en ruines. Une odyssée entre ville et campagne, rêve et réalité. Dans un monde obscur et désolé, une jeune femme cherche à quitter la ville. Une nuit de brouillard, elle...

Streetoyenneté, une exposition qui ouvre le regard sur la citoyenneté
Dans un monde en perte de sens et soumis à de fortes turbulences, face à la déconsolidation démocratique et aux nombreux défis, tant humanistes qu’écologiques, le dispositif Streetoyenneté analyse pour mieux renforcer la notion de citoyenneté, à travers une...

“Vieille Petite Fille” une réécriture poignante du Petit Chaperon rouge au Théâtre du Troisième Type
Entre réécriture libre du conte du Petit Chaperon rouge et autofiction, Vieille Petite Fille est un récit d’affirmation et d’émancipation qui s’appuie sur le célèbre conte pour mettre au grand jour les mécanismes d’aliénation matrilinéaires. L’écriture de cette pièce...




 Pendant un an, on y allé quasi quotidiennement. Au début, on avait un sentiment d’étrangeté. Mais à force d’y aller, tu connais chaque centimètre carré. On y cachait notre matériel, on aurait pu s’y retrouver sans les lampes… Quelque part, on a sauté dans le vide et on a passé un an et demi à se demander où on allait atterrir. Je filmais à l’appareil photo et le soir, je dérushais les photos, avec l’idée d’en faire un film d’animation. Assez vite, on a décidé d’inviter des gens. On a passé plus d’un an à avoir peur que le lieu tombe. D’autres graffeurs auraient pu le trouver, des photographes, aussi.
Pendant un an, on y allé quasi quotidiennement. Au début, on avait un sentiment d’étrangeté. Mais à force d’y aller, tu connais chaque centimètre carré. On y cachait notre matériel, on aurait pu s’y retrouver sans les lampes… Quelque part, on a sauté dans le vide et on a passé un an et demi à se demander où on allait atterrir. Je filmais à l’appareil photo et le soir, je dérushais les photos, avec l’idée d’en faire un film d’animation. Assez vite, on a décidé d’inviter des gens. On a passé plus d’un an à avoir peur que le lieu tombe. D’autres graffeurs auraient pu le trouver, des photographes, aussi.  Et aujourd’hui, avec le recul ?
Et aujourd’hui, avec le recul ?