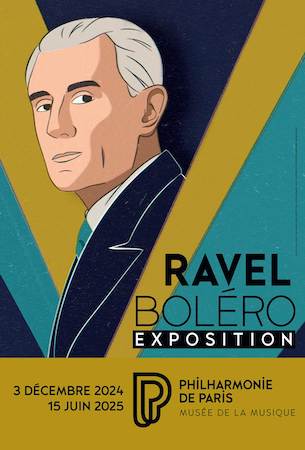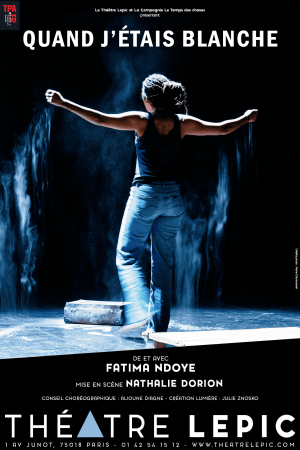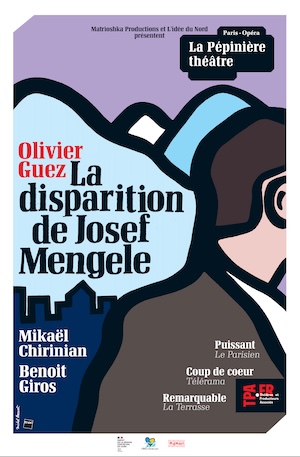Mark Jenkins : « Dans la rue, il n’y a aucune limite »
|
Mark Jenkins : « Dans la rue, il n’y a aucune limite » |
Mark Jenkins a l’habitude de kidnapper les rues. Depuis 2003, il multiplie les installations éphémères, entre humour, provocation et inquiétante étrangeté. Rencontre.
Vous venez de la musique. Comment avez-vous débuté dans le monde de l’art ? J’ai commencé par la musique, et puis de plus en plus, l’idée de travailler sur des images m’a intéressé. Je n’ai pas étudié l’art, mais j’avais envie de faire des installations. Le travail de Juan Muñoz m’avaient beaucoup frappé, et m’a donné envie d’aller dans cette direction. Je ne connaissais aucune galeries. Mais j’ai compris à quel point cela fonctionnait bien de mettre des œuvres à l’extérieur. Une galerie est toujours un système fermé. Dans la rue, il n’y a aucune limite, et tout devient infini, d’une certaine façon. Le temps, les gens, tout devient une partie de l’œuvre. C’est une performance. Vous accordez une grande place aux silhouettes sans visages… D’une certaine façon, l’absence de visage facilite l’impression de vérité. Si nous mettons en scène une silhouette d’un sans abri qui dort sous une couverture, les passants ne savent pas s’il y a quelqu’un ou non. Les sculptures en scotch sont souvent créées à partir de moulages de mon propre corps, et de celui de Sandra Fernandez, avec qui je travaille en étroite collaboration depuis sept ans. C’est une façon d’explorer l’idée de clonage… Pourquoi jouer sur l’hyperréalisme ? Pour la plupart des street artistes, la question est de faire de l’art. Nous, nous créons avant tout une expérience sociale. Nous pourrions être des sociologues. Je pense que nous explorons quelque chose qui se situe au-delà du street art. C’est une autre expérience. La réalité de la ville peut être modifiée afin d’obliger les gens à ne pas tenir pour acquis ce qu’ils ont sous les yeux. La rue est la meilleure des scènes de spectacle… Ce n’est pas une démarche consciente, mais nous intégrons ce qui se passe dans la ville. Nous créons des objets qui font partie de l’environnement urbain et s’en nourrisse. Je ne pense pas pour autant que nous proposions un commentaire évident. Blu, par exemple, tend un miroir immense, son message est écrit en lettres capitales. Ce n’est pas ce que je recherche, pour moi une œuvre d’art doit avant tout être une question. C’est la première chose qui me soit tombée sous la main ! C’est d’ailleurs un matériau retors. Nous continuons à expérimenter, à apprendre comment construire, et bâtir des sculptures que nous consolidons avec du ciment. Cette fragilité me plaisait beaucoup sur la série des bébés que nous suspendions dans la ville ou dans la nature : ils avaient quelque chose de perturbant, comme des insectes qui auraient tenté de survivre à l’extérieur. Au bout de quelques jours, ils se détérioraient… Il y a de l’humour noir dans votre travail… Bien sûr, mais c’est un humour différent de celui de Banksy – où vous comprenez pourquoi vous riez… Et j’aime penser qu’elles sont aussi poétiques que drôles. Hans Bellmer. J’aime la façon dont il a traité la sculpture. Ce n’était pas tant un artiste qu’un fétichiste. Son art était pour lui très thérapeutique, c’était comme une mise en scène de ses propres problèmes psychiques… Et il me semble que pour moi c’est un peu ça : si je peux comprendre mon art, je peux me comprendre moi-même. Peut-être que j’ai une personnalité morbide, mais penser à la mort ne m’a jamais paru tragique. Je pense que c’est un mouvement important, mais que c’est surtout vers 2004-2006 qu’il a eu la plus grande vitalité. De nouveaux artistes ne cessent d’arriver, mais j’ai l’impression que souvent ils n’apportent pas grand-chose de très original ; Banksy ou Blu, eux, avaient vraiment créé du nouveau. Beaucoup copient… Et je suis souvent déçu par les artistes qui ont eu une démarche très originale dans la rue et ensuite, en galerie, se contentent de faire de l’argent avec des toiles très ennuyeuses… Ce n’est pas facile. Il faut dans ce cas que nos sculptures aient un sens qui ne dépendent pas de l’environnement. Prendre telle quelle une sculpture dans la rue et l’amener simplement en galerie n’aurait pas de sens. Propos recueillis par Sophie Pujas [Visuels (de haut en bas) : Mark Jenkins, All You Can Eat, Sao Paulo, Brésil (2007) // Mark Jenkins, Embed Series, Washington DC, USA (2006) // Mark Jenkins, Embed Series, Washington DC, USA (2006) – Tous les visuels : Courtesy Galerie Patricia Dorfmann, Paris] |
Articles liés

« Le Moche » ou l’artifice d’une identité sans cesse questionnée
Au Studio de la Comédie-Française se joue une formidable fable qui questionne tous nos miroirs aux alouettes. Dans la peau d’un ingénieur condamné à l’échec en raison de sa laideur, Thierry Hancisse déploie son immense talent de transformiste scénique,...

Urban Art Fair 2025 : la première foire internationale dédiée à l’art urbain, fait son retour au Carreau du Temple du 24 au 27 avril
La 9e édition de l’Urban Art Fair, événement international majeur dédié à l’art urbain, se déroulera du 24 au 27 avril 2025 sous la halle du Carreau du Temple. Au cœur de Paris, cet événement met à l’honneur l’art...

“Le Bétin” : une pièce de et mise en scène par Olivier Lusse Mourier sur la scène du Studio Hébertot
L’histoire hors du commun d’un petit garçon de 7 ans qui va renaître de ses cendres tel un phénix, à travers trois évènements – Un livre autobiographique, un film “La face obscure du soleil” qui vient de remporter le...




 Vous avez le sentiment de porter un regard critique sur le monde actuel – par exemple la société de consommation, avec ces ordures et ces sacs plastiques qui sont très présents dans votre travail ?
Vous avez le sentiment de porter un regard critique sur le monde actuel – par exemple la société de consommation, avec ces ordures et ces sacs plastiques qui sont très présents dans votre travail ?  Quel regard portez-vous sur la scène street art aujourd’hui ?
Quel regard portez-vous sur la scène street art aujourd’hui ?