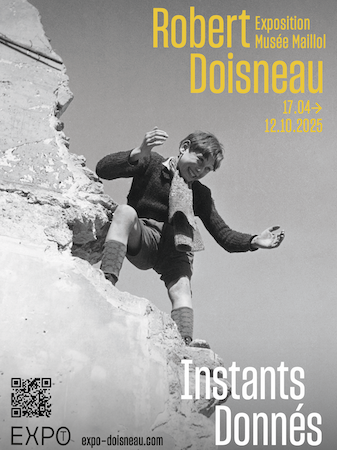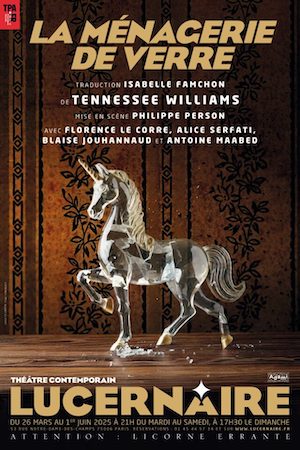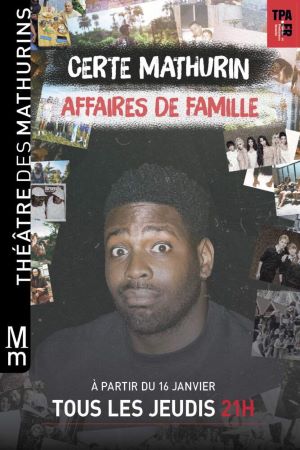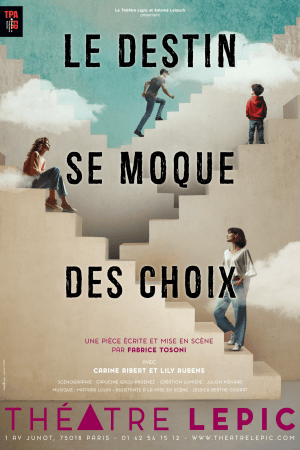RERO : « L’œuvre, c’est l’intervention »
|
RERO : « l’œuvre, c’est l’intervention » |
En quelques années seulement, l’artiste RERO, né en 1983, a su imposer un œuvre poétique et intrigant, aux frontières de l’art conceptuel et de l’art urbain. Sa signature ? Les messages énigmatiquement barrés, certes, mais aussi un certain regard sur le contemporain. Rencontre.
Quel a été votre parcours ? J’ai étudié la sociologie, l’économie, et, pour la partie la plus créative de ma formation, le graphisme. Je n’ai pas de formation en histoire de l’art, cela me permet de partir sans a priori. J’ai l’impression que mon travail s’inscrit de manière sociale, plus que d’autres artistes au cursus « Beaux-arts », qui sont parfois un peu dans un décrochage avec la société. Petit, on ne m’a pas emmené au Musée…. J’avais l’impression que je devais transgresser le contexte dans lequel je vivais pour y avoir accès. Je faisais du graffiti en parallèle de mes études, et c’est le graffiti qui m’a amené vers l’art. J’apprends au fur et à mesure. Même si je suppose que j’ai dû capter des choses de façon inconsciente. Maintenant seulement, je vois que mes compressions font penser à César ou à d’autres. Mes références, ce sont plutôt des gens issus du street art. Ou qui en sont proches, comme Tania Mouraud, que j’ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années et qui a eu une grande influence sur mon travail. C’est à elle que vous avez emprunté ce WYSIWYG (« What you see is what you get »), dont vous avez fait votre devise… Tout mon travail est là, lié à l’illusion. Ce qu’on voit n’est jamais ce qu’on a… Eidolon, le titre de mon exposition actuelle, c’est en grec l’image qu’on croit vraie, et qui n’est que le miroir de la réalité. Jusque-là, j’avais plutôt utilisé cette idée dans le milieu virtuel. Avec des messages liés à l’absence et à la négation d’image : « Image not available », « Error 404 » etc. Plus récemment, j’ai eu envie de sortir du monde virtuel et d’aller vers des objets un peu plus classiques, des choses que je n’avais pas l’habitude de faire — comme des porcelaines ou des fanions de foot… Vous détournez aussi des objets avec un lourd bagage symbolique : des bobines de films, des livres, des machines à écrire… Oui, j’adore ça — contrairement à César qui lui, détruisait plutôt des objets de la vie plus courante. Quand on travaille comme moi sur une toile, on a affaire à un objet sacralisé d’office. Avant même d’avoir commencé, on est déjà dans une œuvre d’art… Mais au final, il ne s’agit jamais que de bois, de lin, de quelques clous. C’est intéressant d’y revenir et d’y mettre un message d’erreur, comme « image non contractuelle», ou « Design to fail ». Qu’est-ce qui vous plaît, dans le fait d’explorer la notion de propriété intellectuelle ?
Pourquoi avoir choisi la police Verdana, quand vous avez commencé à poser des affiches dans la rue ? Parce qu’elle n’est pas connotée. Contrairement à la Times, par exemple, qui fait immédiatement penser à un journal. La Verdana, c’est la police la plus lisible, la plus bateau. Là où dans le graffiti, tu essayes de créer une calligraphie très personnelle, je voulais trouver la police la plus impersonnelle possible. Il fallait que le message soit très clair, et que ce soit le support sur lequel il est posé qui fasse qu’on y voit autre chose. Ce qui est drôle, c’est que je n’ai plus besoin de signer, les gens l’assimilent à mon travail. Alors que ce n’est pas du tout moi qui ai inventé la Verdana ! Mais le typographe Matthew Carter. Là encore, c’est un système d’appropriation. On n’invente rien, on est juste une pierre supplémentaire à ce que quelqu’un a déjà créé avant toi. Barrer ces textes, c’est aussi renforcer le soupçon sur le réel ? Basquiat, vous l’aviez en tête quand vous avez commencé à écrire dans vos œuvres ? Je n’y ai pensé qu’après. Même si je suis depuis longtemps un grand fan de sa peinture… Quand j’étais plus jeune, à l’époque où on cherche son langage, c’est un courant que j’aurais pu imiter. Et pourtant ce n’est que récemment, en regardant sa biographie, que j’ai vu qu’il parlait de ça. Mais il est beaucoup plus impulsif que moi. Et c’est cette spontanéité, cette énergie qui me plait – même si ce n’est pas ce qui m’intéresse pour mon propre travail, je suis beaucoup plus figé. Il écoutait tout et jetait les mots qu’il entendait sur la toile. Sa main créait une typographie, il s’appropriait le texte. Moi, je veux que ce soit la trace de la machine. Que ça semble tamponné, imprimé… Je fais en sorte que la trace de l’humain soit assez absente de mon travail. Le premier plan fixe doit permettre de voir la matière derrière, et le non-humain. C’est cette matière de fond (que ce soit une toile, de l’acier ou autre chose) qui doit être dynamique. Mais en quoi ce travail sur la matière, au rendu très subtil et très délicat d’une certaine façon, est-il « non humain » ? On ne voit pas de coups de pinceau. Je ne suis pas en train de représenter une réalité. La toile me sert de support physique. Mais je ne suis pas dans la peinture figurative, je ne peins pas ce que je vois ! Je transforme un support pour qu’il puisse accueillir un texte. Mais ce support reste très chimique. Tous les matériaux que j’utilise sont porteurs de la trace du temps et des mélanges chimiques – qui donnent cet aspect non-humain. Dans les lieux désaffectés, ce sont aussi les traces du temps que vous cherchez ? Concrètement, comment se passent ces interventions ? Je choisis les lieux en amont. Beaucoup sur Internet, où je regarde les photos des gens qui les visitent. Je surveille aussi les projets de restructuration, là où on a l’intention de construire de nouveaux bâtiments, ce qui veut dire qu’il est possible d’intervenir sur ce qui existe, et qui s’apprête à être détruit. Et après, c’est un peu au feeling, sur le moment. J’ai toutes mes typo, toutes les lettres. Le contexte fait que je peux plus ou moins facilement rentrer tel ou tel mot, en fonction des tailles des murs et des matières. Ce sont des mots toujours liés au virtuel, que je peux avoir même avant d’aller sur le lieu. Mais l’œuvre, c’est la photographie ? Non, au contraire, l’œuvre, c’est l’intervention. C’est l’action, l’acte d’aller intervenir dans un contexte réel, et parallèle au temps dans lequel je le vis. C’est une parenthèse de vie. C’est le fait d’agir en milieu extérieur qui est important. La photographie est juste une archive du travail. C’est la seule preuve de l’acte. Mais si l’important, c’était la photo, il suffirait de le faire sur Photoshop. On a maintenant des outils qui permettent de faire ça très bien, et d’avoir la même sensation. Mais j’ai besoin de charger ma voiture, de partir et d’aller agir ! Parce que là, je peux avoir l’impression d’être ancré dans le réel. Sinon, ça ne s’inscrirait pas dans notre époque. Il s’agit vraiment d’aller à l’extérieur et d’interagir avec un contexte physique. La photo, je la trouve presque réductrice. Je suis toujours très intéressé de voir comment les autres photographes cadrent mon travail. Moi, en général, j’ai toujours une sortie de secours. Il y a toujours une porte ou une fenêtre qui permettent de s’enfuir de l’oeuvre. Les autres photographes interagissent différemment, j’ai pu le voir dans un livre qui vient de sortir (Rero, Critères Editions, 2012). La photo oblige à un certain point de vue. Je pense qu’à terme, je ferai plus de vidéos dans les lieux abandonnés. Pour mieux permettre de retranscrire cette ballade, ce qui s’y passe. L’importance de l’acte, c’est ce qu’il vous reste de votre période graffiti ? Mais à l’époque, je ne pensais pas tellement aux murs ! Ce qui m’intéressait, c’étaient les dimensions des lieux. J’abordais le mur comme une page blanche, sans m’intéresser au contexte – qui pour moi est vital aujourd’hui, c’est l’essence même de mon travail. A la rigueur, je repeignais en blanc avant de graffer ! Comme beaucoup de graffeurs qui vont dans des lieux abandonnés, prennent les endroits plus visibles de la rue, et s’approprient l’espace avec leur style, leur typographie. Ce que je fais pourrait être un texte écrit par une machine, ou qui serait là depuis toujours. C’est d’ailleurs en cela que je pense que je me suis détaché de mon travail de graffiti. Avant, je savais ce que j’allais faire avant même d’entrer sur le lieu. Maintenant que j’ai trouvé mon langage, j’ai l’impression que je peux l’adapter à tous les contextes. Mes textes n’ont de sens qu’en situation. Même en milieu clos, c’est le support qui donne du sens à l’œuvre. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ULp4JUsCUNY[/embedyt] [Visuels : vues de l’exposition de Rero∞ « Eidolon », du 12 mai au 23 juin 2012 à la Backslash Gallery. Courtesy Rero Backslash Gallery, Paris] |
Articles liés

“Que d’espoir !” un cabaret hors normes au Théâtre de l’Atelier
Valérie Lesort, artiste prolifique multiprimée aux Molières pour son univers visuel unique, s’empare des cabarets du dramaturge israélien Hanokh Levin, maître incontesté de la satire. Dans une mise en scène riche en inventivité plastique faite de transformations à vue...

Succès-reprise du spectacle “La Joie” d’Olivier RUIDAVET
Après le succès remporté par le spectacle au Petit Montparnasse à la fin de l’année 2024 et celui des deux exceptionnelles données au mois de mars dernier au Théâtre Montparnasse, LA JOIE revient, encore ! Solaro traverse les épreuves...

“À l’air libre” le nouveau spectacle de Laurent Balaÿ au Théâtre du Temps
Laurent Balaÿ est de retour avec son nouveau spectacle À l’Air Libre! Après le succès de son seul en scène De l’Air ! autour de son parcours de comédien, il revient avec une nouvelle galerie de personnages aussi attachants que drôles,...




 J’aime penser à la manière dont on peut, de manière intrusive, s’approprier l’œuvre de quelqu’un. Puisqu’on ne peut que transformer ce qu’on nous a donné. On n’est jamais que le résultat de courants antérieurs. Guy Debord disait : le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique. J’ai la même démarche vis-à-vis de mon travail. Le film Miserere va être tourné dans la rue où j’ai installé un « Dégage », une commande au moment de la Révolution tunisienne. Ils m’ont proposé de me payer des droits, j’ai dit non. Le message m’appartient, pas l’image, puisqu’elle est dans la rue. L’objet physique est à celui qui le regarde. Sinon, pour chaque œuvre, on n’en finirait pas de remercier… Dans le graffiti, la finalité, c’est d’intervenir sur un support qui n’était pas destiné à ça. Moi, tout mon travail, c’est ça : se réapproprier un matériau, un support où un objet dont l’utilité première était autre. Les machines à écrire que j’utilise n’étaient pas destinées à faire réfléchir sur la notion de copie et de droit d’auteur…
J’aime penser à la manière dont on peut, de manière intrusive, s’approprier l’œuvre de quelqu’un. Puisqu’on ne peut que transformer ce qu’on nous a donné. On n’est jamais que le résultat de courants antérieurs. Guy Debord disait : le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique. J’ai la même démarche vis-à-vis de mon travail. Le film Miserere va être tourné dans la rue où j’ai installé un « Dégage », une commande au moment de la Révolution tunisienne. Ils m’ont proposé de me payer des droits, j’ai dit non. Le message m’appartient, pas l’image, puisqu’elle est dans la rue. L’objet physique est à celui qui le regarde. Sinon, pour chaque œuvre, on n’en finirait pas de remercier… Dans le graffiti, la finalité, c’est d’intervenir sur un support qui n’était pas destiné à ça. Moi, tout mon travail, c’est ça : se réapproprier un matériau, un support où un objet dont l’utilité première était autre. Les machines à écrire que j’utilise n’étaient pas destinées à faire réfléchir sur la notion de copie et de droit d’auteur… Oui, il s’agit de multiplier le sens de la lecture. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que c’est l’inverse ? Est-ce que je suis revenu sur ce que j’ai dit ? S’agit-il d’une censure ? Maintenant, j’en viens à oublier que ça peut même dire ce qui est barré… C’est presque devenu une ligne d’un cahier d’école. Sauf que j’ai voulu écrire en plein dessus… Je trouvais intéressant mentalement de voir un mot, et de dire exactement l’inverse. On est encore dans la négation d’image : nier ce qui est visible, et qui finalement est l’inverse.
Oui, il s’agit de multiplier le sens de la lecture. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que c’est l’inverse ? Est-ce que je suis revenu sur ce que j’ai dit ? S’agit-il d’une censure ? Maintenant, j’en viens à oublier que ça peut même dire ce qui est barré… C’est presque devenu une ligne d’un cahier d’école. Sauf que j’ai voulu écrire en plein dessus… Je trouvais intéressant mentalement de voir un mot, et de dire exactement l’inverse. On est encore dans la négation d’image : nier ce qui est visible, et qui finalement est l’inverse.  Bien sûr. Ce sont les lieux d’une parenthèse de la vie humaine. Ce que je vais chercher dans les lieux abandonnés, c’est aussi leur histoire. Je me suis rendu en ex-RDA en 2011. Quand j’en suis rentré, je suis resté deux semaines au lit sans bouger ! Tu te prends de grosses claques, parce que tu vas dans des lieux… où on sent des choses. Je ne parle pas de surnaturel ! Mais le satanorium Beelitz, par exemple, est un lieu qui a accueilli Hitler. Toutes les images qu’on a construites autour de ces lieux font que c’est fort en énergie et en émotion. Quand on intervient là -dedans, on est face au temps. Et mon travail est beaucoup sur le côté éphémère des choses…
Bien sûr. Ce sont les lieux d’une parenthèse de la vie humaine. Ce que je vais chercher dans les lieux abandonnés, c’est aussi leur histoire. Je me suis rendu en ex-RDA en 2011. Quand j’en suis rentré, je suis resté deux semaines au lit sans bouger ! Tu te prends de grosses claques, parce que tu vas dans des lieux… où on sent des choses. Je ne parle pas de surnaturel ! Mais le satanorium Beelitz, par exemple, est un lieu qui a accueilli Hitler. Toutes les images qu’on a construites autour de ces lieux font que c’est fort en énergie et en émotion. Quand on intervient là -dedans, on est face au temps. Et mon travail est beaucoup sur le côté éphémère des choses…