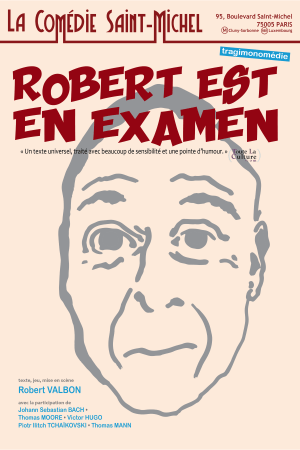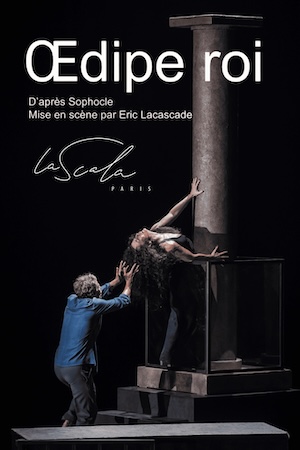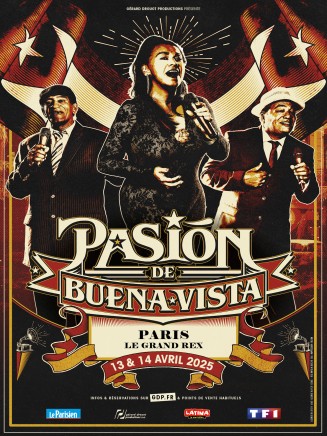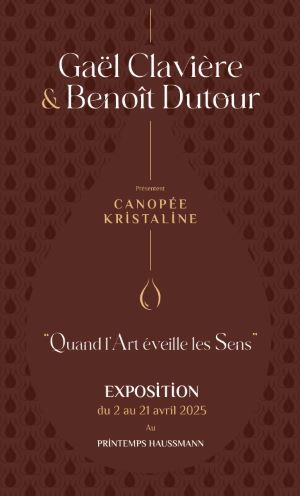Blek le Rat – interview (1/2)
|
Blek le Rat – interview (1/2) |
Pionnier du pochoir à Paris, Blek le Rat compose, depuis trente ans, un univers entre poésie et insoumission. Rencontre. C’est aux Etats-Unis que vous avez vu les premiers graffitis, en 71… Un choc ? Oui, ça a été une découverte incroyable ! A l’époque, j’étudiais la lithographie et la sérigraphie aux Beaux Arts. J’y ai rencontré un étudiant américain qui m’a convaincu de venir découvrir son pays. Je suis donc allé à New York pendant l’été. Là-bas, j’ai vu les premiers graffitis dans le métro et sur les murs de Greenwich village… C’était le début des tags. Ca n’existait pas en Europe ! On avait des graffitis politiques, ou les affiches collées en mai 68. Mais ce pur « street art », même si on ne l’appelait pas encore comme ça, m’a tout de suite beaucoup impressionné. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, je me demandais ce que les gens qui faisaient cela voulaient dire. Je me rappelle que dans Central Park, j’ai demandé à cet ami américain ce que cela signifiait : il n’en savait pas plus que moi. Par la suite, ça n’a jamais cessé de trotter dans un coin de ma tête… Pourtant, dix ans se sont écoulés avant que vous n’interveniez dans la ville. Pourquoi ? J’étais pris par d’autres choses : après les Beaux Arts, j’ai étudié l’architecture à UP6. Dès les années 70, je me souviens avoir dit à un ami que l’on devrait faire des graffitis comme ceux que j’avais vus à New York, et que le périphérique autour de Paris serait un lieu parfait pour cela… Finalement, cela ne s’est pas concrétisé. Et ce n’est qu’au début des années 80, alors que j’étais bénévole dans un « terrain d’aventures », un lieu où les enfants peuvent aller jouer après l’école et pendant les vacances, que j’ai eu l’idée de faire des graffiti. Sur ce terrain, il y avait une cabane en métal. Et les enfants allaient emprunter de la peinture et des pinceaux dans le supermarché qui se trouvait juste derrière le terrain… Ils couvraient la cabane de leurs dessins, et je dois dire que ce sont ces enfants qui m’ont donné le déclic ! J’ai proposé à mon copain Gérard, qui s’occupait du terrain d’aventure, de faire des graffitis. Nous avons commencé à deux, sous le nom de Blek, à cause d’une bande dessinée, Blek le roc, qu’on s’échangeait à l’école dans les années cinquante. Pourquoi vous être emparé de la technique ancienne du pochoir ? Notre premier graffiti, on avait essayé de le faire dans le style américain, c’est-à-dire des lettres peintes en couleurs. Mais on n’avait vraiment pas la technique et le résultat n’était pas terrible… Je me suis souvenu d’un voyage que j’avais fait en Italie avec mes parents quand j’étais gosse dans les années 60. A Padoue, j’avais vu le portrait de Mussolini peint au pochoir, vestige de la seconde guerre mondiale. Les fascistes italiens faisaient leur propagande de cette façon avant et pendant la guerre. Je me souviens encore très nettement de ce profil, avec un casque. Le pochoir fonctionnait bien avec la bombe, on pouvait le préparer dans son atelier. Dans la rue, quand on fait des graffitis il faut agir vite et bien. L’image que laissait le pochoir était impeccable, le pochoir et la bombe de peinture étaient une technique parfaite pour ce genre d’expression.
C’était une prise de possession de Paris ? Oui, je voulais exister dans la ville ! Je cherchais une identité dans l’anonymat qu’engendre la ville. On avait tous à l’époque le désir de devenir célèbres, on faisait de la musique, mal – on avait appris à mal jouer de la guitare avec des rêves plein la tête… Je pense que le graffiti m’a servi de thérapie pour trouver ma propre identité. Cela me plaisait de laisser une image dans la rue quand je savais que des milliers de gens le lendemain matin auraient vu cette image, et certainement en parleraient tout en se demandant : « Mais qui est l’auteur de ces graffitis ? »… Je me souviens que les bombes de peinture n’étaient pas faciles à trouver. Il y avait un supermarché de l’autre côté du périphérique à Malakoff, et c’est là que l’on a trouvé des bombes aérosols pour repeindre les carrosseries de voitures — elles coûtaient une fortune. Nous avons bombé dans la rue Losserand, dans la rue de l’Ouest, et dans tout le 14ème, où habitait Gérard (moi, je vivais dans le dix-huitième). C’était un quartier de Paris où il y avait à l’époque des dizaines de maisons abandonnées et murées. Un terrain d’expérience parfait pour ce que nous voulions faire. Vous aimiez le côté clandestin ? Bien sûr ! J’étais encore étudiant, et un peu rebelle. Je fréquentais pas mal les « Autonomes », un groupuscule politique. Je n’adhérais pas au mouvement, mais j’allais aux réunions, souvent à la fac de Jussieu. On se connaissait tous de vue, mais on ne se disait pas nos noms – c’était clandestin, et je dois dire qu’il y avait quand même une ambiance assez lourde pendant ces réunions. Les autonomes essayaient de parasiter un peu violemment les manifs de l’extrême gauche, le désordre quoi… Moi, même si j’allais dans ces réunions et ces manifs, j’étais toujours un peu en dehors et pas vraiment convaincu – j’y allais plus pour passer le temps… Je me souviens que les autonomes voulaient détruire la ville et interpeller les gens avec des mots d’ordre comme « on veut la lune et tout de suite ». C’était l’époque où Giscard était président… Vous vous en êtes pris aussi au monde de l’art, en bombant à côté de Beaubourg… C’était le 31 décembre 81… Nous étions trois, et nous avons passé la soirée jusqu’à minuit à bomber Beaubourg. Nous avons graffité les murs de chaque côté de l’esplanade en pente. C’était amusant et nouveau, c’était une aventure… Il faisait très froid, les gardiens du musée sont sortis et nous ont demandé ce qu’on faisait là. On leur a dit que l’on faisait de « l’art »… Aujourd’hui, vous avez imposé votre langage dans les galeries… C’est une forme de victoire ? Oui. A l’époque j’étais un petit rebelle. J’étais contre tout. Mais malgré cette marginalité, j’étais quand même étudiant aux Beaux Arts. Je vivais donc le plus clair de mon temps dans ce milieu d’artistes, même si je ne l’aimais pas beaucoup. Je trouvais les artistes ennuyeux avec leur grand discours sur l’Art dans les cafés de Saint-Germain. Ils refaisaient le monde à leur façon, mais ce qu’ils cherchaient surtout c’était à ne pas rentrer seul chez eux le soir ! Il est vrai que j’ai préféré le milieu des architectes, que j’ai fréquenté plus tard. Je trouvais les architectes préoccupés par le monde dans lequel ils vivaient. Ils se posaient des questions qui m’intéressaient et pour lesquelles ils donnaient des solutions plus pratiques que les solutions des artistes. J’allais quand même dans les vernissages à Saint-Germain, et quelque part j’avais certainement envie d’entrer aussi dans ce monde. Je ne sais pas. Je vivais certainement à fleur de peau dans mes contradictions. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KP-u48tpU3Y[/embedyt] Sophie Pujas [Visuel : Graffiti / Street Artist Blek le Rat behind the scenes of his show “Faces in the Mirror” @ White Walls Gallery, SF – Warholian – San Francisco, 2010. Auteur : warholian. Flickr. Licence Creative Commons] |
Articles liés

“L’enquête des Halles” : un jeu de piste avec Paris ma Belle
Partez à la découverte du quartier des Halles au XVIIème siècle, et menez l’enquête ! Nous sommes en plein règne de Louis XIV. Depuis des mois, Paris est troublé par la disparition de jeunes hommes d’une vingtaine d’années en moyenne,...

“Amis pour la vie” à découvrir au Théâtre de l’Oeuvre
Claire et Richard reçoivent un couple d’amis de longue date, Mathilde et Christophe, à dîner. La soirée suit son cours, apparemment sans embûche, dans une certaine gaieté et bonne humeur, jusqu’au moment où une révélation inattendue vient tout bouleverser…...

Christinia Rosmini en concert à la Divine Comédie
Artiste méditerranéenne aux origines espagnoles, corses, et italiennes, nourrie de flamenco, de musiques sud-américaines, orientales, indiennes… et de Chanson française, Christina Rosmini a mis au monde un univers artistique qui lui ressemble. Dans INTI, (Dieu du Soleil chez les...