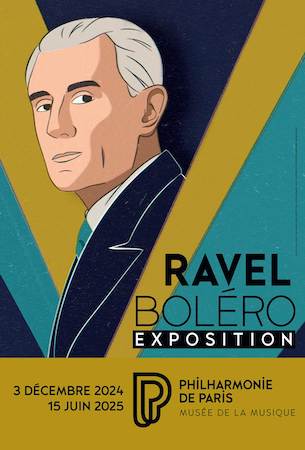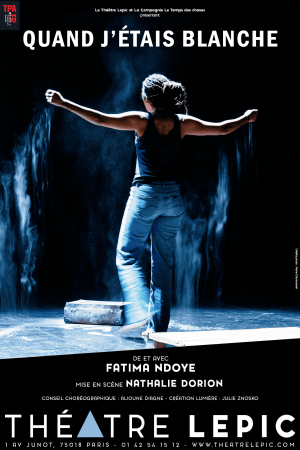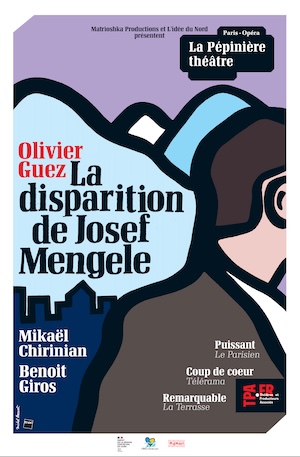Swoon : « J’aime l’idée d’une citoyenneté collective »
|
Swoon : « J’aime l’idée d’une citoyenneté collective » |
Swoon rêve en trois dimensions. Cette trentenaire américaine déploie ses personnages de papier dans les rues du monde. Mais elle a aussi conçu des bâteaux pour remonter le cours du Mississippi ou naviguer en Adriatique en faisant des escales autant de moments de fête et de création. Humaniste, elle a monté des collectifs d’action artistique pour investir les rues de New York, ou encore contribué à l’édification de centres sociaux en Haïti. Dialogue avec une artiste itinérante, qui a entrepris de modeler le monde à la force de l’esprit.
Comment est née votre vocation ? J’ai toujours été une enfant étrange, timide, qui passait beaucoup de temps à dessiner et à faire des scultpures avec de la boue. Un été, ma mère m’a inscrite à un cours de peinture, avec des adultes. Parce qu’ils me voyaient comme un petit génie, ces gens, comme mes parents, m’ont vraiment aidé à me prendre moi-même au sérieux, à croire en mes capacités artistiques. Généralement on n’apprend pas aux filles à croire en elle, le culot n’est pas considéré comme séduisant. Il faut pas mal d’audace pour imaginer qu’on va s’intéresser à ce que vous venez de vomir sur une toile, mais cette audace est nécessaire pour se tailler une place dans le monde. En fait, devenir une artiste est l’une de ces choses qui m’est arrivé alors que j’étais enfant, quand j’étais bien trop jeune pour en faire une décision réfléchie. Ensuite, j’ai étudié l’art de façon très traditionnelle. Vous avez été formée au Pratt Institute, à Brooklyn. Quel souvenir en gardez-vous ? Pour moi qui venais d’une petite ville de Californie, New York a été un saut immense. Au début, j’étais très excitée par cette proximité nouvelle avec le monde de l’art, mais presque tout de suite je l’ai perçu comme étouffant, répressif. Ce que je voyais me semblait froid, inutile, rien ne me parlait viscéralement. Je ne voyais là que d’austères produits d’investissements… A l’école, j’avais l’impression de faire partie d’un troupeau dans un enclos ; on attendait de nous de trouver quelque chose sur quoi fonder notre carrière, de supplier des galeries de nous exposer, et ce jusqu’à la fin de notre vie. Je me rappelle d’un jour où j’ai craqué en plein milieu d’un cours de peinture. J’ai posé mes pinceaux et je suis sortie ; quand mon professeur m’a demandé ce qui n’allait pas j’ai seulement pu répondre que quelque chose devait changer — mais j’ignorais quoi… Vous avez été très marquée alors par le travail de Gordon Matta-Clark… Oui, il a fait partie des quelques expériences très formatrices que j’ai eu à cette époque. Au début, quand j’ai découvert son discours, j’ai cru qu’il plaisantait, avec ses histoires d’entrer dans des bâtiments abandonnés et d’en scier le plancher… Puis j’ai vu les images de son travail dans les zones délabrées de la ville, et elles étaient d’une beauté si dévastratrice, si étrange, si ancrée dans le temps… J’ai su que je voulais tenter de créer quelque chose de cet ordre, des moments de beauté éphèmères qui soient davantage un morceau de la ville elle-même que des objets en soi. Je me suis mis à remarquer les artistes qui travaillaient dans la ville. Du jour au lendemain, alors que vous ne remarquiez pas ce qui se passait sous vos yeux, tout d’un coup cela vous obsède. C’est un changement de perception radical. Ce changement de perception, la rue est le lieu idéal pour le provoquer ? Quand je dessine, j’ouvre une petite fenêtre, et j’essaye de faire en sorte que quelque chose en sorte. Ce qui m’a attiré dans le travail de rue, c’était le caractère éphémère et immédiat de ces actes. C’était un peu violent et totalement généreux à la fois. Je n’avais pas une culture venue du graffiti, j’ai donc su qu’il me faudrait faire autre chose. J’ai commencé par poser de petits collages transparents, destinés à se mêler à tout ce qui existait déjà dans la ville. C’était vers 1999. Ce que je voulais, quand j’ai fait ma première silhouette, c’était dessiner une ombre et l’installer dans la ville. L’une de mes inspirations, ce sont les marionnettes des théâtres d’ombre indonésiens. J’ai été aussi inspirée par les streets artistes qui travaillaient sur de grands portraits : wk, Blek le Rat, et Banksy. Je voulais que mes œuvres aient vraiment un sens en situation dans l’espace urbain, qu’elles semblent nées à cet endroit. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fNn2NNEyqgg[/embedyt] Pourquoi choisir des matériaux fragiles ? J’ai toujours aimé l’idée de fabriquer quelque chose qui ne survit pas à sa propre nécessité, qui existe pour un temps puis disparaît. Je garde et je protège certaines œuvres, mais j’aime en donner d’autres au moment présent. Et si dans leur déchéance elles incarnent nos difficultés face au passage du temps, alors elles expriment, grâce à ce processus, quelque chose que je n’aurais pas su placer en elles de mes propres mains. Vos œuvres sont autant d’histoires… Parce que je ne cesse jamais de regarder autour de moi. Dans les villes, les gens s’entassent pour survivre, s’enferment dans de petites îles connectées par des tunnels souterrains, chacun avec leurs petites histoires, qu’ils se racontent nuits après nuits dans leurs lits. C’est trop pour être saisi, raconté d’un coup, mais c’est probablement ma plus grande source d’inspiration. Je serais capable de me promener et de contempler les gens indéfiniment. Parfois, j’ai envie de devenir aussi silencieuse qu’une pierre sur un trottoir pour que les gens ne me remarquent pas, d’être assez perceptive pour tenter de comprendre leur vie en un clin d’œil, et la transmettre au monde. Dans l’acte de regarder, il entre beaucoup de dévouement, d’amour, d’humilité et de patience. Pourquoi vous investir dans des collectifs, et des projets communautaires ? J’aime l’idée d’une citoyenneté collective. D’être un groupe d’individus qui essaie de façonner la ville pour en faire un lieu où nous aimerions vivre, par exemple en organisant des fêtes de rues tapageuses. Un collectif permet de se nourrir de l’esprit des autres. Même quand vous pensez qu’une idée est aboutie, les gens du groupe trouvent comment lui ajouter quelque chose auquel vous n’auriez jamais pensé vous-même. Avec « Miss Rockaway Armada », ce travail collectif a atteint un nouveau seuil, puisque brusquement nous vivions tous ensemble. Nous étions plus de trente, complètement investis dans la construction d’un monde flottant. Le processus collectif en est devenu d’autant plus intense. Comment est née cette idée de villes flottantes ? C’est une idée qui a évolué lentement au fil du temps. Pendant des années j’ai rêvé de travailler avec des bateaux, en voyageant le long des rivières ou en m’installant à quai. C’était le prolongement de mon travail en extérieur, créer de l’art là où on ne s’attend pas à le trouver, d’une façon à le faire interagir avec nos vies et notre monde matériel. J’ai d’abord construit la « Miss Rockaway Armada », que j’ai fait naviguer sur le Mississippi entre Minneapolis et Saint-Louis. Puis nous sommes allés sur l’Adriatique, jusqu’à Venise… Ces bateaux sont ce que j’ai fait de plus difficile, à cause d’un million de détails logistiques, de l’échelle de ce projet… Ca a été incroyable, mais aussi incroyablement difficile. Il y a eu sept bateaux, cela m’a presque tué ! [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J6LOxoJKvoY[/embedyt] Durant l’un de ces voyages, vous avez constitué un « cabinet de curiosité ». Chercher le rare, l’exceptionnel, c’est l’une de vos raisons de voyager sans cesse ? Ce que je veux, aussi bien quand je dessine sur les murs que quand je construis des vaisseaux sur la rivière, c’est donner aux gens l’impression que le monde est plus vaste et moins prévisible qu’ils ne l’imaginaient. Je veux que ce sentiment leur donne de l’espoir, nourrisse l’idée contagieuse que nous devrions tous redessiner notre monde, encore et encore- que nous le pouvons. Il s’agit de repousser les limites de ce que la vie peut avoir de plus quotidien. Je ne cherche pas à être objective : je fais le portrait du mouvement de mes pensées, autant que du monde autour de moi. J’ai le sentiment que je crée une ville mobile, une ville d’images qui rassemble toutes les villes, parce que j’ai beaucoup voyagé et exposé au cours des dernières années, j’ai été au contact de toutes sortes de paysages urbains. Dans chaque ville que je traverse, je laisse des traces de moi-même. Quand je pose mes valises quelque part, j’ai l’impression d’être l’un de ces insectes qui porte sur son dos des tonnes de feuilles mortes et de poussières sur son dos : allez savoir si c’est du camouflage ou s’il cherche à transporter quelque chose… Avec ces bateaux, vous avez appareillé en face de la Biennale de Venise sans y être invitée, en 2009. Mais vos œuvres ont été achetées par le MoMA, entre autres. Comment décririez-vous votre relation au marché de l’art ? Vouloir être en-dehors des cercles établis est dans ma nature. Mais je suis souvent plus intégrée que je ne le réalise ou que ne voudrais le croire. Je ne m’en soucie pas trop, tant que continue à me laisser guider par la passion. Je traçais mon chemin quand on a commencé à s’intéresser à moi, je continuerai à le suivre si l’attention n’est plus là. J’ai été serveuse pendant des années, et j’étais prête quand la possibilité s’est présentée de vivre de ce que j’aimais faire. J’adore m’effondrer de fatigue le soir parce que j’ai mis en œuvre mes rêves les plus fous plutôt que parce que j’ai servi des brunchs… Et avec les galeries ? Ma première vraie exposition a eu lieu à Berlin. J’étais très secouée, parce que j’avais développé des principes éthiques selon lesquels tout devait être gratuit et dans l’espace public, périssable et vulnérable à toutes les forces de la ville. J’étais allé tellement loin dans cette direction, est-ce que je pouvais retourner à ce qui m’avait fait fuir ? Mais c’était un lieu tellement idéal, tellement fou, que j’ai appris qu’il m’était possible de travailler avec des galeries. Bien sûr, j’ai fait mon lot d’erreurs, et j’ai fait tout ce que je m’étais promis de ne jamais faire, mais rien de cela n’est facile : tenter de grandir comme artiste, saisir les opportunités sans se figer dans un idéal rigide. Mais comment concevez-vous le travail dans un espace fermé ? Alors que dans la rue, les gens trouvent vos œuvres, dans une galerie ils sont préparés à voir de l’art. J’essaye de tirer parti de cet espace protégé, précieux, pour créer un monde miniature. Puisqu’il s’agit de créer tout un environnement, le travail change immensément ; mais certains ont de tout même exprimé leur déception de voir mes personnages suspendus en silence sur les murs. Quand ils les rencontrent dehors, à la merci des éléments, et sur le point d’être détruits, je pense qu’ils créent avec eux un lien différent, plus personnel. Je travaille à créer autant d’émerveillement et de lien avec mes installations, qui sont ma tentive de créer la cité dans laquelle je marche dans mes rêves. Sophie Pujas [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OFo1GbC9zeY[/embedyt] [Visuel : courtesy galerie L.J., Paris] |
Articles liés

La performeuse Chloé Moglia dans “L’Oiseau-lignes” au Théâtre du Rond-Point
Chloé Moglia est une performeuse. Elle invente un rapport nouveau à l’art de la suspension. Fable sonore, ludique et graphique à quatre mains, dans un environnement musical joué en direct par Marielle Chatain, L’Oiseau-lignes compose et recompose une grammaire...

La “Bérénice” ardente et synthétique de Guy Cassiers au Vieux-Colombier
Comment parler d’amour alors qu’on en doute ? Comment aimer alors qu’on est incapable de se donner à l’autre ? Jamais auteur n’a aussi bien fait éclore les voix de la conscience amoureuse que Racine, dont le metteur en...

Cherise (UK) + Maë Defays en concert à La CLEF pour une soirée soul et jazz
Voix de cristal, arrangements groovy : dès les premières notes, vous serez envoûté par ce plateau nu soul qui regroupe deux chanteuses promises à un bel avenir musical sur les scènes internationales. Etoile montante basée au Royaume-Uni, Cherise se...