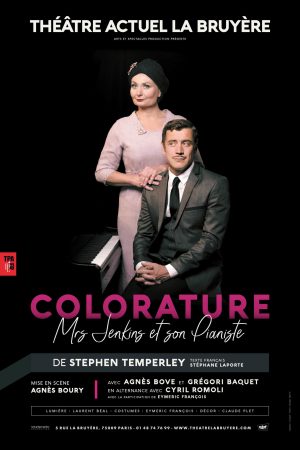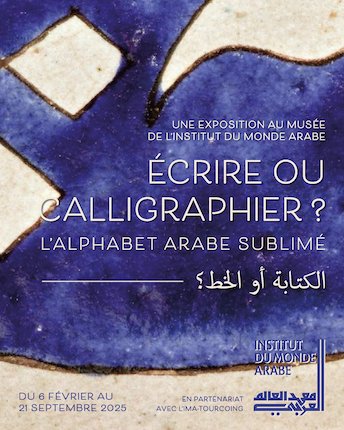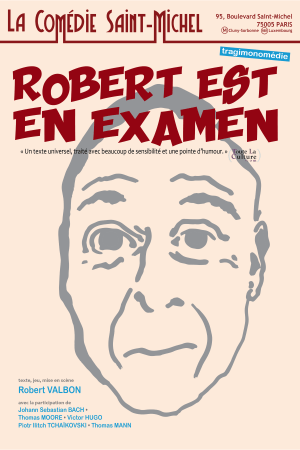Paella – interview
|
Exposition en cours : Jusqu’au 12 janvier 2014 Le Cabinet d’amateur |
Rencontre avec le peintre Paella, connu dans la rue pour ses affiches entre humour et politique.
Quels ont été vos débuts ? J’ai suivi une formation en graphisme avant de passer par les Beaux-arts, et de finalement privilégier la voie artistique. En 1982, j’ai décidé d’adopter le pseudonyme de Paella Chimicos – anagramme de mes noms et prénoms. Aux Beaux-Arts, j’ai fréquenté des gens qui commençaient à peindre dans la rue, sur les palissades du Musée du Louvre, sur les chantiers de la Pyramides, et les palissades de Beaubourg. On s’est confronté à des graffs, au travail des VLP, à Jérome Mesnager, Miss.Tic, Blek, Speedy Graphito. Et j’ai commencé à mon tour mon travail de rue, tout en poursuivant ma carrière de peintre. Pourquoi l’affiche ? C’est en 85 que j’ai commencé. Je la voyais comme un complément de ma démarche. Je voulais trouver un moyen qui me semblait en adéquation avec les idées que je voulais exprimer, une sorte de mixte entre la publicité et l’affiche d’expression politique. J’ai voulu utiliser des lieux qui n’étaient pas ceux utilisés par ceux qui faisaient déjà un travail dans la rue, ces grands murs sur lesquels tout le monde se jetait. J’ai donc adopté d’autres emplacements : les gouttières, les interstices entre les immeubles, quelques poteaux décrépis… C’était un mode opératoire à la fois discret et insistant, puisque je renouvelais ces affichages régulièrement. Petit à petit, je me suis fais remarquer d’un public parisien. Pour moi, il s’agissait d’essayer de formuler des idées avec un support assez réduit. De stigmatiser quelque chose du moment, de faire sourire et éventuellement réfléchir. L’affiche dans ce qu’elle a de traditionnel comme moyen d’expression libre, autorise l’autre à réagir : recouvrement, arrachage, décollage, nettoyage, inscriptions… Vous vous sentiez héritier d’une tradition intellectuelle venue du situationnisme ou de mai 68 ?
D’où est issu votre personnage à tête de spirale ? En 85, je me suis imposé une règle : peindre un personnage toujours tout seul, qui en s’étirant ou en se déformant montre sa volonté d’occuper ou de rejoindre les limites de son espace, avec un texte qui venait encadrer les bords de la composition pour encadrer ses limites. Je voulais qu’il n’ait pas d’expression, pour laisser la première place au corps, exprimer plutôt une énergie. Ce personnage un peu obsessionnel me servait à organiser la surface du tableau. Tout en étant narratif, il me permet de poser la question de la surface de la toile. D’où cette sorte de compromis entre une forme d’expressionnisme, mais aussi les leçons données par support/surface ou d’autres recherches sur la répartition des couleurs sur une surface. Mais pourquoi ce besoin de se donner des règles ? Je ne sais pas. C’est peut-être issu de mon parcours, de cette formation où l’on était complètement nourris de théorie et de rhétorique. J’en ai gardé l’exigence de formuler des idées par le biais de la peinture. J’appartiens à la génération qui a suivi la figuration libre, elle-même en réaction vis-à-vis des mouvements précédents, l’expressionnisme allemand ou les avant-gardes italiennes. Leur volonté de retour à la peinture a aussi été le mien. Je me sentais peintre, depuis tout petit. Mais j’avais besoin d’en dire un peu plus que ce que disaient les acteurs de la figuration libre, qui étaient dans l’énergie spontanée de la peinture. Beaucoup étaient issus de la bande dessinée et de la culture populaire. Pour moi, il fallait passer à autre chose. Pourtant l’influence de la figuration libre est encore très sensible dans votre travail… Un changement que vous avez symbolisé en changeant de nom… Oui, je suis devenu « Paella ? » ! Le personnage à tête de spirale est resté, même s’il s’est humanisé et a perdu son côté élastique. Ma règle a été d’associer le texte à l’image, de façon à créer un lien ambigu entre les deux, à faire en sorte que l’image ne raconte pas ce que dit le texte. Depuis 99, je change de manière de peindre à chaque étape : c’est la technique qui m’impose son langage. Voyager dans tous les possibles de la peinture me fait envisager des choses auxquelles je n’aurais pas forcément pensé. Ce que je n’aime pas trop dans le développement d’une carrière artistique, c’est l’idée de la variété. Beaucoup d’artistes qui s’imposent dans le milieu de l’art se contraignent à rester dans la même formulation. Moi, ce qui caractérise mon travail, ce n’est pas une apparence stylistique qui se perpétue, mais plutôt une idée de la peinture.. Ma constante, c’est d’aller vers l’humour et le double sens des choses, au-delà de ce qui est présenté. Ce que je crée est conçu pour m’échapper. A force de multiplier les équivocités, quelque chose peut s’ouvrir différemment dans l’esprit des autres que ce que moi-même j’aurais pu envisager. Je joue consciemment sur ces mécanismes. Pour moi, l’autre est très important. C’est pourquoi j’essaye de confronter très souvent mon travail au public. D’où une centaine d’expositions à ce jour… J’aime montrer mon travail, et je me suis assez vite donné pour mission, non de présenter mon travail uniquement dans des galeries, mais aussi dans des réseaux de lieux alternatifs, où on ne s’attend pas nécessairement à voir de la peinture, comme dans un chais, récemment. Je ne cherche pas forcément l’originalité de l’endroit, mais ça m’intéresse de confronter mon travail à d’autres regards que ceux qui sont forcément dans une culture de la peinture contemporaine. Qu’un public croise mon travail ailleurs, ça m’intéresse. Ca le fait vivre autrement. Il y a quelques mois, vous avez annoncé votre dernière campagne d’affichage. Pourquoi ? Maintenant, beaucoup de gens collent des choses dans la rue, il y a du monde sur ce terrain. Même si ce sont souvent plutôt des égos qui s’affichent que des idées qui s’expriment… Je me suis dit que j’avais peut-être d’autres façons de formuler des idées à trouver. Le street art est aujourd’hui un peu galvaudé. Il est désormais très admis dans conscience collective commune. Et c’est un peu devenu la production de belles images dans la rue. Or ce qui m’intéresse, c’est surtout de trouver un moyen plastique d’interpeller les passants. L’excellence ne doit pas venir du talent à effacer la ville derrière des images. Il peut y avoir des choses plus intéressantes à partager qu’un chat de dix mètres de haut… C’est pour lutter contre cette tendance au décoratif que vous avez entamé la série « Paella bon débarras », en dessinant sur des objets au rebut dans la rue ? Non, je ne suis pas dans une lutte. Dans la rue, j’essaye de faire en sorte que mon action corresponde à mon éthique. Mon regard est dans la dérision. Tous ces rebuts sont le fruit de notre consommation incessante et le reflet des gens qui les ont utilisés. Je joue sur les travers de la société de consommation. L’origine du projet, c’est qu’en février dernier, j’ai subi un traumatisme crânien. Je me suis rendu compte que j’aurais pu basculer pour pas grand-chose. Quand j’ai repris le dessus fin septembre, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à dire de ces objets abandonnés. Je dessine dessus, je les prends en photo, je repars et j’en publie pratiquement un par jour. Cela me semble une forme d’intervention plastique dans la rue assez sincère. Je ne quitte pas la rue, mais peut-être que je trouverai un moyen différent d’y intervenir. Propos recueillis par Sophie Pujas [Visuels : courtesy de l’artiste] |
Articles liés

« Il Viaggio, Dante » : un voyage splendide à travers nos rêves et nos cauchemars
À l’Opéra Garnier, le compositeur Pascal Dusapin et son librettiste Frédéric Boyer, écrivain, poète et traducteur, reprennent l’opéra créé en 2022 au Festival d’Aix-en-Provence, dans la brillante mise en scène de Claus Guth. Avec le chef Kent Nagano et...

“Maintenant je n’écris plus qu’en français” un seul-en-scène à découvrir au Théâtre de Belleville
Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance : intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe,...

“Furie” une réflexion autour du rejet collectif par Thomas Chopin
Furie est une chorégraphie de genre fantastique qui parle de l’école, du bahut, de ce lieu où nous passons presque vingt ans de notre vie. Inspiré des teen movies, Thomas Chopin se questionne sur la manière dont les enfants apprennent à...




 J’avais sept ans en 68, donc l’influence n’a pas été directe. Mais aux Beaux-Arts, j’ai appris la sérigraphie dans les ateliers où a été imprimée une grande partie des affiches de 68. L’école vivait encore dans une tradition post soixante-huitarde d’ateliers collectifs, dans une culture un peu associative d’échanges où plusieurs générations cohabitaient. J’étais conscient de ce patrimoine intellectuel. Le Situationnisme, en fait, je l’ai découvert un peu après. Mais bien sûr, je pratiquais par intuition quelque chose qui correspondait à des idées préexistantes.
J’avais sept ans en 68, donc l’influence n’a pas été directe. Mais aux Beaux-Arts, j’ai appris la sérigraphie dans les ateliers où a été imprimée une grande partie des affiches de 68. L’école vivait encore dans une tradition post soixante-huitarde d’ateliers collectifs, dans une culture un peu associative d’échanges où plusieurs générations cohabitaient. J’étais conscient de ce patrimoine intellectuel. Le Situationnisme, en fait, je l’ai découvert un peu après. Mais bien sûr, je pratiquais par intuition quelque chose qui correspondait à des idées préexistantes.  Oui, parce que tout est bon à prendre. Mais les choses se sont construites naturellement au fur et à mesure. J’ai choisi de travailler sur une figuration plutôt réaliste qui consistait à développer le visages et le corps de modèles, mais en les mettant à plat. A traduire la réalité en l’écrasant. Ensuite les choses se sont construites plutôt sur le mode de l’intuition. A partir de ce schéma qui peut paraître très rigide, il y avait de quoi faire et travailler toute une vie ! En 1999-2000, je me suis pourtant donné d’autres règles.
Oui, parce que tout est bon à prendre. Mais les choses se sont construites naturellement au fur et à mesure. J’ai choisi de travailler sur une figuration plutôt réaliste qui consistait à développer le visages et le corps de modèles, mais en les mettant à plat. A traduire la réalité en l’écrasant. Ensuite les choses se sont construites plutôt sur le mode de l’intuition. A partir de ce schéma qui peut paraître très rigide, il y avait de quoi faire et travailler toute une vie ! En 1999-2000, je me suis pourtant donné d’autres règles.